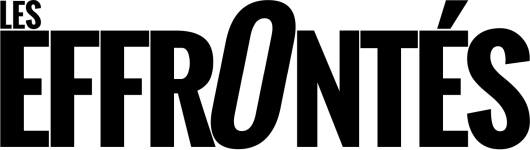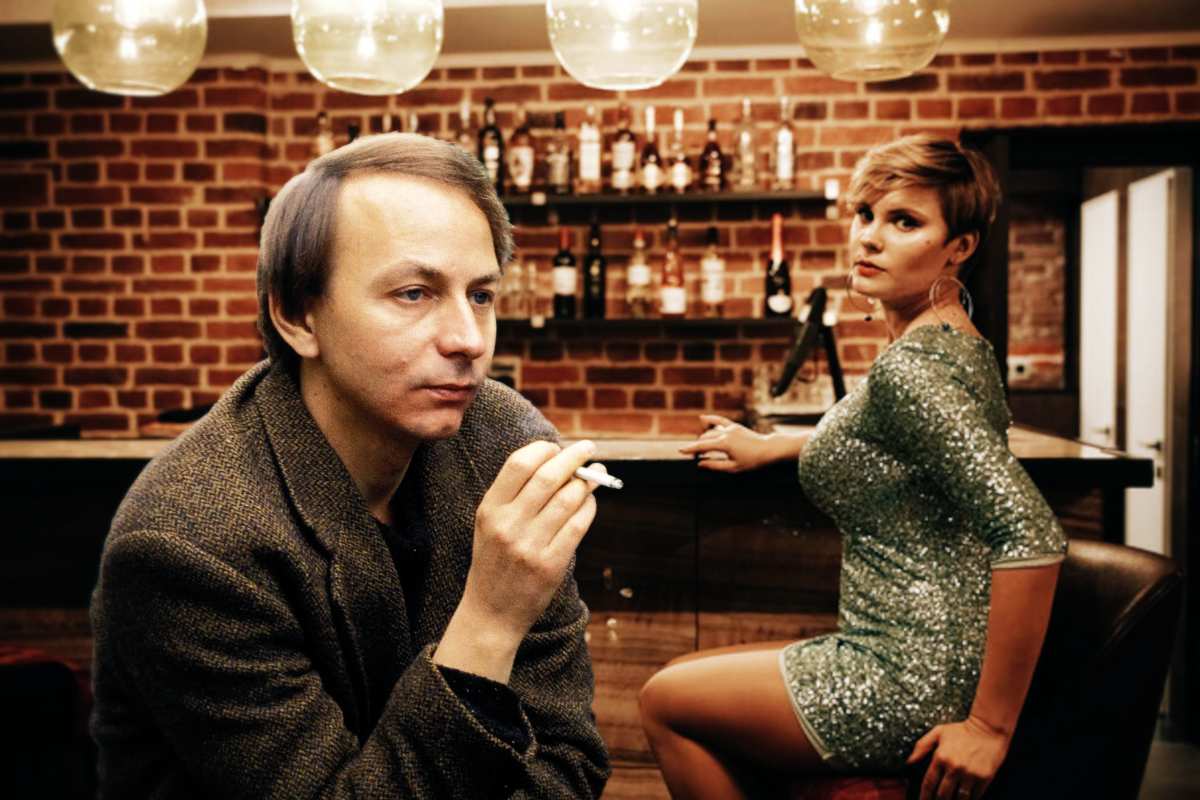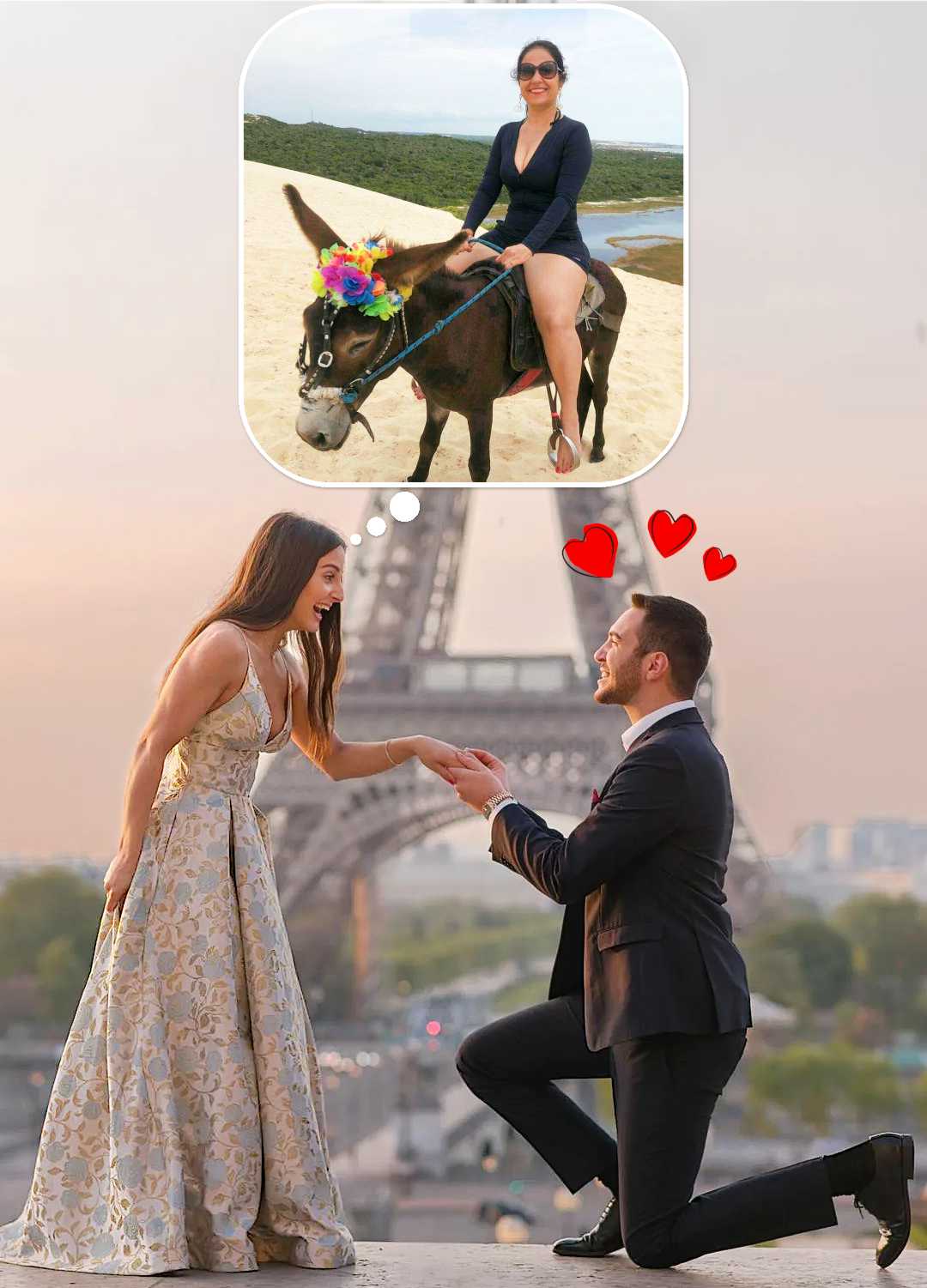Dans son essai La Fin de l’amour, la sociologue Eva Illouz n’a pas écrit que des platitudes féministes, loin de là. Non seulement elle livre d’intéressantes réflexions sur la marchandisation de l’amour (emballées dans l’inévitable solipsisme féminin), mais elle cite également de longs passages des entretiens réalisés avec des hommes et des femmes au cours de son enquête. En voici une lecture pilule rouge, dans l’angle mort des œillères sociologiques.
Résumé du feuilleton : nous avons d’abord examiné la relation très durable des jeunes femmes contemporaines avec les applications de rencontre telles que Tinder :
En somme : une relation est entièrement centrée sur les besoins féminin. Tant qu’ils sont satisfaits, elle peut durer ; dès qu’ils ne le sont plus, Tinder livre une autre bite et un gars attaché au bout.
Enquête sur un désarroi contemporain : Tinder ou l’amour en dropshipping
Puis nous avons observé comment la surabondance de choix de partenaires, conjuguée à l’hyperselectivité féminine, rendait extrêmement difficile de seulement commencer une relation :
La forte sélectivité féminine rend la formation du couple difficile et sa pérennité incertaine. Autrefois, l’étroitesse du marché sexuel local et le sentiment de n’avoir qu’une brève jeunesse incitait les demoiselles à ne pas trop jouer la montre. Les garçons, ayant rarement l’occasion de calmer leurs ardeurs physiques hors du mariage, étaient ravis de ne pas trop tarder non plus.
Enquête sur un désarroi contemporain : les chipoteuses affamées
Je me demandais alors si les relations modernes, tournées vers la satisfaction continuelle des désirs individuels, ne s’avéraient pas justement très ennuyeuses pour cette raison même :
Plus que la satisfaction des appétits sexuels et du besoin de compagnie, plus que le partenaire valorisant commandé sur catalogue, les êtres humains aspirent à… l’Amour. Phénomène rare et farouche de dépassement de sa propre personne ; sentiment en voie de disparition en raison de la destruction de son écosystème traditionnel sous le vacarme des désirs égotiques et la multiplication invasive des choix illusoires.
Enquête sur un désarroi contemporain : les liaisons ennuyeuses
Bien sûr, la double stratégie sexuelle féminine « mâle désirable/mâle exploitable » transpirait abondamment dans les entretiens :
L’homme ne peut-il être tout à la fois le voyou torride, le mari fidèle et travailleur, l’amant un rien volage mais toujours présent, le père et chef de famille rassurant (mais égal) et l’ami-peluche à qui l’on peut tout confier ? C’est pourtant un programme simple… Comment peut-il rater ça, ce grand nigaud ?
Enquête sur un désarroi contemporain : princesses et serviteurs
Enfin, on pouvait détecter un vacillement dans les certitudes individualistes des femmes ayant atteint l’âge mûr :
Voilà : l’engagement, c’était rassurant. Chacun acceptait librement de vivre désormais moins librement dans un truc sécurisant appelé « couple ». Certains jours, c’était ennuyeux, mais on pouvait compter sur la solidité de cette relation, économiquement et affectivement.
Enquête sur un désarroi contemporain : après la fête, la gueule bois
Et maintenant ? J’ai gardé un dernier extrait des entretiens, en guise d’épilogue. Il m’a semblé tout à fait à part, tandis qu’Eva Illouz l’a traité sur le même mode que les autres : en croyant y voir l’empreinte du ténébreux « capitalisme scopique ».
Terry [34 ans] : Vous voyez mes cheveux ? Ils sont de quelle couleur ?
Intervieweuse : Ils sont roux.
Terry : Oui, ils sont roux. Mais pas parce que je suis rousse. Je les teins. Vous savez pourquoi je les teins ?
Intervieweuse : Non.
Terry : Parce que mes cheveux ont blanchi tout d’un coup, quand mon copain m’a quittée. Il a pris tout mon argent et m’a quittée, comme ça, du jour au lendemain. C’était il y a un an et demi et je ne m’en suis pas remise. Je ne le supporte pas.
Ah, un connard ! Il en fallait bien un.
Intervieweuse : Qu’est-ce que vous ne supportez pas ?
Terry : J’ai l’impression que j’aurais dû faire des choses que je n’ai pas faites.
Intervieweuse : Comme quoi ? Qu’est-ce que vous auriez dû faire ? Ça ne vous ennuie pas de le dire ?
Terry : Je pense que je ne m’occupe pas assez de moi : je ne me suis pas assez occupée de mon corps pour lui. Je ne me faisais pas les ongles, comme les autres femmes ; je portais des baskets ; je portais des jeans. Je travaille, j’aime travailler, et je pense qu’il me trouvait trop garçon manqué, que je n’étais pas assez féminine. Que j’aurais dû porter des robes, me maquiller, aller chez le coiffeur, vous voyez ce que je veux dire ?
Intervieweuse : Je vois ce que vous voulez dire.
Non, Eva ne voit pas ce que Terry veut dire ; elle voit ce qu’elle-même veut écrire : que le « capitalisme scopique » pèse sur les relations amoureuses, et surtout sur les femmes — éternelles victimes !
Intervieweuse : Mais je suis sûr que beaucoup d’hommes vous trouvent très jolie.
Terry : Vous dites ça pour être gentille. [Elle éclate en sanglots] Je ne me trouve pas jolie. Même si je l’aimais comme une folle, même si je lui ai donné tout mon argent et qu’aujourd’hui on vient me prendre mes meubles parce que j’ai des dettes à cause de lui, j’ai quand même l’impression que c’est de ma faute.
Gageons qu’un auteur masculin aurait classé sans hésiter ce cas comme pathologique (quoique fréquent), et non comme exemplaire des relations contemporaines. J’ai mis en gras les indices ; ils sont assez probants, il me semble. Et la pauvre Terry est même à deux doigts de la vérité : « j’ai quand même l’impression que c’est de ma faute ». Mais Eva n’est pas d’accord :
Intervieweuse : Je suis désolée que vous pensiez ça. Pourquoi continuez-vous à croire que c’est de votre faute ?
Terry : Parce que ça aurait pu se résoudre plus facilement. J’aurais peut-être pu facilement lui donner ce qu’il voulait. C’était facile d’être le genre de femme qu’il voulait que je sois, et je ne l’ai pas fait.
Eva Illouz, La Fin de l’amour, enquête sur un désarroi contemporain, ed. Seuil, pp. 174-175
Terry ne se demande pas pourquoi elle a choisi un connard. Eva non plus. Ce penchant féminin demeure toujours dans l’angle mort de leur perception solipsiste du monde. Ce n’est pourtant pas nouveau. Dans les années 1920, la chanteuse Mistinguett connut l’un de ses plus grand succès avec cette chanson, mêlant réalisme et satire :
Il me fout des coups
Il me prend mes sous
Je suis à bout
Mais malgré tout
Que voulez-vous
Je l’ai tellement dans la peau
Que j’en deviens marteau
Mistinguett, « Mon Homme », 1920
Théodore Dalrymple, psychiatre des prisons et des quartiers difficiles en Grande-Bretagne, propose une interprétation de la dynamique relationnelle dans laquelle s’enfoncent les femmes comme Terry :
Quel est la psychologie de celui qui bat sa femme ?
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a toujours existé, mais c’est une question de proportions. À mon avis c’est le déclin du mariage, en fait. Parce qu’il n’y a pas une structure de relations entre les sexes, la jalousie est enflammée.
En fait, ce que vous dites dans Zone et Châtiment [aux éditions Carmin], c’est qu’avec la dissolution du mariage, la certitude que son partenaire reste dans la relation diminue.
Oui.
Du coup, on ne sait pas, ça peut s’arrêter à tout moment. Il n’y a pas la solidité et la rigidité qu’il y avait auparavant. Et du coup, cette angoisse psychique d’une séparation est assez forte, et il y a une volonté de contrôle, de garder la main sur l’autre pour qu’il ne parte pas, ce qui mène à toutes les dérives que vous racontez.
Oui, mais en même temps, l’homme qui bat veut avoir sa liberté absolue. Mais pas pour elle. […]
Ce qui est plus troublant encore, c’est que vous avez eu en entretien beaucoup de femmes battues, et à répétition, dans la durée, qui disent : « Ah mais c’est pas de sa faute. Il va changer… », qui lui trouve des excuses, et qui restent, et qui reviennent. Comment expliquez-vous ça ? Ça m’a vraiment troublé.
Elle explique le problème comme [si c’était] une crise d’épilepsie. C’est parce qu’elle a peur d’être seule, dans un monde où il faut des protections. Et aussi — un autre problème — elle préfère avoir un peu de drame dans la vie, plutôt que l’ennui. […]
Et quand elle trouve quelqu’un d’autre il est presque toujours du même type.
Ça c’est vraiment terrible. Et ce que vous expliquez aussi — parce qu’on cherche à trouver les raisons un peu plus profondes de cette dynamique là — vous dites que dans un contexte de désengagement des relations sociales, de dissolution du mariage, etc. Parfois elles se disent que, au moins, s’il y a violence, il y a une sorte de preuve d’engagement et d’une émotion forte, plutôt qu’une indifférence qui est un peu le mode habituel des relations sociales [actuelles]. Au moins il n’y a pas de routine, pas d’indifférence, et certaines s’accrochent à ça en se disant : « Il me tape, mais c’est au moins qu’il y a quelque chose de fort dans notre relation. »
Il a quelque chose dedans.
Exactement. Il a quelque chose dans le cœur qui est une émotion forte, en tout cas. Et je trouve ça triste à pleurer. Et ce que vous dites aussi, c’est que si ces femmes là, qui sont habituées à cette violence trouvent quelqu’un d’autre, ensuite, s’il n’y a pas de violence dans la relation, elles le vivent comme un manque d’engagement.
Oui, oui.
Pierre Valentin, « Psychiatrie, Femmes Battues, et Tatouage – Conversation avec Théodore Dalrymple », Transmission, 2024
La plupart des gens qui apparaissent dans les entretiens sociologiques cités dans La Fin de l’amour… semblent appartenir aux classes moyennes. Leur désarroi devant l’impossibilité de trouver une sécurité affective dans une époque de pure liberté individuelle est déjà assez poignant. Mais que dire des classes populaires ? Terry est chauffeuse de taxi. Sa préférence pour un homme maltraitant est malheureusement assez banale dans son milieu, et l’explication de Théodore me semble très sensée. Le voyou passionné est somme toute plus rassurant que le garçon mou qui ne semble ni capable de fournir une protection virile à une compagne, ni assez jaloux pour tenir vraiment à elle. Dans la classe moyenne, la disparition du mariage comme engagement sérieux produit le désagrément feutré de se faire larguer discrètement si l’on n’a pas plaqué le premier. Dans les classes populaires, cette même perte d’un cadre relationnel imposé par la société aux individus produit davantage de violence physique et de soumission féminine. Triste bilan.
Comment allons-nous en sortir ? Certainement pas volontairement : hommes comme femmes, nous tenons à notre liberté individuelle maximale. D’ailleurs, nous avons grandi dans cette ambiance hyper-individualiste, post-Révolution sexuelle. Seules les difficultés économiques croissantes nous pousserons à renouer, malgré nous, des liens solidaires et durables, plutôt que temporaires et ludiques. Et si ça ne suffit pas, si nous demeurons si peu capables de fonder des familles et de faire des enfants en nombre suffisant pour nous succéder, alors d’autres ethnies le feront à notre place, sur la terre de nos ancêtres. L’hyper-individualisme nous aura alors mené à laisser le champ libre à des cultures bien plus oppressantes pour l’individu que ne le fut jamais la société française traditionnelle.