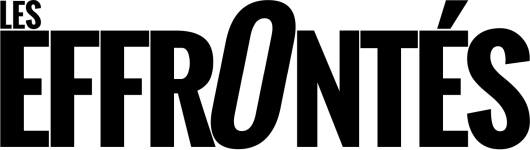C’est un anniversaire de plus cet été. En effet, le 13 juillet 1965, les femmes mariées sont autorisées à ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur conjoint. Leur existence quotidienne devait être un enfer avant cela : être obligées de demander l’accord de son mec pour avoir une carte de crédit ! C’est horrible !
Sauf que… c’est plus compliqué que cela : la plupart des ménages n’avaient pas de compte du tout !
Ce n’est qu’après la guerre que les Français vont réellement déposer leur argent dans les banques. Nombre d’entre elles sont nationalisées en 1945, et leurs activités encadrées dans une économie dirigée vers la reconstruction du pays. Il faut cependant attendre les lois de 1967-68 pour que la bancarisation massive commence réellement. Deux éléments sont primordiaux dans ce processus : d’une part, à partir de 1967, la création de guichet n’est plus soumise à une autorisation préalable, ceux-ci se multiplient dans ce que Bonin a appelé une « course aux guichets » : de 7.776 en 1967, ils sont 15.133 en 1975. D’autre part, après 1968, la mensualisation des salaires se généralise : elle touchait 10% des salariés en 1969, contre 75% en 1972. A cette date, ils doivent être obligatoirement payés par chèque au-dessus de 1.500 francs (Bonin, 1989). Ce n’est qu’à partir de cette période que les banques de dépôts ont pu faire venir à elles l’épargne des familles : 18 % des ménages ont un compte-chèques ou un livret bancaire en 1966, 62% en 1972 et 92% en 1984. En fait, comme le dit de Blic, il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour que la simple pratique du dépôt se généralise.
Georges Gloukoviezoff & Jeanne Lazarus, « La relation bancaire avec la clientèle, volet 1 : La relation de service dans la banque », 2005
Donc, à partir de 1965, les femmes peuvent devenir clientes d’une banque.
Précision : dans le code napoléonien, un couple marié est similaire à une société civile, dont le mari est l’administrateur par défaut. Avant 1965, l’autorisation du mari pour l’ouverture d’un compte ne s’applique pas aux mariages sous le régime de la séparation des biens, ni au couples séparés de corps, ni (bien sûr) aux veuves et aux femmes non mariées. — TB
Peuvent ou vont ?
Dans les années 1960, seulement 18 % des adultes ont un compte en banque ou un livret bancaire et le paiement en liquide, y compris le salaire versé toutes les semaines, est la règle. Il existe donc un gros marché ! D’autant plus juteux que la frontière entre banque de dépôt et de crédit devient poreuse. Pour autant, jusqu’en 1967 :
« Les banques jouent un rôle relativement marginal dans le financement de l’économie française : Les dépôts sont collectés par des organismes publics comme le réseau de La Poste ou celui des Caisses d’épargne, tandis que les crédits sont octroyés par d’autres organismes publics dont le plus puissant est le Fonds de développement économique et social (FDES). […] Le système est jugé trop rigide alors que se profile l’horizon de la Société de consommation. »
Olivier Pastré, La Banque, éditions Milan, 1997
- Première étape : Généralisation du salaire mensualisé et de la carte de crédit, comme aux États-Unis.
- Deuxième étape : Obligation faites aux employeurs, en 1972, de payer par chèque au-dessus d’un certain montant.
De cette manière les banques de dépôts font main basse sur l’épargne des familles, qu’on en juge, puisque de 1967 à 1974, le nombre d’agences bancaires double, tandis que les effectifs bancaires augmentent de 60%.
C’est donc l’anniversaire de l’entrée de la France dans le modèle états-unien de consommation et de la transformation du citoyen (et de la citoyenne) en consommateur. Or, quand tu crois posséder un produit, c’est en fait lui qui te possède. Je signale au passage le magnifique roman de Georges Pérec, Les choses, paru en 1965, terriblement visionnaire. Et depuis, de la crise des subprimes en 2008 à l’€uro numérique, nous sommes entrés dans une ère de risques bancaires systémiques et de contrôle étendu des populations. J’en veux pour illustration l’étrange aventure du député Stéphane Vojetta, telle qu’il la relate :
Comme en 2022, j’ai demandé à la Banque Postale d’ouvrir un compte de campagne à l’occasion des élections législatives. Malheureusement, la Banque Postale a mis cinq semaines à ouvrir ce compte [NDLR : la campagne ayant duré 3 semaines], ce qui m’a obligé à prendre en charge directement certaines dépenses de campagne avec ma carte de crédit. […]
Le Conseil constitutionnel n’a pas entendu mes arguments ni ma bonne foi et a choisi, d’abord, de rejeter également mon compte de campagne, ensuite, de me déclarer inéligible pendant 12 mois. En arguant, notamment, que je n’aurais pas fait les efforts suffisants pour ouvrir un compte alternatif auprès de la banque de France.
Or, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas ignorer que ce qu’il suggère est illégal, puisque cette procédure auprès de la banque de France est seulement possible — c’est le code électoral qui en dispose ainsi — si la première banque a opposé par écrit un refus d’ouverture de compte. […]
Il s’agit effectivement d’une sanction sévère, mais surtout incompréhensible et qui me paraît difficilement fondée en droit. Le contraste avec la situation de mes collègues députés dont certains continuent à siéger après avoir reconnu l’utilisation de dizaines de milliers d’euros d’argent public pour acheter de la drogue à des mineurs, ou après avoir été condamné pour coups et blessures sur leur compagne me paraît affaiblir notre démocratie.
« Stéphane Vojetta déchu de son mandat : “Ils ne se débarrasseront pas de moi comme cela” », Valeurs Actuelles, 2025
Des mésaventures similaires sont arrivés à des médias jugés d’extrême-droite (Frontières, TV Libertés). C’est l’exemple de ce qui se passe quand on devient dépendant du système bancaire : on croit obtenir plus d’égalité, on perd beaucoup de liberté.