Après La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, Marcel Pagnol poursuivit le récit de son enfance dans Le Temps des secrets. L’été de ce récit, il est devenu un grand garçon de douze ans qui entrera bientôt au lycée, c’est à dire en classe de sixième (un niveau d’instruction très élevé en 1907, et encore bien après). À cet âge, Marcel connaît comme sa poche les collines autour du hameau des Bellons et la façon de prendre au piège moult petits gibiers, mais il ignore tout d’un autre genre de chasse où l’on se trouve à la fois chasseur et proie : la sexualité. Il est pourtant loin de vivre son enfance de garçon dans une complète séparation de l’autre sexe. À Marseille, hors de son cercle familial, la fille de la concierge de l’école où enseigne son père est une camarade de jeux habituelle. C’est à son contact qu’il découvre, non une autre langue, mais assurément une autre façon de s’exprimer : l’implicite.
Assise près de moi sur le banc, sous le préau, en face de la cour déserte, elle me dit un jour :
« J’ai un ami qui vient souvent jouer avec moi. Il est gentil est très beau. Seulement, je trouve qu’il est bête.
— Pourquoi ?
— Parce que moi je sais bien qu’il m’adore, mais, il a peur de me le dire, et il n’ose pas m’embrasser.
— Et toi, il te plaît ? »
Elle renversa la tête en arrière, leva au plafond des yeux langoureux, et soupira:
« Oh oui !
— Comment s’appelle-t-il?
— Marcel, comme toi ; et même il a les yeux marron, comme toi. Souvent, j’essaie de lui faire comprendre, mais ça ne réussit pas. »
Alors je fus furieux qu’elle eût donné son cœur à cet individu, qui avait l’audace de me ressembler, et de porter mon prénom.
« Et où est-ce que tu vas jouer avec lui ?
— Ici, à l’école. »
À ce stade, la gamine attendait certainement du petit Marcel qu’il emboîte les pièces du puzzle, si grandes et si clairement dessinées, et saisisse l’offre qui lui était présentée. Mais la logique abandonne les garçons dès qu’il s’agit des choses de l’amour.
Je triomphai aussitôt.
« Eh bien, ma fille, tu es une belle menteuse ! S’il venait ici, moi je le verrais, parce que je regarde souvent par la fenêtre de la cuisine ! Tu inventes tout ça parce que tu crois que ça va me rendre jaloux. Mais moi je peux te dire que ça m’est bien égal, et même que je m’en fiche complètement. Et ce n’est plus la peine que tu m’en parles, parce que je ne t’écouterai même pas ! »
Alors, elle se leva, les mains jointes, les yeux au ciel, elle cria d’une voix stridente:
« Qu’il est bête ! Qu’il est bê-ête ! »
Moi aussi, pendant la plus grande partie de ma vie, je ne comprenais pas le féminois. J’ai gâché bien des opportunités et déraillé bien des relations en restant sourd au langage de l’implicite que les femmes affectionnent. Elles les ont tout autant gâchées en refusant de me donner cette chose si simple pour les hommes : une toute petite discussion explicite sur ce que nous voudrions faire ensemble. C’est à l’homme de résoudre les énigmes. Il le fait bien en science, en métaphysique, dans le commerce et la guerre, au travail et dans le jeu… mais il peine et reste ballot face au beau sexe. Il croit trouver chez une femme un camarade dans une enveloppe féminine. Comme si les femmes pouvaient être psychiquement semblables aux hommes tandis que leur corps est si profondément différent.
Cet été là, Marcel rencontra une fille de son âge : la ravissante Isabelle. Délaissant son ami Lili et leurs mâles aventures dans les collines, il goûta l’amour — cet alcool fort que l’on croit boire à deux mais que l’on cuve tout seul.
La reine, naturellement, c’était elle, et le chevalier, c’était moi. Nous commençâmes par la fabrication de nos costumes, car comme toutes les filles, elle adorait se guignoliser. […]
Lorsque je la vis paraître, la couronne en tête, le sceptre en main, ceinturée de glands d’or et suivie d’un traîne écarlate, je fus ébloui, et je crus vraiment en sa royauté: je lui jurai fidélité, et je me déclarai prêt à mourir pour elle, ce qu’elle accepta sans façons.
Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait d’être une créature si adorable que les garçons se jettent à vos pieds en suppliant de vous servir ? Il serait bien difficile de ne pas user et abuser de ce pouvoir sur autrui, n’est-ce pas ? Et en effet, les filles ne manquent pas d’en user. Quand ce n’est pas par besoin, c’est pour le pur plaisir d’en éprouver la puissance.
Les premiers ordres qu’elle me donna mirent à l’épreuve ma force et mon courage.
Elle m’ordonna d’aller chercher un nid abandonné dans la plus haute fourche d’un acacia, garni d’épines acérées ; puis, elle laissa tomber une rose dans le « puits » des Bellons (qui avait bien trois mètres de profondeur, et où personne n’avait jamais vu d’eau) et « m’autorisa » à descendre dans ce gouffre pour y conquérir cette fleur. […]
Un autre jour, elle me conduisit, sur la route du village, jusqu’à la ferme de Félix […] en son absence, ses richesses étaient gardées par un chien immense, si maigre qu’on eût dit un squelette velu, et qui bondissait vers les passants en s’étranglant au bout d’une chaîne, dont l’épaisseur était fort heureusement proportionnée à la férocité de l’animal.
La reine me déclara que si j’allais le caresser, je serais nommé capitaine des Gardes du Palais. […]
Spontanément, la plupart des garçons se dévouent aux femmes, encore plus si elles sont jolies et les font rêver d’amour. Sacrifice, dévotion, adoration : l’homme amoureux ressemble à l’adepte halluciné d’une secte, et l’objet de son amour à un faux gourou froidement entreprenant.
J’avais trouvé dans l’herbe, sous la balançoire, un ruban de satin vert, tombé des cheveux de la bien-aimée ; je possédais aussi un bouton de nacre de sa robe, un glaïeul qu’elle m’avait donné, le noyau d’une prune qu’elle avait mangée, une petite pomme sauvage où l’on voyait la marque de ses dents, et la moitié d’un petit peigne. Chaque soir, je plaçais ces trésors sous mon oreiller ; puis le ruban vert noué autour du cou, et serrant dans mon poing le fruit divinisé de sa morsure, je revivais, les yeux fermés, la miraculeuse journée, et je préparais les phrases qui lui diraient — demain peut-être — l’éternité de mon amour.
Cependant, la reine ne tarda guère à abuser de son autorité. Je comprends aujourd’hui qu’après avoir mesuré mon audace et ma vaillance, elle se plut à humilier ces vertus viriles devant sa faiblesse de fille : elles adorent le héros, dont la réduction en esclavage est cent fois plus glorieuse que celle du fidèle comptable, et il arrive que la fragile jeune femme épouse l’effrayant champion de catch pour le plaisir de lui donner des gifles.
Voilà une fine observation ! En effet, il est bien plus excitant de séduire un alpha — un homme capable de dominance — plutôt qu’un brave gars soumis par avance, prêt à offrir de tout cœur son Livret A patiemment abondé et un tendre nid dans le canapé-lit de son F2. Les héroïnes de romances convoitent typiquement des hommes de caractère et de statut supérieur dans l’ordre instinctif, mais il importe que dans les dernières pages le mâle indompté rende les armes et se mette enfin au service de sa Princesse à l’entrejambe embué de sa joie victorieuse. Conséquence : l’excitation féminine est à son comble dans l’asservissement d’un homme aussi peu obéissant que possible. Quand sa soumission a enfin été obtenue, l’excitation décroît. Le rabaisser davantage ne fait pas revenir le frisson. Bien fol qui cède à une femme pour ne point la perdre, car il s’assure de la décevoir quelle qu’ait pu être l’impression initiale de sa virilité.
Elle commença par m’ordonner de porter sa traîne ; puis elle fit remarquer que ce n’était pas là le travail d’un chevalier, et m’ayant montré une gravure coloriée sur laquelle la traîne royale était portée par deux négrillons, elle me noircit le visage et les mains avec un bouchon brûlé. Il fallut ensuite l’éventer respectueusement avec le plumeau, pendant qu’elle faisait semblant de dormir dans le hamac, puis à son réveil, pour la distraire, je dansais la « bamboula ». Après quoi, pour me récompenser, elle me disait: « Ouvre la bouche, et ferme les yeux ! » et je devais croquer ce qu’elle déposait délicatement sur ma langue : ce fut d’abord un berlingot, puis une cerise, puis un colimaçon.
Heureux et fier de l’étonner, je me vautrais dans cette servitude, et je tremblais d’émotion lorsque, avant mon départ, elle nettoyait elle-même mon visage et mon cou avec un tampon de coton trempé d’eau de Cologne…
De nos jours, la plupart des parents n’y trouveraient rien à redire. Leur relation est souvent la version adulte de cette soumission abjecte du masculin au féminin. Et si elle ne l’est pas, ils fermeront quand même les yeux par crainte d’enfreindre le seul impératif « moral » subsistant à notre époque : le droit absolu de faire tout ce qu’on veut sans recevoir la moindre objection. Mais l’enfance de Marcel Pagnol se déroulait dans un monde très conscient des différences entre les deux sexes, entre la bonté et la servitude, entre le décent et l’indécent. Le masochisme amoureux de Marcel avaient eu deux témoins accidentels : son petit frère Paul et son ami Lili. Paul déballa toute l’histoire devant la famille :
— Mais moi, j’ai compris ! s’écria Paul. Le fille l’a tout barbouillé en nègre, et puis il tenait la queue de sa robe, et après elle l’a fait courir à quatre pattes !
— En aboyant, murmura Lili, qui tenait toujours les yeux baissés.
— Voilà un jeu assez surprenant, dit l’oncle Jules.
— Et qui ne ressemble à rien, dit Joseph sur un ton catégorique. Jamais de ma vie une fille ne m’a fait courir à quatre pattes !
— Et bien, moi non plus ! s’écria Paul avec force. Jamais de ma vie !
— C’est un jeu que nous avons inventé ! Le jeu du « Chevalier de la Reine » !
— En général, dit mon père, les chevaliers ne courent pas à quatre pattes !
— Et ils n’aboient jamais ! » dit l’oncle.
Je vis bien qu’ils n’étaient pas contents. Je leur expliquai donc les règles du jeu, en insistant sur l’élégance des sentiments chevaleresques, et en disant que dans les vers du poète, « ça se passait toujours comme ça ». Mais Paul pointa vers moi un index accusateur.
« Et la sauterelle ? cria-t-il. La sauterelle, tu n’en parles pas. Elle lui a fait fermer les yeux, et puis ouvrir la bouche, et puis elle a mis dedans une sauterelle !
— Vivante ! murmura Lili. […]
— Crachée ou croquée, dit brusquement mon père, je trouve ce genre de plaisanterie tout à fait idiot et il est parfaitement clair que cette fille te prend pour un imbécile ! »
Peu de gifles sont aussi cuisantes que la franche déception exprimée par un père. En ce temps là, même les mères étaient soucieuses de la virilité de leur garçon — ou du moins qu’il ne se fasse pas l’esclave de la première gourde venue sans l’approbation de maman.
Son déplaisir était visible, et je ne savais plus quelle attitude prendre, lorsque j’entendis la voix de ma mère. Elle était sur la porte, les mains enfarinées, et elle disait :
« Si les filles te font manger des sauterelles maintenant, je me demande ce qu’elles te feront manger plus tard ! »
Aux garçons de notre siècle, qui ont déjà mangé plus que leur part de chagrin et d’humiliation, je transmets cette mise en garde simple et explicite :
- Ne courrez pas pour une fille (même sur deux pattes).
- Ne vous travestissez pas pour lui plaire.
- Ne la traitez pas comme une reine.
- N’avalez pas tout ce qu’elle veut vous faire gober.
Elle vous en sera secrètement reconnaissante ou, au pire, vous serez un homme libre.
Illustration : Phyllis et Aristote, par Giovanni Buonconsiglio, XVIe siècle
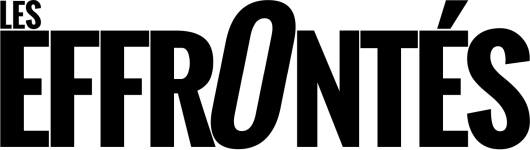




Fascinant comme la pilule rouge permet de mieux réinterpréter un tas de classiques ! Et que dire d’Ugolin, fou d’amour pour Manon, qui évidemment le fait tourner en bourrique pour mieux venger son père… En tout cas merci pour cette analyse et cette conclusion si concise (aucun jeu de mot).