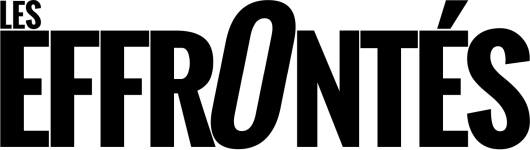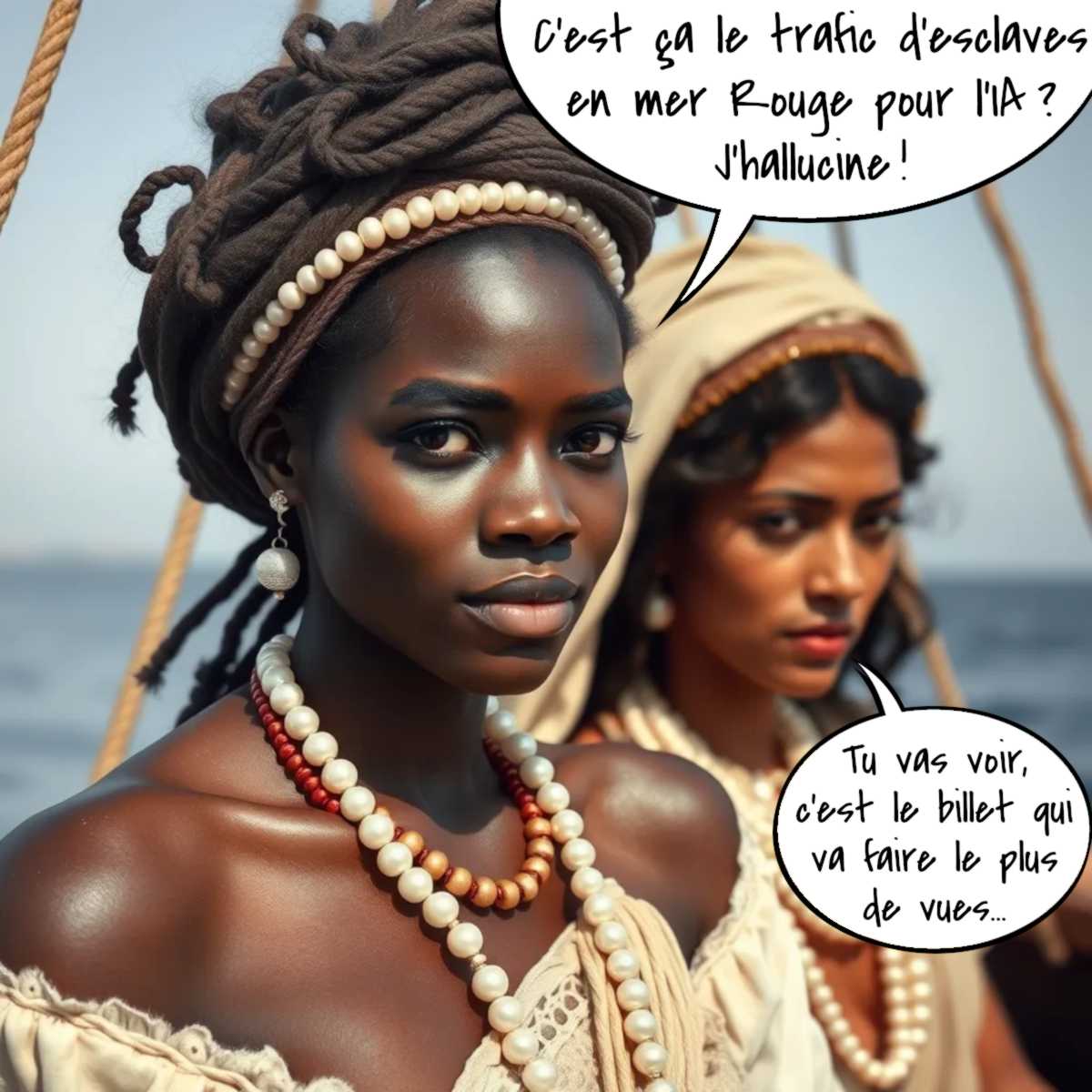Mes courtes vacances d’été m’offrent enfin le répit nécessaire à la lecture. Étendant le bras jusqu’à ma réserve de livres encore inexplorés, j’ai saisi un petit volume bleu au titre parfumé d’exotisme : Pêcheurs de perles. Publié en 1931, c’est un long reportage dans la péninsule arabique, avec pour but et conducteur le sort des hommes qui, sans équipement, plongeaient à la recherche des perles dont on fait les colliers de luxe, jusqu’à s’en faire péter les tympans, les yeux, le cœur et les poumons. C’est surtout une visite éprouvante et moite du monde arabe au tout début des années 1930. On y est surpris, mais moins par des faits insoupçonnés que par leurs détails sordides joints à la chaleur accablante qui tombe de ces pages. Albert Londres fut l’exemple de ces grands reporters écrivant aussi bien que les auteurs de leur temps — c’est-à-dire mieux que les nôtres — et risquant sa personne pour éclairer notre compréhension des coins réculés du monde. Voici un aperçu de cette autre humanité, dans cet autre temps :
En cherchant des perles, allais-je trouver des esclaves ?
Avant 1925, ma route en eût été semée. Le Hedjaz et le Nedj [sic, l’ouest et le centre de la péninsule arabique] absorbaient toute la cargaison humaine. Venant d’Abyssinie, de la côte des Somalis, de l’Érythrée, du Soudan, des troupeaux noirs débarquaient franchement à Djeddah. La douane levait même sur les négriers un impôt de dix pour cent, c’est-à-dire que sur cent esclaves elle choisissait les dix plus beaux qu’elle vendait à son bénéfice. Ainsi opérait-on jusqu’au roi Hussein. Mais vint Ibn Séoud. Ibn Séoud n’abolit pas l’esclavage : le Coran l’admet. Il en interdit les marchés. L’esclave ne se vend plus sur la place publique mais sous le manteau… le manteau de poil de chameau.
Il faut préciser qu’Ibn Saoud (comme on l’orthographie aujourd’hui) avait une raison diplomatique de modérer le trafic des esclaves : c’était une exigence des Britanniques, lors de la signature du traité de Djeddah, en 1927. L’homme blanc a de drôles d’idées.
Où sont les sambouks [boutres, navires à voiles latines] de chair humaine traversant sournoisement la mer Rouge de la côte d’Afrique à la côte d’Asie, louvoyant pour éviter les torpilleurs français et anglais chargés de leur parler au nom des droits de l’homme et enfin, drapeau déployé, touchant en fanfare le port arabique ? Le cheikh ad dalal ar ragig, le chef des courtiers en esclaves, enlevait immédiatement le gouvernail et courait à travers Djeddah le planter à sa fenêtre. C’était le signal. La foire commençait. On séparait le troupeau en deux parties : les esclaves pour la cuisine : djaria nel melbach, et les esclaves pour le lit : djaria nel sarir. Les bourgeois de la ville arrivaient. Ce jour était un jour de fête. Le père et les fils se réjouissaient, tapant sur leurs bourses. On palpait la marchandise, s’assurant de la souplesse des articulations ; on enfonçait son doigt dans les bouches pour juger du bon état des mâchoires. Un petit Abyssin valait quatre-vingt livres. Une jolie fille se payait cent quarante livres. Pour cinquante livre on avait un djaria nel melbach. Le harem l’emportait sur la cuisine. Le lendemain, le joli courtier emmenait dans le souk ceux qui n’avaient pas trouvé acquéreur. Les prix étaient moins élevés. C’était une vente au rabais pour cause de défauts de fabrication ! […]
Aujourd’hui, la vente se fait en secret : « Bid-Dais ». Plus de gouvernail aux fenêtres, plus de sambouks s’enfonçant sous le poids. On voit arriver une malheureuse ayant traversé la mer Rouge sur un minuscule houri [bateau de pêcheur], seule, couchée entre deux nègres qui rament. D’autres patrons en fourrent dans des sacs, comme une marchandise. Qu’un torpilleur montre ses cheminées, aussitôt les cas humains disparaissent sous les sacs de riz. Si le corps du délit ne peut passer inaperçu, le sac est lesté et confié au fond de la mer ! Ceux et celles qui échappent ne débarquent plus dans le port. On les cache dans la ville. Les acheteurs finissent par les trouver. L’Abyssinie n’en exporte plus que de trente à trente-cinq par ans, le Yémen une quinzaine. Quelques-uns proviennent du Soudan, c’est tout. Ah ! les beaux jours n’ont qu’un temps !
Cependant on vit encore sur le passé. Toute famille riche du Hedjaz possède des esclaves pour la cuisine, et pour le lit. L’homme de bonne souche, en se mariant, offre une esclave à sa femme : c’est la bague de fiançailles de l’Arabie. On dit même que dans les territoire inviolés, à Riad, des esclaves blanches donnent à Ibn Séoud une raison supplémentaire de trouver que Dieu est grand ! Ce serait des Arméniennes dont le rapt répondrait à la loi sainte du Coran : « La guerre contre l’incroyant te pourvoira d’esclaves. » Belles incroyantes aux maris massacrés, êtes-vous au moins un peu heureuses ?
Albert Londres, Pêcheurs de perles, 1931
Au premier quart du XXIe siècle, c’est-à-dire à présent, les « torpilleurs » Français, Anglais et Américains patrouillent toujours en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Ni les droits de l’Homme, ni le Code civil, ni la common law n’ont éclipsé la chéria (telle que l’orthographiait Albert). Les mœurs de la région semblent avoir assez peu changé, sur mer comme sur terre. Hors de l’Occident douillet, le monde est cruel. Ou juste indifférent au sort des captifs et des miséreux. Aux idées enfantines de nos intellectuels, tout autant.