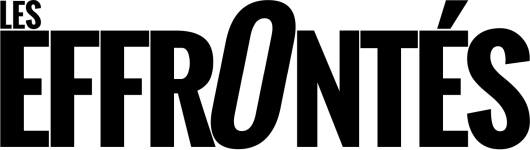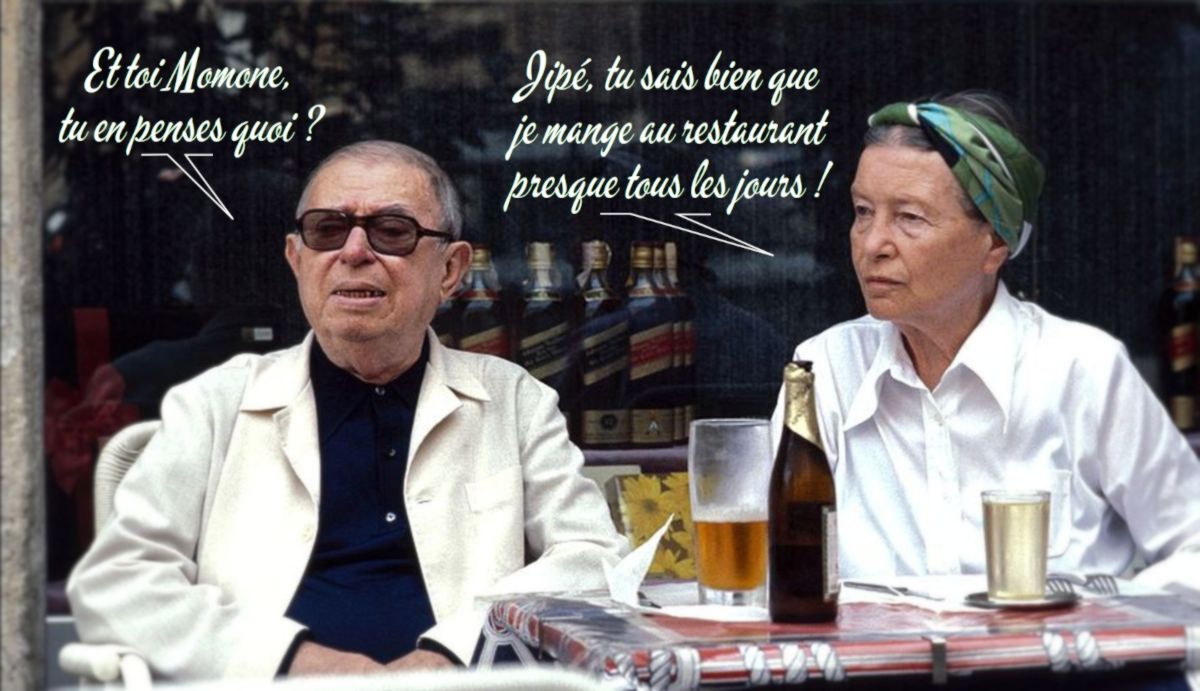John Michael Greer est un auteur américain féru d’histoire, d’ésotérisme et de science-fiction. Surtout, c’est un fin commentateur de la psychologie collective et de l’évolution de la société américaine. — TB
On ne comprend pas vraiment une idée jusqu’à ce qu’on en connaisse l’histoire. C’est une leçon que la plupart des gens ont fait de leur mieux pour ne pas apprendre ces dernières années. Leur réticence n’est pas un accident. Une fois que vous savez d’où vient une idée et quel cheminement erratique elle a suivi depuis son lieu de naissance jusqu’à aujourd’hui, il n’est plus possible de la faire entrer dans le carcan simpliste du « vrai ou faux ». Vous devez admettre qui l’a inventée, quelles causes il soutenait ou combattait, qui l’a reprise et en a fait autre chose, etc. Il faut la replacer dans son contexte réel, et non dans le contexte inventé pour elle par la culture ou la contre-culture d’aujourd’hui.
La plupart des discussions sur les concepts de matriarcat et de patriarcat s’inscrivent parfaitement dans le carcan simpliste mentionné ci-dessus. D’un côté, il y a ceux qui affirment que, historiquement, certaines, ou la plupart, ou toutes les sociétés avant l’aube de l’histoire écrite étaient dirigées par les femmes, et que ces matriarcats ont été renversés par des envahisseurs patriarcaux. D’un autre côté, il y a des gens qui affirment qu’il n’y a jamais eu de matriarcats préhistoriques. Le débat n’a cessé de tourner en rond ; comme il est quasiment impossible de savoir grand chose sur la « politique de genre » des sociétés qui n’ont laissé aucune trace écrite, il n’y a essentiellement rien pour empêcher les deux camps de trouver ce qu’ils veulent trouver dans les traces équivoques mises au jour par les archéologues.
C’est ici que les perspectives offertes par l’histoire des idées s’avèrent utiles. Laissons de côté pour l’instant les questions relatives à la préhistoire et posons-nous des questions moins difficiles à résoudre : d’où vient cette croyance en l’existence d’anciens matriarcats ? Qui l’a inventée, quand et où, et quelles causes voulait-on défendre à travers ce concept ?
Les réponses, ici, sont d’une simplicité rafraîchissante. Le concept de matriarcat préhistorique a été inventé par un homme nommé Johann Jakob Bachofen, un philologue et professeur suisse, et il a été introduit dans le monde de la pensée moderne par son livre Das Mutterrecht [NdT : Le Droit maternel], publié en 1861. Ses idées ont été reprises avec enthousiasme par d’éminents anthropologues, et pendant un temps ont été largement acceptées dans les cercles universitaires. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c’est que Bachofen et presque tous les grands noms de la littérature du XIXe siècle sur le matriarcat étaient des hommes — et que la grande majorité d’entre eux considéraient le matriarcat comme une très mauvaise chose.
Il est important de replacer l’œuvre de Bachofen dans son contexte. L’idée de sociétés exclusivement féminines, dans lesquelles les femmes occupaient les rôles sociaux traditionnellement masculins, remonte à l’Antiquité ; les Amazones de la légende grecque en sont l’exemple le plus connu. Ce qui distingue ce cliché de l’invention de Bachofen, c’est que les Amazones et leurs équivalentes ne régnaient pas sur des sociétés composées d’hommes et de femmes. Leurs sociétés, selon les légendes, excluaient totalement les hommes. Personne, bien sûr, ne présentait les Amazones comme une étape universelle de l’histoire humaine. Les sociétés d’Amazones étaient toujours décrites comme des phénomènes exotiques, très éloignées du cours normal des choses.
Ce n’était pas du tout ce que Bachofen disait. Il proposait que toute l’humanité ait traversé une série d’étapes évolutives pour passer de la sauvagerie primitive aux premières civilisations sédentaires. Il y avait trois étapes principales ; comme nous étions au XIXe siècle, ce qui définissait ces étapes était, bien sûr, le sexe. La première était l’étape de la promiscuité primitive, où tout le monde s’accouplait avec tout le monde et où les liens familiaux n’existaient pas encore. Le deuxième était le stade du matriarcat, où les liens familiaux se concentraient entièrement sur la mère, car personne n’avait encore compris le lien entre le sexe et la grossesse, et où les femmes régnaient donc sur la société. Le troisième était le stade du patriarcat, où les hommes prirent le pouvoir aux femmes et établirent la famille sous sa forme moderne.
C’est un joli schéma simpliste, il devint donc inévitablement très populaire dans la pensée européenne durant un siècle environ, même dans des domaines apparemment très éloignés des « études de genre » préhistoriques. Lisez ce que Freud avait à dire sur les stades oral, anal et génital que tous les enfants sont censés traverser, par exemple, et il n’est pas difficile de voir Bachofen en arrière-plan. D’ailleurs, les notions actuellement à la mode sur les « stades évolutifs » empruntent largement au schéma de Bachofen, généralement de troisième ou quatrième main. Cela s’est produit aussi facilement parce que, comme la plupart des idées révolutionnaires, celle de Bachofen était moins originale qu’elle en avait l’air.
Il prit l’idée de faire remonter les formes sociales humaines aux notions actuelles de barbarie primitive et d’ignorance de Giambattista Vico [NdT : historien, juriste et philosophe napolitain], qui écrivait vers la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle mais dont les idées étaient revenues à la mode quelques décennies avant que Bachofen n’écrive. Il reprit l’idée de diviser le développement historique en trois étapes séquentielles de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dont les idées étaient très populaires parmi les intellectuels européens de l’époque de Bachofen. Au-dessus de toute cette entreprise planait l’œuvre de Charles Darwin, qui avait publié L’Origine des espèces en 1859 et, plus largement, la découverte par le monde occidental du temps profond [NdT : deep time]. Partout en Europe et dans la diaspora européenne, les personnes qui avaient grandi en pensant que le monde n’avait que 6000 ans d’âge se débattaient frénétiquement tandis que les scientifiques les obligeaient à commencer à penser en millions d’années. (Les milliards d’années étaient encore à venir.) De bonnes étapes bien définies rendaient tout cela un peu plus facile.
Mais il y avait un autre spectre au festin de Bachofen. En 1848, un groupe de femmes se réunit à Seneca Falls, dans l’État de New York, et y tint la convention qui marqua le début de la première vague du féminisme. Cela s’inscrivait également dans un contexte historique, puisque la première moitié du XIXe siècle avait été marquée par une perte spectaculaire des droits des femmes dans une grande partie du monde occidental. C’est à cette époque que les femmes perdirent le droit de vote dans certains États américains, droit qu’elles avaient depuis l’époque coloniale [NdT : en fait, seul le New Jersey supprima ce droit, en 1807, puisqu’il avait été le seul à l’accorder ; de plus, seuls les propriétaires votaient], et que les femmes anglaises perdirent le droit de posséder des biens [NdT : les femmes mariées, le ménage étant considéré comme une seule personne juridique ; le Code Napoléon rejoignait la common law sur ce point]. Si l’on ajoute à ces tendances historiques la forte implication des femmes dans la lutte contre l’esclavage, durant laquelle nombre des premières féministes apprirent les outils du militantisme politique, une explosion était inévitable. En conséquence, bien avant 1861, les intellectuels masculins européens furent confrontés à la résistance des femmes, profondément insatisfaites des rôles que la culture du XIXe siècle leur assignait.
L’invention du concept de matriarcat par Bachofen, et son adoption enthousiaste par les anthropologues et les universitaires masculins en général, était donc une réponse à la montée de la première vague du féminisme. L’encre du texte de Darwin était à peine sèche que les gens commencèrent à l’utiliser pour conforter les hiérarchies sociales, en insistant sur l’idée que « plus évolué » équivalait à « meilleur ». (Ce n’est pas du tout ce que Darwin disait mais, à l’époque comme aujourd’hui, trop peu de gens utilisant le mot « évolution » ont pris la peine de lire L’Origine des espèces.) Dans cette optique, Bachofen et ses disciples ont présenté le patriarcat comme « plus évolué » — c’est-à-dire : à un stade plus avancé de l’évolution humaine que le matriarcat — afin que le féminisme puisse être dénoncé comme un retour à des conditions primitives et moins évoluées.
Ah, mais construire un « homme de paille » selon ces principes comporte un risque constant qu’il soit retourné contre vous. C’est ce qui s’est passé avec le concept des anciens matriarcats : beaucoup de gens, pas seulement des femmes, ont lu ce que Bachofen avait à dire sur le matriarcat et ont décidé que cela semblait bien mieux que ce que leur offrait l’Europe du XIXe siècle. La figure centrale ici était Friedrich Engels, le bon pote de Karl Marx et co-inventeur du communisme. Dans son livre L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), Engels s’est largement inspiré des héritiers de Bachofen dans la communauté anthropologique, mais a renversé leur théorie, insistant sur le fait que le matriarcat primitif avait été un système utopique exempt de pauvreté, de guerre et d’oppression, avant que l’invention de la propriété privée — l’équivalent du péché originel dans la réécriture marxiste de la théologie chrétienne — ne fasse tout s’écrouler.
Le livre d’Engels a donné le coup d’envoi pour des radicaux de diverses variétés, qui ont adopté le concept d’ancien matriarcat et l’ont adapté à leurs propres fins rhétoriques. Certaines féministes de la première vague, dont Elizabeth Cady Stanton et Matilda Joslyn Gage, l’ont adopté et utilisé efficacement dans leur propagande pour défendre leur camp dans la guerre des sexes de cette époque. De nombreux marxistes et anarchistes l’ont également repris, avec plus ou moins de succès. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’ensemble du concept a ensuite été lâché comme une patate chaude par les anthropologues. Cela n’a pas ralenti le mouvement pour autant. Tout au long du XXe siècle, la notion d’anciens matriarcats, pacifiques et utopiques, fut monnaie courante parmi les radicaux culturels à gauche.
La difficulté à laquelle ces projets se sont heurtés, lorsqu’ils ont dépassé le simple dogme et tenté de prouver leur thèse, était la même que celle rencontrée par leurs détracteurs qui tentaient de réfuter cette même thèse : les données concernant les relations entre les sexes dans la préhistoire sont si rares qu’elles peuvent être interprétées de toutes les manières imaginables, et il est pratiquement impossible de trouver des preuves concluantes. C’est ainsi que Marija Gimbutas a mis ses talents académiques considérables au service de la tentative de prouver que l’Europe du Sud-Est préhistorique était très proche de l’utopie matriarcale d’Engels, pour finir par supposer ce qu’elle voulait prouver : décider, comme elle l’a fait, que chaque dessin représentant un œil doit, par définition, être l’icône sacrée d’une « Déesse des Yeux » par ailleurs non documentée, et il n’est alors pas difficile de trouver des déesses partout où l’on regarde.
(Remarquez, il est tout aussi hasardeux de supposer qu’une société qui vénère des déesses doit être féministe. Le Japon féodal — pas vraiment une utopie féministe — vénérait la déesse du soleil Amaterasu plus que toute autre divinité shintoïste ; l’Athènes antique, qui cantonnait les femmes mariées dans les gynécées, accordait la première place à Athéna. Rien n’est plus difficile que d’essayer de démêler les détails des relations sociales lorsque tout ce dont on dispose est de rares traces archéologiques de la culture matérielle.)
C’est à partir de ce processus que nous avons fini par être accablés par les affirmations selon lesquelles le matriarcat et le patriarcat sont les schémas organisationnels fondamentaux de la société. Ces affirmations ont pris une autre importance à mesure que le XXe siècle avançait, et l’effacement des classes sociales est devenu un élément central du camouflage utilisé par les classes managériales pour dissimuler et exploiter leur pouvoir sur la société. C’est pourquoi il est devenu chic de parler de sexe, de race et d’autres divisions théoriquement biologiques, mais jamais de classe. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans une situation où une femme afro-américaine de la banlieue du Maryland, qui gagne un salaire à six gros chiffres, plus des avantages sociaux, en travaillant dans la bureaucratie fédérale, peut prétendre être opprimée par un homme blanc de Virginie-Occidentale qui occupe trois emplois à temps partiel au salaire minimum dans un effort désespéré pour nourrir ses enfants, alors que les politiques qu’elle applique et le parti qu’elle soutient sont directement responsables de la détresse de cet homme.
Il serait temps de renoncer à cette rhétorique égoïste et de reconnaître la valeur de l’un des rares concepts valables proposés par la gauche moderne, celui d’intersectionnalité : la reconnaissance que les droits et les obligations qui vous sont attribués par la société ne sont pas déterminés uniquement par le sexe, la race, la classe sociale ou tout autre facteur isolé, mais par l’ensemble de ces éléments et bien d’autres encore. Nous ne vivons pas dans une hiérarchie, mais dans une hétérarchie, où le pouvoir est complexe, nuancé, personnel et situationnel, variant selon une multitude de paramètres différents. On peut généralement supposer sans risque que ceux qui tentent d’aplatir cette réalité en une sorte de schéma binaire simpliste le font dans le but de revendiquer un pouvoir immérité pour eux-mêmes et leurs alliés.
Il est donc grand temps d’admettre que nous ne savons pas s’il y a jamais eu des sociétés préhistoriques gouvernées par des femmes et, si les universitaires n’étaient pas aussi terrifiés par les mots : « nous ne savons pas » — je pense qu’ils ont peur que leur nez tombe s’ils le disent — ils seraient sans doute d’accord. Ce que nous savons, c’est que les schémas évolutionnaires à base de « stades de développement » fixes, par lesquels toutes les sociétés passeraient, s’effondrent systématiquement lorsqu’ils sont confrontés aux données des sociétés existantes et aux archives écrites de celles qui ont disparu. En d’autres termes, lorsque Ken Wilber [NdT : auteur d’ouvrages esotérico-psychologiques] a tenté de faire revivre cette habitude du XIXe siècle au cours des dernières décennies, il s’est trompé de cible. Pourtant, la construction rhétorique des anciens matriarcats nous apprend quelque chose de très utile, non pas sur le monde antique, mais sur le présent.
Prenons un peu de recul et parlons de la nature du pouvoir social. En gros, il existe deux façons d’exercer le pouvoir au sein d’une communauté humaine, que nous pouvons appeler pouvoir formel et pouvoir informel. On peut observer cela dans la plupart des églises protestantes américaines. Le pouvoir formel dans l’église est détenu par le pasteur et certaines autres personnes, généralement des hommes ; selon leur confession, ceux-ci peuvent être élus par la congrégation, sélectionnés par un conseil d’anciens ou nommés par l’évêque local, mais tous ont des fonctions spécifiques avec des droits et des devoirs bien définis.
Il y a ensuite le pouvoir informel. Dans toutes les églises avec lesquelles j’ai été en contact, ce pouvoir est détenu et exercé par un petit groupe de femmes âgées — souvent appelées « les dames de l’église ». Elles occupent peut-être des postes symboliques au sein de la confrérie de l’autel [NdT : altar guild] ou d’autres instances similaires, mais cela n’a rien à voir avec leur pouvoir réel, qu’elles exercent par le biais des commérages, du réseautage et d’autres moyens indirects. Cela ne rend pas leur pouvoir moins puissant ; dans la pratique, ce sont elles qui dirigent l’église, et rien ne se passe sans leur accord. Les pasteurs intelligents les flattent, négocient avec elles et les rallient à leur cause ; les pasteurs faibles se soumettent à elles et s’en sortent généralement assez bien.
Un pasteur qui perd irrémédiablement le soutien des femmes de sa paroisse est fichu. Il sera jugé et condamné par un tribunal sans appel. Les ragots, les insinuations, les campagnes de dénigrement et toute une série de moyens similaires entrent alors en jeu. Si la rupture est suffisamment grave, à moins qu’il n’ait l’intelligence de fuir immédiatement son poste, il peut être sûr que sa carrière sera détruite, et très probablement son mariage et sa vie par la même occasion. Les pasteurs qui se trouvent dans de telles situations sont généralement démis de leurs fonctions dans le déshonneur, s’ils ne meurent pas d’abord d’alcoolisme.
Comme dans les églises, il existe dans les sociétés une tendance générale — pas universelle, comportant de nombreuses exceptions, mais le plus souvent vraie — à ce que le pouvoir formel finisse entre les mains des dirigeants masculins et le pouvoir informel entre celles des femmes âgées. Cette division par sexe n’est en aucun cas un système parfait, mais elle semble fonctionner et pourrait bien être câblée en nous. Dans les activités traditionnellement masculines telles que la chasse et la guerre, après tout, on n’a pas le temps de chercher un consensus et il ne doit y avoir aucun doute sur qui a le droit de prendre des décisions rapides. (« Vous trois, allez par là, les autres iront par ici, et nous attaquerons le mammouth des deux côtés. ») Dans les occupations traditionnellement féminines telles que la cueillette, la garde des enfants et les soins aux personnes âgées, le consensus informel est plus facile à mettre en œuvre et, dans de nombreux cas, plus approprié.
La plupart des sociétés humaines laissent place à ce double modèle, et certaines s’appuient explicitement sur lui. En revanche, l’une des choses qui distingue les sociétés industrielles occidentales modernes de presque toutes les autres sociétés humaines de l’histoire est qu’elles ont fait tout leur possible pour supprimer les lieux de pouvoir informel sur lesquels les femmes s’appuyaient.
Aux États-Unis, bien que le pouvoir informel des femmes ait décliné pendant de nombreuses années, le point de rupture est survenu avec la construction et la commercialisation massive des banlieues [NdT : suburbia, la banlieue pavillonnaire de la classe moyenne, très étalée et éloignée des centres urbains]. Avant la Seconde Guerre mondiale, la grande majorité des femmes vivaient dans des quartiers où elles avaient de nombreuses occasions d’interagir avec d’autres femmes et de créer les réseaux de relations interpersonnelles stables qui permettent à un pouvoir informel de fonctionner. Avec les maisons, les magasins, les écoles, les églises et les lieux de travail à proximité, et une mobilité géographique très modeste, le pouvoir informel prospérait et offrait aux femmes des moyens d’exercer le pouvoir au sein de leurs communautés.
L’avènement des banlieues a mis fin à cela. Les banlieues pavillonnaires ont été conçues pour isoler leurs habitants les uns des autres, à des kilomètres des lieux d’interaction, tandis que les médias de masse ont étouffé les autres activités sociales et qu’une vague croissante de mobilité géographique a rendu impossible la formation de liens sociaux stables. Les femmes se sont soudainement retrouvées privées d’un mode de pouvoir social qui était central dans la vie de beaucoup d’entre elles, et les médias leur ont dit qu’elles n’avaient d’autre choix que d’accepter une situation d’impuissance totale dans laquelle elles avaient perdu leur pouvoir informel mais étaient exclues de l’accès au pouvoir formel. Cela a rendu inévitable la deuxième vague du féminisme, les femmes réagissant en recherchant la seule forme de pouvoir qui leur restait : le pouvoir formel, exercé en concurrence avec les hommes. La rhétorique des anciens matriarcats leur a servi de langage symbolique efficace pour parler d’un sentiment très réel de privation de pouvoir.
À mesure que ce que James Howard Kunstler [NdT : journaliste et auteur effondriste] appelle ironiquement « le paradis de l’automobile joyeuse » sombre dans les poubelles de l’histoire et que les banlieues redeviennent des lieux d’habitation plus viables, le pouvoir informel reprendra sans aucun doute sa place normale dans notre société. En attendant, cependant, les changements sociaux poursuivis par certains éléments de la société doivent tenir compte de la réalité du pouvoir informel des femmes. De nos jours, un nombre important de jeunes femmes adhèrent au mouvement des « femmes traditionnelles » [NdT : tradwives], abandonnant leur carrière dans le monde professionnel pour endosser le rôle de femmes au foyer et de mères. Ce phénomène ne deviendra durable que si elles parviennent également à établir et à maintenir leur propre pouvoir informel dans un modèle similaire aux schémas traditionnels.
Cela dépend, ensuite, de la capacité des jeunes hommes conservateurs de faire preuve de cervelle et de reconnaître qu’il est essentiel de laisser faire et de ne pas essayer d’interférer lorsque leurs épouses commencent à retisser les anciens réseaux de pouvoir informel. Cela entraînera certains désagréments, car ce pouvoir informel sera souvent utilisé d’une manière déplaisante aux hommes. Mais telle est la nature du pouvoir : tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, trouveront des moyens d’exercer leur pouvoir, et si vous n’aimez pas ce que vos femmes en font, messieurs, rappelez-vous simplement l’histoire des deux derniers siècles et sachez que l’autre possibilité pourrait être beaucoup moins à votre goût.