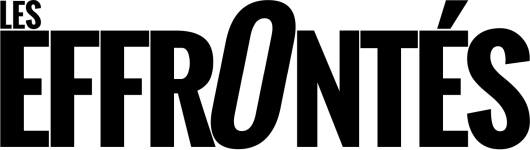J’ai acquis une grande affection pour les boites à livres. Non par radinerie envers les libraires, mais pour les surprises qu’elles offrent. Je fouine fréquemment dans celles de mon quartier, à tel point que ma boite aux lettres, par jalousie, a fini par se prendre pour une boite à livres. Il y a quelques jours j’y trouvais une enveloppe inhabituellement épaisse contenant un livre de poche, une carte postale et les mots affectueux de l’expéditeur. Le livre est un diptyque, composé d’un essai résumant l’abominable naufrage du navire hollandais Batavia en 1629, et du récit d’une paisible campagne de pêche sur le thonier breton Prosper en 1958. Deux histoires de mer, l’une gracieuse, l’autre affreuse ; toutes deux à mon goût.
Un passage du second récit m’a rappelé que je néglige les Effrontés depuis plusieurs semaines. Il parle d’un moment crucial dans la vie des hommes, l’entrée dans le monde du travail :
Le mousse a treize ans : c’est sa première campagne de pêche. Les hommes sont pour lui ce que la mer est pour les hommes : une puissance d’une inexorable indifférence, que l’on ne peut se concilier que par la patience et l’adresse. Le mousse est donc passablement sournois, chapardeur et paresseux — c’est sa manière de subsister élastiquement dans un monde dur. La dureté n’est pas le fait individuel des matelots (quand il épluche sa montagne quotidienne de pommes de terre, par exemple, il y en a toujours l’un ou l’autre qui, spontanément, sort son couteau et lui fait la moitié de la besogne), elle découle plutôt de la force même des choses, comme une loi qui s’impose à tous et que nul ne juge bon de lui épargner en raison de son jeune âge.
La cuisine est sa principale attribution ; cette tâche ne requiert d’ailleurs aucune compétence particulière — il suffit chaque matin de mettre à bouillir dans la grande marmite une certaine quantité de pommes de terre, d’oignons, de carottes et de navets avec un quartier de bœuf ou des pieds de porc, et de laisser mijoter le tout jusqu’à ce que l’appétit des hommes exige que cela soit servi. La seule variante dans le menu est que, la pêche une fois commencée, le thon vient se substituer à la viande, dont le patron n’achète que le minimum nécessaire pour les quelques jours qui précèdent la capture du premier poisson. Et dès ce moment, le thon bouilli, frit, ou cru avec du vinaigre, constitue pendant un mois, midi et soir, l’aliment de base de tous les repas.
La charge d’assurer tous les autres petits conforts de la vie du bord incombe également au mousse : le café du matin, le thé du soir, le maintien d’une propreté (très relative) dans le poste. Il doit être à même de trouver immédiatement, et d’apporter à qui le lui demande, l’épissoir et le fil de caret dont l’un a besoin, ou le paquet de tabac et le briquet que réclame un autre. Dans la mesure de ses forces, il prête la main à la manœuvre sans qu’on doive lui expliquer deux fois. Du reste, on n’explique même pas une fois : il doit voir et deviner.
Les premiers jours, il a le mal de mer ; personne n’y fait attention — du moment qu’il exécute sa besogne, peu importe si sa figure tourne au vert. Serrant les dents, il descend surveiller sa marmite dans l’atmosphère empuantie de la soute. Parfois, il s’interrompt dans son travail pour remonter sur le pont, le temps de vomir sous le vent par-dessus la lisse, puis il reprend sa tâche. Son mal de mer disparaîtra bientôt — son enfance aussi ; au retour, il sera un dur petit adulte de treize ans, sans rêves et sans jeux.
Simon Leys, Les Naufragés du Batavia, suivi de Prosper, pp. 98-99, Arléa
C’est à peu près au même âge que mes grands-pères quittèrent l’école et commencèrent leur apprentissage dans des métiers plus terriens mais tout aussi masculins. Je suis certain qu’ils ne furent pas plus maternés que le mousse du Prosper. Ils apprirent en regardant et en faisant, avec bien peu de conseils et (s’ils étaient de bons gars) guère plus de reproches. Comme sur le thonier breton, il y avait forcément du vin sur la table du déjeuner, pour tout le monde, y compris l’apprenti. La première cigarette, sûrement offerte par un collègue ; les éternuements aux premières bouffées amères, les grands qui se marrent : « C’est rien, p’tit, c’est l’métier qui rentre. » C’était un autre monde, il y a si peu de temps.
Mon père alla au collège. Puis moi. Je ne connus ni travaux durs, ni danger, ni inconfort. Pas de piquette le midi. Je m’abstenais de tenter la cigarette que certains de mes camarades plus effrontés allumaient en quittant l’établissement. Je passais — comme vous, sans doute — une très grande partie de mon adolescence assis, à noter sur des cahiers le flot de paroles que les enseignants épanchaient pour nous, heure après heure, année après année. Un jour, la tête chargée de tant de mots, avec un diplôme pour le prouver, nous nous lèverions de notre chaise pour accomplir enfin un acte d’adulte : s’asseoir sur une autre chaise, devant un bureau. En attendant, je développais une scoliose, puis une dépression qui devait me conduire bientôt à m’asseoir devant un psychiatre. Je crois que si l’on enlevait toutes les chaises et tous les fauteuils, le monde moderne s’effondrerait.
Mon adolescence ne différa pas de celle de mes grands-pères que par la rareté des tâches physiques : elle eut lieu dans un monde mixte au lieu d’un monde masculin. Une mixité inégale, car la majorité de mes enseignantes au secondaire furent des femmes, et ceux de mes camarades qui furent expulsés vers les filières dites « techniques », avant le baccalauréat général ou avant même le lycée, étaient surtout des garçons. Eux ont sans doute connu une atmosphère de travail manuel et de masculinité désuète, désormais réservée aux médiocres pas capables de tenir assis sur une chaise. Les autres, nous sommes allés nous asseoir sur les bancs de l’université, ou d’une école « supérieure » de quelque chose qui ne salit pas les mains. Le travail était encore loin. Il semblait même s’éloigner, comme l’horizon, à mesure que nous nous en approchions. Nous sommes restés dépendant de papa et maman longtemps, jusqu’à 25, 30 ans… plus parfois. J’ai connu des étudiantes au très long cours encore occupées à finir leur thèse après 35 ans, avant d’entamer une vie professionnelle bien trop tardive pour constituer une carrière. Peu de garçons s’attardent autant. Ils savent qu’on ne leur pardonnera pas de rester improductifs. Personne ne les épousera pour leur faire des enfants, les nourrir, les loger et leur offrir une sécurité matérielle jusque dans la vieillesse, en substitution des annuités jamais cotisées.
Pendant ce temps les expulsés des filières générales (si ce sont de bons gars) ont commencé à bosser en apprentissage dès 16 ans, et à plein temps à 18 ou 20 ans. En moyenne moins payés que les diplômés du supérieur, mais commençant leur carrière beaucoup plus tôt, ils accèdent concrètement à l’âge adulte au moment où la plupart des « favorisés » n’ont encore qu’une vague idée de l’emploi qu’ils occuperont un jour — et ajoutons pour ceux qui ont choisi l’une des nombreuses filières universitaires à maigres débouchés : s’ils en trouvent un.
Je suis sûr que beaucoup de gens trouveront cette comparaison absurde. Comment pourrait-on hésiter à choisir des études longues menant au minimum à un emploi confortable (assis…), probablement à un salaire supérieur sur le long terme et assurément à une plus grande culture personnelle ? C’était l’évidence pour mes parents. Rétrospectivement pourtant, je regrette d’avoir été languir à l’université conformément aux attentes de mon milieu. Quel temps perdu ! L’un de mes grands-pères, parce qu’il était très bon élève, se vit proposer de prolonger sa scolarité au-delà du certificat d’études (à la fin des années 1920, ce n’était pas rien). Il refusa tout net et préféra partir en apprentissage avant de retourner auprès des siens, épouser ma grand-mère et vivre le reste de son âge. C’était un dur petit adulte de treize ans. Un bonhomme.