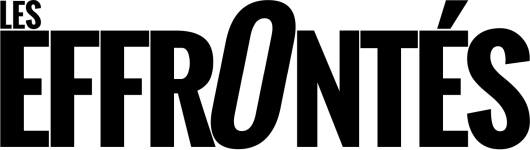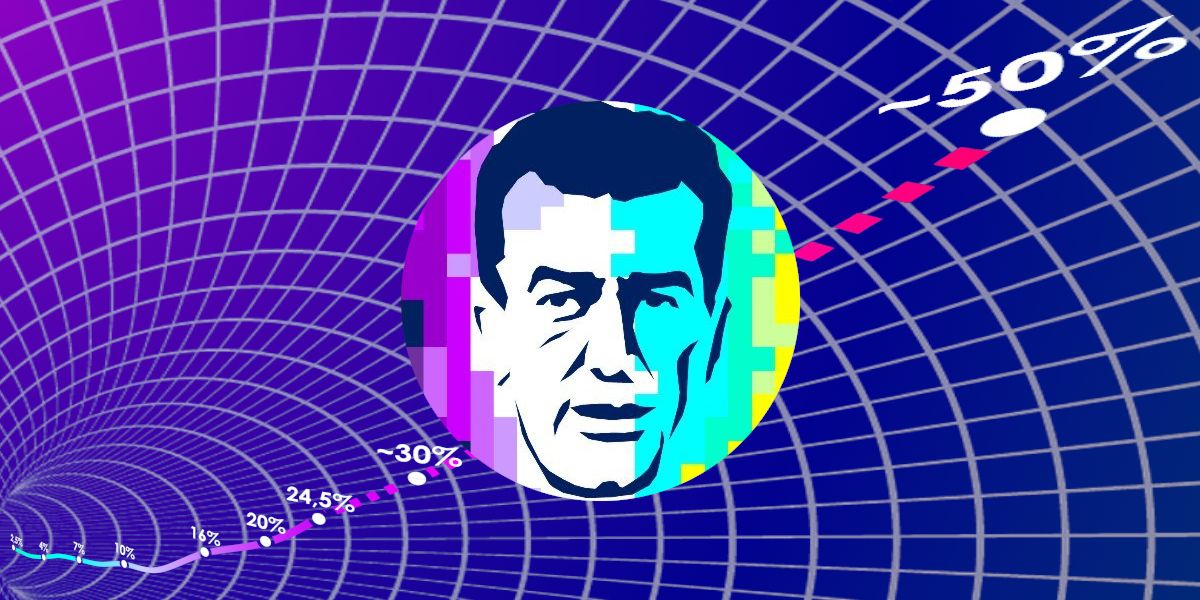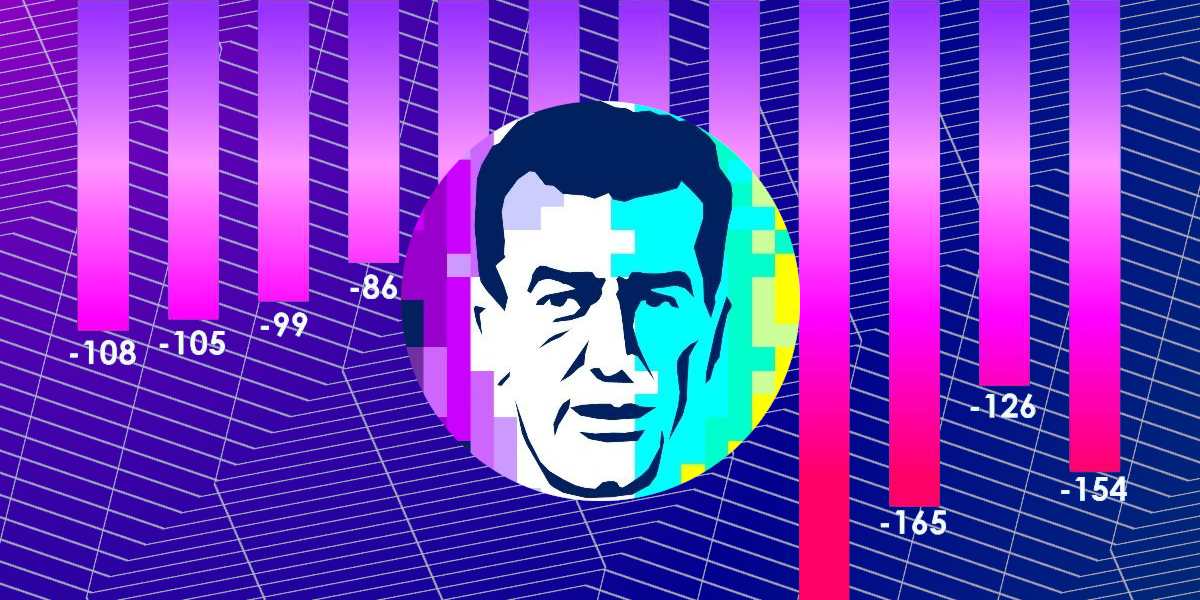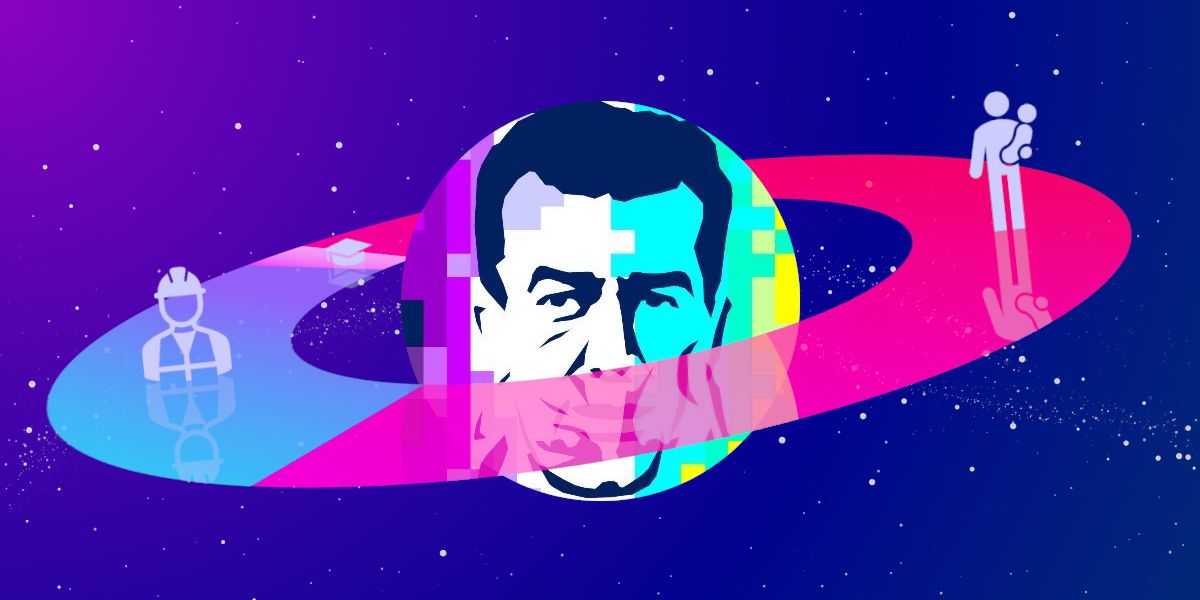Parmi toutes les turpitudes reprochées à la République française, celle que j’ai le plus rarement entendu mentionnée par les militants urbains est certainement le déclin des langues régionales. Tout au plus aiment-ils infliger au français sa juste pénitence en le lardant de vocabulaire anglo-américain fraîchement importé ; il n’en reste pas moins la langue spontanée de leurs indignations.
Je crois avoir pris conscience de l’existence d’autres langues que le français en France et de ses nombreuses variations appelées patois lorsque j’étais collégien. La vision d’un pays autrefois divisé en différents espaces linguistiques me laissait une impression un peu inquiétante. Je ne parlais alors que le Français et l’apprentissage des rudiments de l’anglais me causait déjà bien des difficultés. Franchement, j’étais persuadé que je n’arriverais jamais à me débrouiller avec une autre langue que celle de ma mère, l’ayant apprise par la méthode mystérieuse que l’on maîtrise si bien quand on est encore dans la petite enfance et que l’on oublie sitôt qu’on est un grand garçon de la classe de sixième. J’étais donc rassuré de vivre dans une époque où l’on parlait désormais français partout dans mon pays. Je saurai ainsi demander mon chemin et prendre part aux conversations sans devoir apprendre l’Occitan, le Basque ou le Breton en plus de l’anglais (et bientôt de l’espagnol, dont le principal mérite était de paraître beaucoup moins effrayant que l’allemand). Cependant, pour parvenir à cette remarquable homogénéité linguistique, l’école de la République s’était montrée sévère. Pendant plusieurs générations, disait-on, les écoliers des régions où l’on ne parlait pas le français du bassin parisien avaient été durement punis dès qu’ils avaient le front de s’exprimer dans leur langue maternelle, non seulement en classe, mais même en récréation. Nous, nous n’étions jamais punis de parler français en cours d’anglais, du moment que ce n’était pas du bavardage, et bien sûr il ne serait venu à l’idée de personne de nous reprocher de discuter en français durant la récré. Je ne pouvais qu’éprouver un sentiment d’injustice et de solidarité rétrospective envers les enfants que les instituteurs d’autrefois avaient réprimandés pour avoir commis l’acte le plus naturel du monde : parler sa propre langue. Je ne savais plus que penser de la République : elle était méchante, mais tout de même, elle était pratique.
Il était bien connu que les politiciens de la capitale avaient forcé les Bretons à ne plus parler leur langue en parachutant là-bas des commandos d’instituteurs inflexibles chargés de terroriser les enfants et sans doute leurs parents, alors que la Bretagne avait fait le don à la France d’une invention des plus dignes de gratitude qui soit : les crêpes. J’avoue être resté sur cette idée naïve bien après l’âge où l’on ne compte plus sur sa maman pour délayer la pâte et retourner la crêpe à mi-cuisson en la faisant tournoyer au dessus de la poêle d’un audacieux coup de poignet — ce n’est sans doute pas la meilleure manière de faire, que les Bretons nous pardonnent ! Cette idée me resta jusqu’à ce que je lise le récit de l’enfance bigoudène d’un fameux auteur breton né en 1914, où j’appris que la diffusion du français se fit avec les Bretons, et non contre eux :
Quant aux maîtres d’école, depuis la création des Écoles Normales, beaucoup d’entre eux sont des fils de paysans. Ils font souvent comme le père d’un de mes amis. Ils punissent sévèrement, dans la journée, les élèves qu’ils surprennent à parler breton. Après la classe, leur plaisir est de parler le même breton dans leur famille et avec les gens du bourg. Contradiction ? Pas du tout. Quand ils ont fini d’être des hussards de la République, ils redeviennent des hommes.
Pas de contradiction non plus dans le comportement de nos parents. À chacune de nos défaillances, comme je l’ai dit, la seconde punition, après celle de l’instituteur, nous vient d’eux. Ils font le sacrifice d’envoyer leurs enfants à l’école pour apprendre le français oral ou écrit alors qu’ils en ont souvent besoin à la maison pour garder les vaches ou les frères et sœurs. Le travail des petits est donc de s’appliquer au français. En parlant breton, ils boudent ce travail, ils rechignent à la peine, ils s’amusent. Que mérite quelqu’un qui s’amuse au lieu de travailler, s’il vous plaît ? Une bonne correction pour lui apprendre à vivre. Par conséquent, le vachard qui rentre à la maison doit s’attendre à recevoir une raclée assortie d’un discours en breton. Que les parents soient Blancs ou Rouges, il n’y coupera pas. Les Blancs ont beau prétendre, avec les prêtres, que « le breton et la foi sont frère et sœur en Bretagne », cela ne dispense nullement leur progéniture d’apprendre le français, même s’ils ne doivent pas en user quotidiennement.
Pierre-Jakez Hélias, Le cheval d’orgueil (éd. Plon, Terre Humaine, 1975), p. 213
Notez bien : ni Pierre-Jakez ni moi ne voulons nier que l’enseignement universel du français décidé dans la capitale ait été un outil politique visant à transformer la France en nation linguistiquement homogène, plus commode à gouverner et plus solidement républicaine. Simplement, les parents des petits bretons de cette génération y voyaient aussi un savoir indispensable pour leurs enfants — comme l’anglais pour les enfants d’aujourd’hui. À la différence de l’anglais, cependant, le français était bien plus qu’une langue utile. C’était la langue de la patrie, c’est-à-dire : non pas le pays où l’on naît, mais celui pour lequel un homme risque sa vie quand il faut le défendre de la mainmise d’autres hommes.
Pendant quatre ans, ils ont abandonné leurs défroques de maîtres et de domestiques pour n’être plus que des frères d’armes pataugeant dans une même terre boueuse qui n’appartenait ni aux uns ni aux autres. Ils ont un peu appris La Marseillaise, le Chant du Départ, la Brabançonne et d’autres chansons en français. Ils ont vaincu ou cru vaincre les Boches, ce qui est la même chose. Et maintenant, ils se retrouvent ensemble devant le monument aux morts où les noms des Rouges et des Blancs se mêlent sans distinction. Ils ont sauvé la France, la France est à eux, fait partie de leur patrimoine, pourquoi pas le français ! Et les instituteurs laïques, tout Rouges qu’ils soient, apprennent à leurs enfants des chants patriotiques :
Où t’en vas-tu, soldat de France,
Tout équipé, prêt au combat,
Plein de courage et d’espérance
Où t’en vas-tu, petit soldat ?
Nos anciens combattants de pères sont flattés. Ils n’ont pas souffert en vain, perdu un œil ou une jambe pour qu’on fasse le silence sur quatre ans d’épopée. Bien sûr, cette guerre est la dernière, c’est entendu. Mais justement, ils ne sont pas peu fiers d’avoir été ceux qui ont mis un point final à tant de siècles de bruit et de fureur. Le mot bro, qui désignait auparavant quelques lieues carrées autour de leur clocher, s’étend maintenant à toute la France. Ils ne connaissent le mot Breiz, le nom de la Bretagne, que parce qu’il figure dans les chansons et les cantiques. Jamais ils ne l’emploient dans la vie courante. Mais leur œil se mouille quand ils entendent le mot patrie dont les instituteurs font un constant usage à l’école. Décidément, ils ne sont pas mal du tout, ces instituteurs. Et d’abord, beaucoup sont tombés glorieusement sur le front. On peut compter sur ces gens là pour élever les enfants comme il faut, tout Rouges qu’ils sont.
Ibid., pp. 214-215
Maintenant que je suis grand, je confesse lire au moins autant en anglais qu’en français et, en conséquence, je pense à certains sujets dans la langue internationale plus que dans ma langue maternelle. L’anglais est presque une mienne langue, en plus du français, bien que j’y garde assez de lacunes pour ne pas douter de mes origines. Je me garderai bien de pronostiquer l’avenir de ma langue maternelle, sinon qu’il est étroitement lié à l’avenir de ma patrie. Si les Français se désintéressent tout à fait de la France et préfèrent s’intégrer à une puissance supérieure, ils finiront par s’exprimer en anglais ou en allemand, ou peut-être en chinois. Si, comme je le pressens, le déclin des ressources indispensables à la marche du monde industriel amène bientôt un nombre croissant de gens à s’enraciner dans une existence plus régionale, avec moins de voyages et d’ambitions cosmopolites, nul doute que les parlers locaux retrouveront leur vigueur ou, s’ils ont été tout à fait oubliés, s’inventeront de nouveau. D’ici là, ma prose en français du début du XXIe siècle, couchée sur un flux d’électrons plus fragile que le parchemin, se sera envolée comme s’envolèrent les paroles de mes ancêtres dans toutes les langues qu’ils ont parlé.