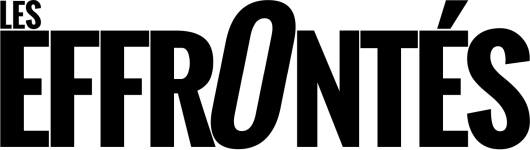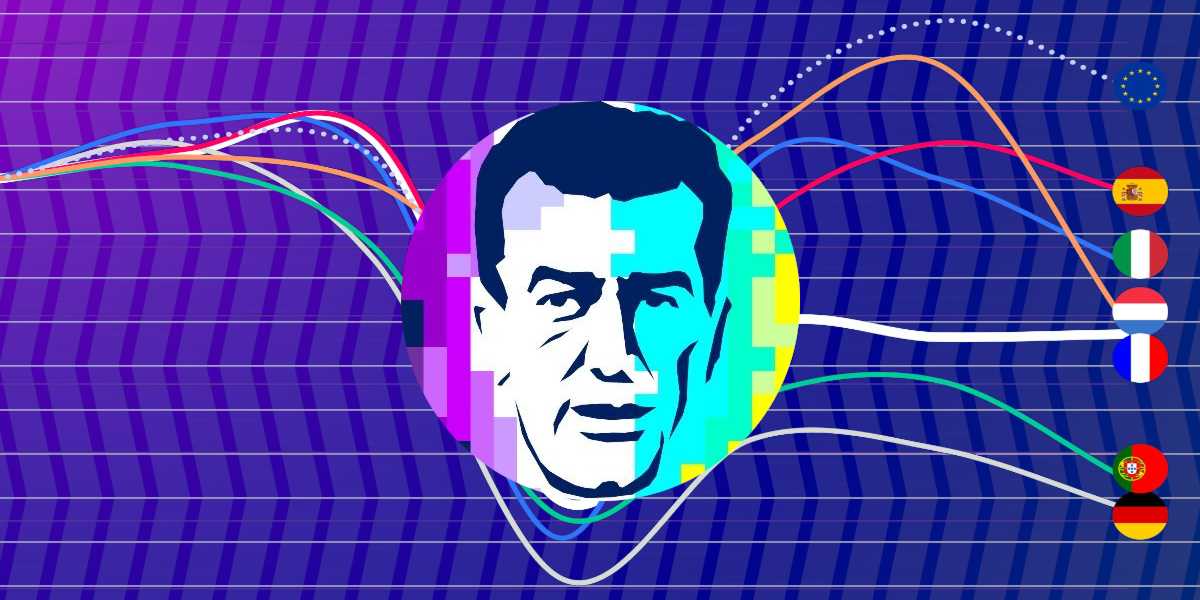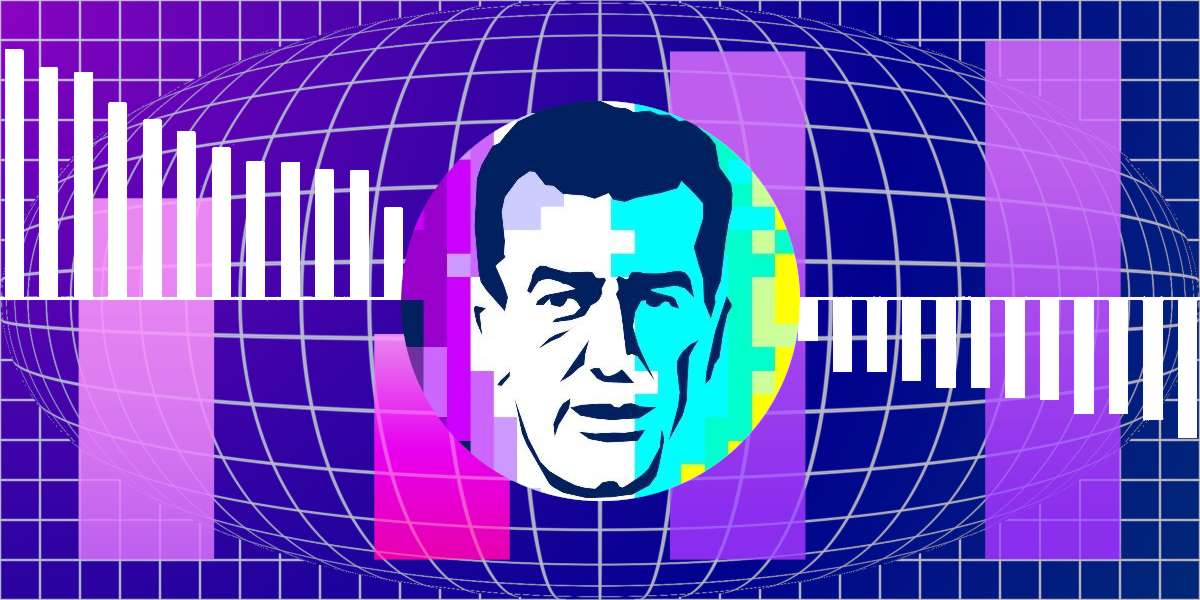Partir. S’éclipser. Fuir. S’exiler. Déguerpir. Ces mots clignotent dans ma tête, sur les réseaux, dans la bouche des jeunes, des fatigués, des rêveurs et des fâchés. Jamais une époque n’a donné autant envie de foutre le camp (sauf le XIVe siècle, peut-être, ou la chute de l’Empire romain). Il y a même des gars qui écrivent des bouquins pour expliquer comment faire. Frédéric Royer, par exemple, présente son Guide de l’exil ainsi :
Parce que la crise à quarante ans, parce que les jobs sont rares, parce que les grèves n’en finissent pas, parce que l’insécurité et le laxisme explosent, parce que les salaires sont bloqués, parce que la hiérarchie nous pèse, parce que les talents sont ignorés, parce que les boomers s’agrippent au pouvoir, parce que les banquiers sont frileux, parce que la paperasse nous étouffe, parce que le fisc nous étrangle, parce que les apparts sont trop chers, parce que Macron cafouille, parce que la déprime est contagieuse, parce qu’il pleut, parce qu’il fait froid, parce qu’on n’en peut plus de râler contre ce pays de râleurs… et parce qu’on a envie de se faire voir ailleurs, d’aller là où l’herbe est plus verte, le soleil plus présent et les rapports plus chaleureux.
C’est bien dégrossi mais c’est encore loin du compte. Est-ce que les bobos qui sautent dans l’avion dès qu’ils ont trois jours de congés éprouvent juste un besoin irrépressible de vomir leur alcool au petit matin sur les trottoirs de Barcelone, Amsterdam, Rome ou Berlin pour changer de Paris, Lyon, Nantes ou Bordeaux ? Ou cherchent-ils confusément autre chose ? Est-ce que les ambitieux, les mégalos, les rebelles, les aventuriers, les technolâtres et les béats croient sérieusement que l’Amérique de tous les possibles les attends encore, là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique ? Est-ce que les gus partis mourir en Syrie manquaient de soleil ? Est-ce que les garçons qui se verraient bien mercenaires en Ukraine souffrent de phobie administrative ? Et tout ceux qui écrivent sur Facebook ou Twitter, « J’en peux plus de la France. Je veux me casser à l’étranger. », qu’espèrent-ils trouver ailleurs, quand ils y seront ?
Tu as de la famille là-bas ? Des contacts professionnels ? Une compétence négociable ? L’expérience du pays ? Tu parles la langue au moins ? Tu ne parles pas leur langue ? Oh, punaise… Regarde au moins Wikipédia pour savoir où c’est, l’altitude, la pluviométrie, les températures extrêmes, le salaire moyen, la criminalité ordinaire, les maladies mal curables et les règles de l’immigration. Et le prix des billets aller et retour, au cas où tu voudrais voir ta mère à Noël.
Partir à l’étranger, pourquoi pas ? Mais s’installer ce n’est pas comme faire du tourisme. Un touriste c’est un compte en banque avec deux jambes, des mirettes émerveillées, une bouche et un trou du cul. Au yeux des locaux il n’a que deux qualités : 1. il dépense plein de fric, 2. il repart bientôt. Un expatrié est bien différent : 1. il veut rester longtemps, 2. s’il n’apporte pas une compétence extraordinaire il va piquer le boulot de quelqu’un, 3. s’il n’arrive pas avec sa propre femme il voudra en croquer quelques unes sur place. Résultat : tout le monde supporte les touristes, mais beaucoup moins les migrants. Oui, un expatrié est une sorte de migrant, avec juste plus de moyens et il arrive sec à l’aéroport plutôt que mouillé sur la plage. À l’étranger on est un étranger. Même si l’on a une apparence physique compatible avec les gens du coin, dès qu’on l’ouvre, on est manifestement exotique. Ça se résorbe avec le temps. On gagne en vocabulaire, on perd un peu son accent. On prend les manières du pays. On digère mieux la cuisine locale. Mais on reste un étranger, dans la tête de ses voisins et dans les fichiers de l’administration. Bien sûr on peut demander sa naturalisation. En général, les conditions sont moins commodes qu’en France. L’idée que les frontières c’est mal, la nationalité une simple histoire de papiers et qu’on peut baiser avec n’importe quelle fille du moment qu’elle est d’accord, ça vient de chez nous. La plus grande partie de l’humanité ne voit pas tout à fait la chose comme ça. Voire pas du tout. En tant que Français vous seriez bien avisé de la fermer sur la religion et la politique, même en Europe de l’ouest. Notre goût pour le profane et l’impertinence ne s’exporte pas très bien, savez-vous ?

Jusque-là, c’est facile. C’est le niveau de difficulté normal en période d’abondance économique et de stabilité politique. Problème : c’est la crise partout. Plus ou moins, mais plutôt plus que moins et ça n’est pas parti pour s’améliorer. Les ressources baissent, les déchets s’accumulent. C’est le résultat physiquement inévitable de la Révolution industrielle : on ne fabrique pas des biens et des services à gogo avec rien. Nous sommes désormais engagés dans le siècle du déclin. C’est pas de bol, mais vous n’aviez qu’à naître en 1950. Regardez les boomers, ils sont heureux… à leur manière. Avez-vous envie de leur ressembler ? Non ? Alors prenez notre époque comme elle est : la tempête de merde globale arrose bien plus que la France. Si l’on s’installe dans un pays, il faut s’attendre à y vivre des crises économiques et politiques. Dans les moments de scoumoune collective, les êtres humains ont tendance à chercher des responsables à leurs malheurs, et les gens perçus comme exogènes peuvent se retrouver promus malgré eux à la fonction de balle anti-stress. Parfois ils l’ont mérité, d’ailleurs, mais toujours moins que le gouvernement du pays. Ce dernier a généralement des cordons de policiers pour faire comprendre à ses administrés qu’il n’accepte pas les réclamations exprimées avec les mains. D’où le rôle très utile des étrangers pour déstresser les plus mécontents dans les périodes les plus merdiques. Bref, si vous voulez vous établir durablement dans un pays qui n’est pas le vôtre, tâchez de vous faire apprécier de tout le monde et de faire partie le plus possible du décor habituel. Vous marquerez des points supplémentaires si vous épousez une autochtone avec le consentement enthousiaste de toute sa famille et que vous lui faites des enfants. Ce sont eux qui vous sauveront le jour où les transplantés seront pris pour de mauvaises herbes. Vous le voyez bien : une nation ne se construit pas avec du papier, quoi qu’on en dise, mais avec du foutre.
Et pendant ce temps, en France…
J’avais un pays. Je croyais avoir un pays. Un coin du monde, une langue, une manière de vivre, une filiation. L’histoire de France n’était pas comme les autres histoires. Mes grands-parents y avaient joué leur tout petit rôle. Leur parents aussi, parfois très brièvement, laissant derrière eux une veuve, des orphelins et un nom gravé dans la pierre d’un monument aux morts. Et les parents de leurs parents de leurs parents avant eux, aussi loin que la mémoire collective portait. Jusqu’à la Révolution, jusqu’à Charlemagne, jusqu’à Astérix et Obélix. Jusqu’à Rahan, si ça se trouve. Et puis, ça a cessé. D’un coup.
Nous avions gagné la dernière guerre, mais en vrai nous l’avions perdue. La génération née avec la paix préféra les authentiques vainqueurs. L’abondance. La puissance. L’individualisme. Le sexe. Son héritage la dégoûtait : trop humble, trop rural, trop coincé. Chiant. Astreignant. Suspect. Ailleurs c’est forcément mieux. Même les pauvres de là-bas sont préférables aux pauvres d’ici. Ils ne discutent pas les conditions de travail. Ils ont ce teint qui rappelle les vacances. Comme on se sent bon et généreux de les traiter virtuellement en égaux ! Et comme il serait désagréable de reconnaître aux « perdants de la globalisation », ici, leur qualité de compatriotes ! Ils pensent mal, ils votent mal, ils ne voyagent pas ou si peu. Ils ne parlent même pas le globish, le sabir d’anglais que l’on peut entendre dans les sièges sociaux. La nation ? Pouah ! « Nous sommes tous des Européens, voyons ! Citoyens des États-Unis d’Europe. C’est formidable ! C’est le sens de l’histoire. C’est… c’est… ce qui transcende notre misérable condition de Français. La désindustrialisation ? Ce n’est qu’une optimisation de l’économie en fonction des forces et des faiblesses de chaque pays. La souveraineté ? Mais Monsieur, l’Europe, c’est la paix ! Vous n’avez qu’à voter aux européennes. Et puis nous sommes tous semblablement modernes, désormais. Épris de liberté, de progrès et de consommation. Quel conflit pourrait-il y avoir entre des peuples rénovés, réformés, quasi-identiques ? Le populisme, voilà le danger. Les pulsions rétrogrades. La grogne des inadaptés. Le national-passéïsme. Il nous faut juste plus de pédagogie et de bienveillance envers les irrationnels (pour oublier ces imbéciles en attendant qu’ils crèvent). »
C’est un mal français. Même si, dans l’ensemble des pays occidentaux, les diplômés du supérieur partagent plus ou moins les mêmes convictions globalistes et progressistes, nulle part en Europe je n’ai trouvé un niveau de dégoût de l’identité nationale tel qu’en France. Il paraît que cela vient de notre anthropologie familiale libertaire-égalitaire (selon Emmanuel Todd). Nous sommes tellement persuadés de l’universalité de l’Homme que nous ne voyons même pas à quel point cette croyance est spécifiquement française. Cette candeur nous a longtemps conféré une grande capacité d’intégrer les nouveaux venus dans la nation, et simultanément nous aveugle sur la fragilité de cette nation ouverte au contact de peuples qui différencient obstinément « eux » et « nous ».
Bref, tout fout le camp. Mes illusions surtout. Qu’est-ce que je fiche encore ici ? Pourquoi ne me suis-je pas expatrié ? Parce que j’aime mon pays, comme j’aime ma vieille mère toute ridée et gâteuse ? Pour contempler le désastre ? Pour connaître la suite de l’histoire, en espérant un rebondissement heureux ? Partout où j’irai, je resterai français. Ni le temps ni mes efforts ne peuvent changer ce qui m’a fait et me constituera jusqu’à ma mort. Tiens, justement, c’est peut-être ce qui pourrait m’encourager à partir : ici, je suis entouré de gens qui dédaignent leurs racines et me font me sentir quasiment étranger chez moi. Mais si je me transplantais — même dans un pays voisin — je serais tous les jours ramené à ma qualité de Français.
N’est-ce pas ce qu’espèrent secrètement les voyageurs frénétiques, en dépit de leur idéologie de dépassement des frontières ? Se trouver paré d’une identité collective déringardisé par la distance, qui leur confère ici un peu plus d’attrait aux yeux de leurs semblables sociologiques locaux, sur un marché sexuel planétaire plus absurde que jamais ? Baiser entre petits-bourgeois, bien sûr, mais avec un peu de piquant et d’étrangeté pas encore gommé par la monoculture mondiale. Être un peu plus qu’un individu. Avoir un tout petit plus de chance sur Tinder. Un rien plus de charme, sans effort, dans les soirées et dans les bars. « Juuu aime bioucoup les Fronçais. Tou est différente de zommes ici. » « Moi aussi. Je veux dire : les Françaises, pfff… Ras-le-bol ! Je préfère les filles comme toi. Tu me montres où on peut acheter des préservatifs ? J’ai envie de tout visiter. »
Quitter mes contemporains qui prétendent n’être rien. Les laisser à leur monde de centres commerciaux, d’aéroports et de parcs d’attractions. Habiter parmi un autre peuple — probablement aussi aliéné, mais au moins ce ne serait pas le mien ! À chaque phrase entendue ou prononcée dans une autre langue, à chaque perplexité face aux manières, coutumes et lois méconnues, à chaque repas composé selon les habitudes culinaires locales, à chaque promenade parmi une foule ethniquement différente (même dans un pays blanc, sur une grande collection d’individus, les différences morphologiques sont très perceptibles), à chaque maladresse culturelle et à chaque signe d’intérêt qui me serait accordé en raison de mon exotisme, je me sentirais français comme très rarement j’en ai l’occasion en France. Alors je retrouverais ma patrie là où elle est toujours vivante : en moi.