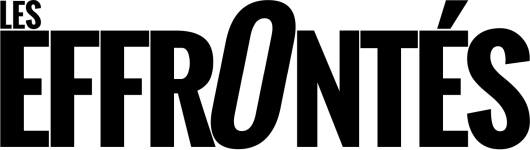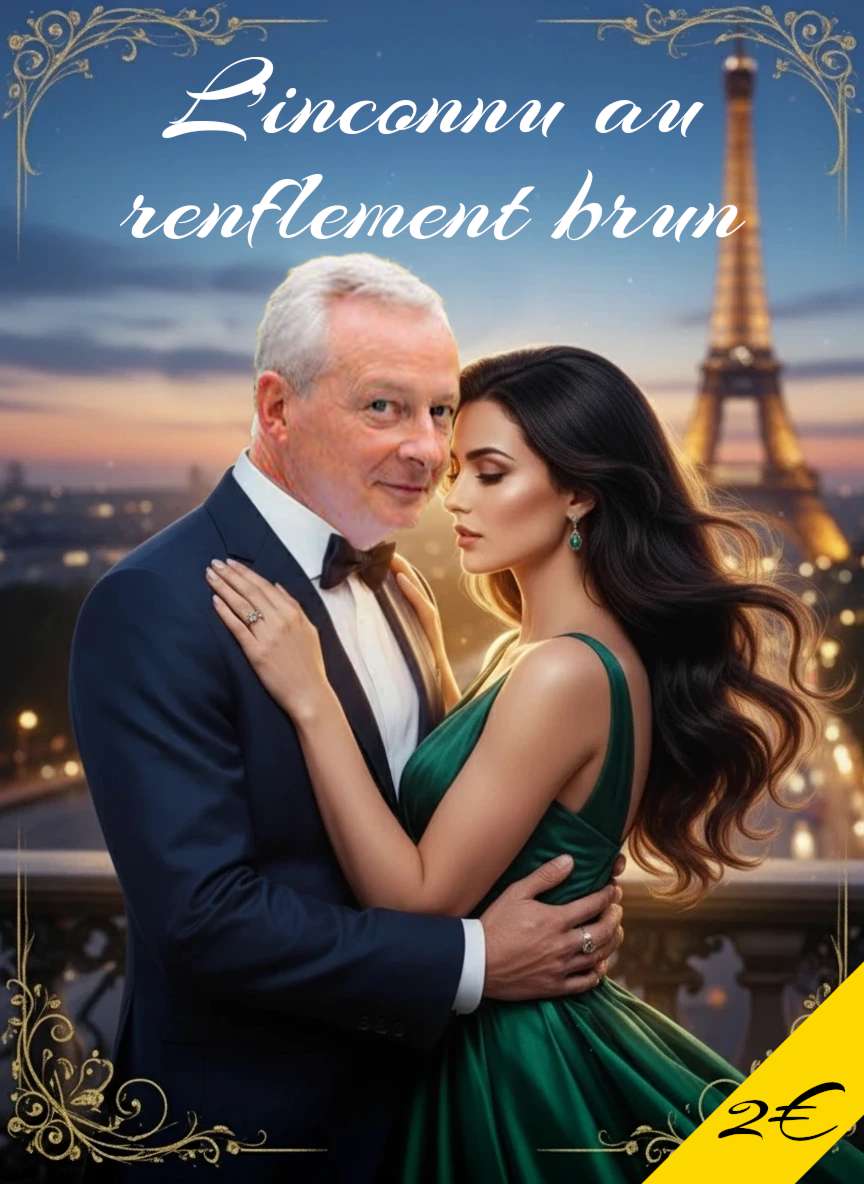(Suite de la première partie)
Un choix difficile (1982)
L’héroïne de cette nouvelle est mariée, mère et heureuse en famille. Pas de quête hypergamique ici, c’est déjà fait. Son problème est de concilier ses contraintes matrimoniales et maternelles avec un poste accaparant d’assistante de direction. Finis les personnages désuets de secrétaires sténodactylos ! C’est une « femme des années 80, mais femme jusqu’au bout des seins », disait la chanson. Je vous passe les détails, il y a peu à commenter dans ce récit sauf une chose : les magazines féminins jouent un rôle de coordination des comportements féminins (un peu comme les journaux économiques pour les cadres dirigeants ou la presse politique pour les militants). Ici, la façon dont l’héroïne se débrouille pour piloter son couple et faire ce qu’elle veut malgré les objections de son mari est un modèle pour toute lectrice aspirant à être une « femme libérée (tu sais, c’est pas si facile) ».
Cette fonction de formation d’une pensée collective existe aussi en filigrane dans les autres récits : à chaque époque, les héroïnes de romances sont conformes à ce que la pensée féminine considère comme la bonne façon de se comporter vis-à-vis des hommes : comment slalomer entre les gentils bêtas et les perdants têtus jusqu’à atteindre l’alpha, l’épouser puis le garder et en obtenir ce que l’on veut. Les romances et les articles des magazines fournissent, déjà assemblés et peints, les attitudes et éléments de langage dont les femmes ont besoin pour exercer leur rôle de sélectrices des mâles et recevoir d’eux la sécurité et l’aisance si nécessaires à la réussite de leur nichée. Cette pensée grégaire a certainement été très efficace tout au long de l’histoire de l’humanité. Mais à voir ce qu’elle produit désormais de solitude, de dénatalité et finalement d’appauvrissement, il semble que le troupeau ait suivi les mauvaises brebis jusqu’à la falaise. Bien sûr, c’est de la faute des bergers. Qui d’autre pourrait être responsable ? Bêêê !
Un cosaque à Paris (1996)
Quelques années plus tôt, il aurait été difficile d’écrire une romance attrayante impliquant un ressortissant d’Union soviétique. Mais, en 1996, l’URSS a déjà disparu et la Russie se jette dans l’économie de marché comme un clochard affamé sur un buffet à volonté. En tout cas, c’était l’idée qui circulait en Occident, bien que la réalité ait été plus sordide sur le terrain.
Dans cette nouvelle, l’héroïne, Françoise, accueille à Roissy un client Russe venu signer un contrat d’importation de matériel informatique. Au lieu d’un oligarque joufflu et grisonnant, c’est un séduisant jeune homme qui descend de l’avion. Déluré, voire fripon, Serguei est manifestement venu pour le plaisir au moins autant que pour les affaires. Un quiproquo s’ensuit…
— Je vous retrouverai demain un peu avant l’heure de votre rendez-vous. Profitez de votre journée pour visiter Paris.
— Pas question ! protesta-t-il. Vous ne me quittez pas. Vous êtes payée pour m’être agréable.
Elle freina brusquement et tourna vers lui un visage rouge de colère.
— Je suis payée pour quoi ?
— Être gentille. Oh que j’aime la France et les Françaises ! […]
— Vous m’avez prise pour une call-girl ?
Étouffé par son rire, Serguei hocha la tête. Elle précipita sur lui, poings serrés.
— Vous êtes un goujat ! […]
— Je m’excuse, répéta-t-il, je suis réellement désolé mais à cause de vous, j’ai raté la jeune femme qui devait me tenir compagnie.
— Dehors, hurla-t-elle, livide.
Il s’exécuta, pris de fou rire et, avant de disparaître dans le hall du George V, il lui lança :
— Pour me faire pardonner, je vous invite à dîner.
Si vous racontez une histoire comme ça sur les réseaux, des escouades de chevaliers blancs vous attaqueront avec leurs petites épées en plastique : « Dame le veult ! Soumets-toi, abjecte misogyne ! Nulle femme ne s’éprendra de tes manières ignobles, répugnant suborneur. Genoux en terre devant la Beauté, la Grâce et la Douceur du Sexe Sacré. Moi, Kevin Dupuceau, chevalier à la lance précoce, je fais serment de protéger toute la divine féminité de tes assauts grossiers et lubriques ! Ce n’est point ainsi que l’on se peut faire aimer d’une femme, infâme corrupteur sans pudeur. Il faut ménager sa délicatesse, son innocence, sa pureté ; servir avec zèle ses moindres besoins dans le désintéressement absolu et la chasteté ; surtout ne point laisser voir de pensées concupiscentes, ne même pas les penser… d’ailleurs je n’y pense pas, non, je n’y pense pas. » Ah, si ces braves garçons faisaient une cure de romances ! Peut-être leurs paupières collées depuis l’enfance s’ouvriraient-elles enfin ? L’homme désirable est culotté, entreprenant, coquin, dominant, actif… Comment pourrait-on s’éprendre d’un timide poltron, prêt à se transformer en carpette d’honneur sous les pieds de la femme qu’il désire et de son mari tout neuf au matin de leurs noces ? (Pour ensuite sangloter et se branler frénétiquement en essayant de ne pas penser à ce qu’elle donne à l’autre pendant la nuit.)
Ce que vient de faire Serguei, c’est ce que les séducteurs méthodiques appellent un « neg » — un compliment négatif. En confondant Françoise avec une professionnelle de la galipette de luxe, il la fait descendre du piédestal où la plupart des hommes placent automatiquement les femmes, tout en la valorisant en tant qu’être sexuel (« Vous êtes trop jolie pour être une simple femme d’affaire ») et en se posant lui même comme un être de désir. Un haut degré d’assurance est, en soi, une preuve d’expérience avec les femmes, donc de validation par d’autres femmes.
Mais revenons à Serguei : il veut ce dîner.
— Ne refusez pas, vous me vexeriez et, croyez-moi, traiter une affaire avec un Russe vexé n’est pas chose aisée.
Il osait faire du chantage ! Son regard transperçait Françoise. Elle voulut s’esquiver, mais il tendit la main, prit son bras et la retourna vers lui sans effort.
— Faisons la paix. Juste un dîner !
Elle le regarda droit dans les yeux.
— D’accord, mais soyez certain que je profiterai de ce repas pour vous parler de tous nos ordinateurs.
— Et je vous promets de vous écouter bien sagement.
Ce qu’il ne fit pas, l’interrompant sans cesse pour lui poser des questions sur la vie à Paris, prenant un malin plaisir à la troubler par ses sourires, ses longs regards
Voyez comme Serguei sait souffler le froid et le chaud, ne craint pas le contact physique et ne perd jamais de vue son but et sa qualité d’être sexuel. Françoise joue la froideur… pour mieux accepter. Ils finissent le repas au champagne et là, le beau Serguei se montre très, très habile :
— Je suis navré pour ce matin. L’idée de la call-girl vient de mon père, afin de me convaincre de venir à Paris. Personnellement, je n’aime guère le monde des affaires. Si j’avais eu le choix de mon avenir, au lieu de vendre des composants électroniques, j’aurais préféré élever des chevaux. Mais quoi qu’il en soit, je suis condamné à m’occuper des affaires de mon père.
C’est pas génial ça ? La gaudriole du matin… c’est la faute à papa ! Et puis Serguei n’aime pas l’argent et le pouvoir… c’est vraiment pas de chance qu’il en ait ! Serguei rêve de monter fougueusement ses chevaux dans la lumière du soleil couchant… Et, manifestement, toute autre créature agréable à chevaucher. Quelle vie serait la plus désirable pour Françoise ? Cadre commerciale dans une boite d’informatique à Paris ou épouse d’un audacieux, charmant et riche éleveur de chevaux ? Elle fond intérieurement pour cette potentialité… mais s’éclipse en taxi (après une étreinte excitante) pour ne pas coucher le premier soir. N’importe quel pêcheur vous le dira : il faut s’assurer que le poisson est bien accroché avant de le tirer hors de l’eau.
Le lendemain Serguei vient signer le contrat dans les locaux de la boite de Françoise. Bien sûr, elle fait des simagrées et son hamster pique un sprint dans son crâne. La signature se passe très professionnellement et le Russe disparaît aussitôt en déclinant la tournée de champagne prévue pour fêter l’accord. Quelques phrases plus tard, le téléphone sonne : c’est lui, qui l’invite à venir prendre un verre entre quatre yeux. Ici, je vais ouvrir une importante parenthèse.
Une plainte récurrente chez les volincels (volontairement célibataires involontaires), c’est la possibilité (toute théorique) d’être accusé par une femme de turpitudes pénalement répréhensibles s’il leur prenait l’audace de draguer ou de flirter. La crainte d’être condamnés et jetés dans une geôle insalubre en compagnie d’individus patibulaires les regardant avec concupiscence justifie amplement — à les entendre — de ne jamais adresser la parole à une femelle humaine de moins de 60 ans, et de s’en tenir toujours à distance de sécurité, comme sur l’autoroute (73 mètres ou deux bandes blanches). Rien ne les fera changer d’avis tant qu’on ne leur fournira pas une garantie formelle de non-poursuite judiciaire durant toute interaction sociale avec des femmes. Autrement dit : ils sont dans le même délire angoissé que les féministes qui préconisent une contractualisation intégrale des relations intimes. Et ils raisonnent mal : aucune promesse, même formalisée, ne peut vous garantir contre le ressentiment de quelqu’un qui vous en veut. La bonne question n’est pas « Est-elle prête à signer un papelard ? » mais plutôt « Est-elle prête à me sauter sur la bite avec joie ? ». Et c’est justement ce que Serguei veut savoir. C’est pour cela que, sitôt l’entrevue professionnelle finie, il met un vent à Françoise et son patron, puis la rappelle et l’invite à venir le rejoindre au bar du George V. Soit elle n’est pas si chaude que ça et c’est tant pis pour elle — il y a tant d’autres filles ! Soit elle a vraiment envie de lui et elle est obligée de saisir cette ultime occasion sous peine de ne jamais le revoir.
Elle vient ! Il se lance dans l’escalade sexuelle, assuré qu’elle n’attend que ça. Il lui promet l’amour parce que c’est une romance, mais ce genre de déclarations enflammées vous servira tout aussi bien dans la vraie vie. Et il l’emporte vers le lit dans ses bras musclés (ne courtisez jamais une femme que vous ne pourriez pas soulever). En résumé : une femme ne vous en voudra jamais de réaliser son désir. Vous avez juste besoin de vous assurer qu’elle a bien du désir en testant sa « compliance » et en vous moquant de ses « shit-tests ». En bref :
Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l’occasion, mais jamais à celui qui la manque.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
Confession d’un séducteur (2003)
Dans cette nouvelle, comme dans la toute première, le narrateur est un homme. Cette fois, je me méfie : il sera sûrement le perdant de l’histoire. Même en empruntant le point de vue d’un personnage masculin, une romance reste au service des fantasmes féminins, exclusivement. L’héroïne, Élise, a 24 ans qui équivalent sans doute aux 18 ans des héroïnes des années 1950-60-70. Tandis que la majorité civile est passé de 21 à 18 ans en 1974, l’âge idéal pour les femmes semble avoir suivi un mouvement inverse. 18 ans, c’est désormais trop tôt pour commencer sérieusement la quête de l’alpha. Et même 24 ans, c’est encore trop précoce pour se fixer, selon l’inconscient collectif de ce début de XXIe siècle — nous allons le voir dans ce récit. Bon, et le couillon, qui est-il ? Il s’appelle David et a monté une petite agence de pub avec ses copains « d’une grande école de commerce ». Il s’occupe des castings. Élise est comédienne, mais temporairement. Son véritable but est d’être scénariste. Les pubs, c’est juste un boulot pour rentrer de l’argent en attendant de réussir. Elle est plutôt quelconque, mais le narrateur est séduit sans bien savoir pourquoi :
Elle insista :
— Oui ou non ?
Je faillis répondre non, la chasser, mais brutalement, quelque chose dans son visage me frappa, vous dire exactement quoi, je ne sais toujours pas. Une impression générale, une douceur inattendue, un petit rien différent des autres visages féminins souvent plus parfaits que celui d’Élise.
Les lectrices des romances sont très majoritairement des filles quelconques rêvant d’être plus désirables que les autres aux yeux de l’alpha quand il se présentera. Moquez-vous si vous voulez, mais ce n’est pas plus ridicule que les scénarios des films pornographiques qui alimentent l’espoir des plombiers, des livreurs et des laveurs de piscine de séduire instantanément une ravissante épouse esseulée. Il paraît que cela arrive parfois, dans la réalité, si l’on est assez souple sur la définition de « ravissante ».
David recrute Élise pour un premier tournage, puis un deuxième. Ils font connaissance, mais pas sur le mode aimable et réservé des anciennes romances. En 2003, on se doit d’être cash et désabusé.
— Et si moi, j’avais envie de vous connaître…
D’ordinaire, ce genre de réplique fonctionnait, pas avec elle.
— Soyons directs. Vous avez une soirée à tuer et vous pensez : « Pourquoi pas cette fille, après tout ? Elle me doit deux contrats, deux chèques qui lui ont permis de payer son loyer et d’améliorer son régime sandwich. »
J’aurais pu protester, jouer le monsieur indigné, j’éclatai de rire.
— Un point pour vous.
Voilà les relations blasées telles que les imaginaient déjà les lectrices des années 2000. On est loin des conversations charmantes de (par exemple) la nouvelle de 1971 :
— N’êtes vous pas un peu misogyne ?
— Pas du tout. Je vous invite à dîner uniquement parce que vous me plaisez et que je désire mieux vous connaître.
— Dans ce cas, murmurai-je, joignant les mains comme une fillette à laquelle on vient de faire un beau cadeau, je vous remercie infiniment.
Même situation, même jeu de tu-veux-ou-tu-veux-pas, mais sans l’âpreté maussade. Ils papotent un peu : elle sort d’un « amour fou » qui s’est barré ; lui n’a jamais été « réellement amoureux ». Il la raccompagne en voiture ; elle lui propose de monter prendre un dernier verre. Elle habite dans une studette bordélique. Whisky dans un rare verre propre, baiser (substantif) puis baiser (verbe) sur la moquette. Tout cela était inconcevable dans les romances anciennes ! Nous sommes entrés dans l’air du rapide, sale et sans attachement.
Quelques jours plus tard, elle l’appelle pour lui raconter que son scénario est accepté quelque part. Il a envie de la voir, envie d’y croire.
Elle resta stoïque, indifférente, dégustant avec délice son cacao. Une folle envie de la gifler s’empara de moi. Elle me jeta un regard distrait par-dessus la tasse.
— Ce soir, chez toi ou chez moi ?
Je me levai en sursaut…
— Nulle part. J’ai mieux à faire.
Attitude de personnage féminin autrefois, désormais attribué à l’homme et ringardisé. Et ensuite ? Dînette chez elle. Bavardage.
— Là, je suis tombée sur Christophe et tu connais la suite…
J’osai d’une voix tendre :
— La suite, c’est moi.
Aussitôt, je regrettai ma réplique, elle s’écarta, m’offrit une figure chagrine et annonça d’un ton sec :
— Non, toi, tu n’es qu’un intermède, une façon charmante de me venger de l’autre.
Apparemment, c’est une révolution, cette inversion des attitudes traditionnelles. Mais a bien y regarder, le schéma fondamental demeure : le féminin est infiniment préoccupé par la façon dont les relations se nouent : tensions, incertitudes, sélection (de l’homme)… Comme c’est excitant ! Pour réussir cette recomposition artificielle des rôles tout en préservant la dynamique relationnelle si centrale dans l’érotisme féminin, il faudrait que les hommes y mettent du leur. Mais comme ils ne sont pas au courant que l’aimable comédie de l’accouplement humain est devenue un brutal théâtre d’avant-garde, et comme leur érotisme propre ne les entraîne nullement vers de telles préoccupations, il y a bien peu de chance qu’ils jouent leur rôle correctement, sur le modèle du personnage de David. Du reste, pourquoi voudraient-ils le jouer ? Il n’y a rien de séduisant pour un homme à voir ses sentiments flétris par une fille se comportant comme un garçon mal élevé.
Ils baisent de temps en temps. Ils sont le plan cul l’un de l’autre, irrégulièrement. Un jour elle part « préparer son film » et ne reviendra plus, pour cause de carrière, comme un connard. Inversion, inversion… Les femmes ne se rendent pas compte de la difficulté dans laquelle elles ont sauté à pieds joints : être l’homme à la place de l’homme. Bosser comme un homme, réussir comme un homme, baiser comme un homme (avec ou sans homme), puis faire entrer leur vie de femme dans une toute petite période et tasser du talon pour qu’elle y rentre.
David reste avec ses regrets. Comme pressenti, son rôle était d’être le perdant et de mettre en valeur le personnage d’Élise, l’héroïne qui réussit tout : carrière, séduction, sexualité… Mais femme tout de même car, dans le monde onirique de l’inconscient féminin, tout est possible et le temps ne compte pas. Un jour, David voit le film d’Élise à la télévision. Il a encore son numéro ; il l’appelle. Un homme décroche. Elle a trouvé l’alpha, sans doute. C’est le programme exténuant auxquelles se sont assignées les femmes modernes : être tout ce que sont les hommes en plus d’être tout ce que sont les femmes, sans compromis, sans dépendance, sans se fermer aucune option, tout en obtenant le bébé et l’alpha avant le déclin de leur fertilité. Dans les romances, ça marche toujours ; dans la réalité, rarement.
La fin est tout à fait consternante : le rôle de l’homme rejeté est bien sûr de continuer à servir docilement l’impératif féminin :
J’étais en manque d’amour, [Catherine] se laissa aimer, osa m’imposer des règles alors qu’Élise ne l’avait jamais fait. Je me pris au jeu de la tendresse rassurante et, un an plus tard, je lui proposai le mariage. Demain en l’occurrence.
Élise ne m’aimait pas réellement, pourtant c’est à elle que je dois ce besoin d’amour qui, demain, fera de moi un homme marié, c’est à elle aussi que je dois mes plus tendres souvenirs.
Élise ? Catherine ? Toutes les lectrices de Nous deux ? Allez-vous faire foutre !