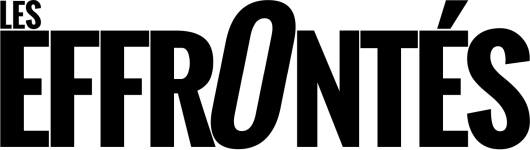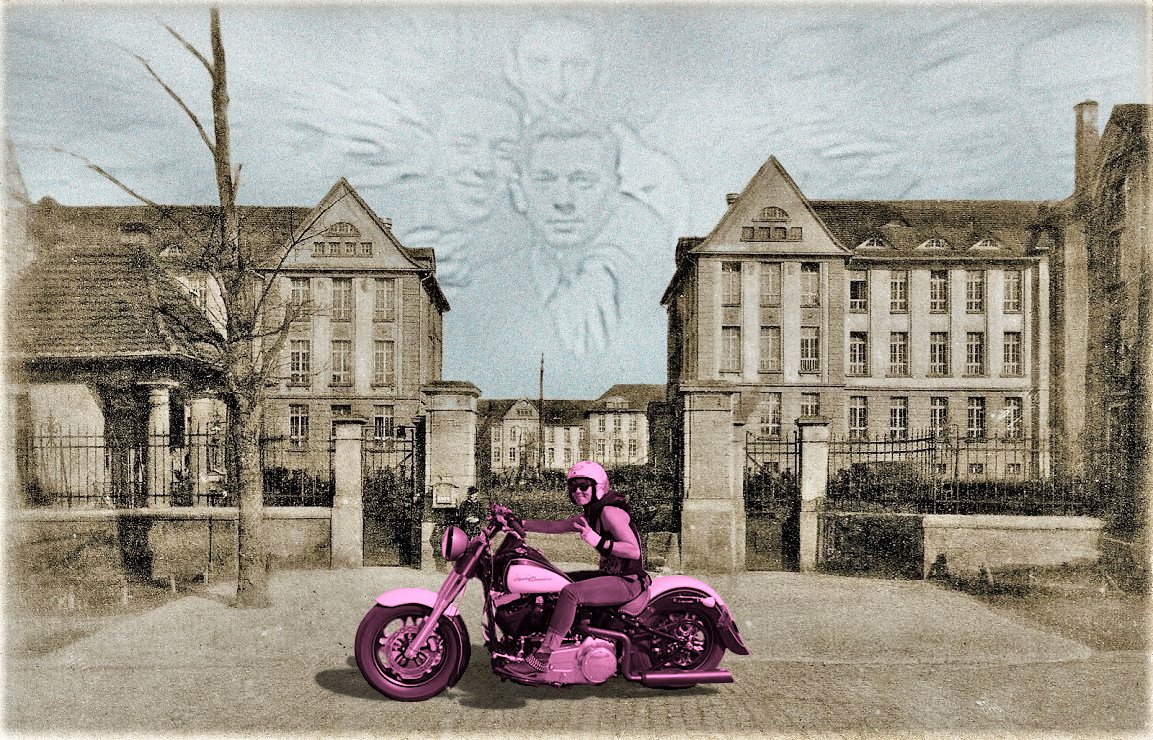XIV
Il y avait aussi ce mec… interné dans l’aile civile du département de psychiatrie. Il ne portait pas le pyjama de taulard miteux qu’on nous avait refilé, mais de simples vêtements de tous les jours, un pantalon de toile et un polo marron. C’était lui le dealer. Car disons-le, j’ai pu découvrir à cette occasion qu’interdire l’alcool était le meilleur moyen de favoriser une économie grise.
Donc nous fumions à longueur de journée, à défaut de pouvoir nous bourrer la gueule légalement. Le matin, dès la fin du petit déjeuner, jusqu’au soir. Pétard sur pétard, ça tournait. Il n’était pas rare d’en avoir un dans chaque main tellement ça s’enchaînait. Serial roller était un grade envié dans cette hiérarchie parallèle.
Nous avions découvert, au gré de nos pérégrinations confinées, l’ancienne morgue du centre hospitalier. C’était un bâtiment ouvert à tous vents et situé à l’écart, au sommet d’une colline arborée. C’était quatre murs datant du siècle précédent et un toit de tuiles. Agis par je ne sais quel motif étrange, nous voulions le plaisir de fumer parmi les carreaux cassés et les armoires vides. Quand l’un d’entre nous, avisant les frigos mortuaires, sans remarquer le ronronnement régulier du compresseur d’air froid, entreprit d’en ouvrir les portes une à une.
Un cadavre nous attendait derrière la deuxième. Les pieds à 10h10 d’une vieille crevée nous ont sautés à la gueule. Nous avons refermé le panneau métallique et nous sommes précipités dehors, blancs comme des drapeaux d’armistice. Assis par terre nous avons repris notre souffle, puis un mec a dit : « Qui roule maintenant ? »
XV
J’ai eu Mino au téléphone. « J’ai tout dit à Manu » a-t-elle commencé, suivi d’un long silence et de la tonalité. J’étais là depuis trois jours, la succession ininterrompue de défonce avec des personnes à qui, en temps normal, tu ne dirais pas bonjour pour la bonne et simple raison que la probabilité de les croiser sur ton orbite est proche de rien, l’attente de cette putain de commission de réforme qui doit statuer sur ton retour – de deux choses l’une : chez toi ou à la caserne – le temps immobile entre deux repas et une douzaine de barjots estampillés plus vrais que nature… je commençais à avoir peur de finir tout comme !
D’ordinaire quand j’ai un petit bleu au cœur, je sors, je marche – jusqu’à peu, je picolais – je saoule mes potesses avec mes questions sur les filles. Je tue le temps à coup de pourquoi ? Et pourquoi moi ?
Mon voisin de chambre – l’allemand alcoolique – était parti, remplacé par le survivant de Mourmelon. On n’avait rien à se dire. Je suis allé faire un tour à l’atelier d’art-thérapie. Là, on pouvait peindre, modeler de la terre glaise, dessiner, écrire… Les déjà réformés avaient laissé leurs œuvres. Cette galerie avait un nom : P4 !
Ce statut était notre green card, le sésame pour le retour à la maison. Être classé quatrième, avant-dernier échelon, d’une classification sommaire était notre but : Adaptation définitivement incompatible avec la poursuite du service militaire.
XVI
Vendredi ! On y était ! Un vent aimable froissait les arbres du parc, nous étions à la mi-juin et les heures du matin oriental devenaient moins fraîches ; à Metz maintenant, on pouvait fumer sans veste et finir son bol de café clair à l’extérieur. Quel plaisir de trouver devant les portes de nos chambres le lave-pont et le seau réglementaire ! La quille ! Pas véritablement celle des conscrits après trente-six mois en Algérie, ou celle des appelés du contingent de retour d’Allemagne, mais c’était la nôtre, les P4 – « la quille bordel ! » –, un bout de bois imaginaire qui fera bien l’affaire.
Après deux heures, les draps en tas devant chacune, nous avions terminé de briquer les turnes. On bavardait de choses et d’autres… « Tu rentres comment ? » « Ma meuf vient me chercher. » « Tu feras quoi en premier ? » Mec, on en était presque à s’échanger nos adresses ! Quand une sale rumeur a commencé à circuler, remontant les couloirs comme une averse normande remonte la Seine pour dessaler les rues de Paris et décoiffer les toits. De bouche en oreille, transmise et répétée, commentée. La commission de réforme, un aréopage de médecins et de troufions à galons qui tamponnait à la chaîne des ordres de renvoi, ce dernier rempart avant notre liberté, la putain de commission spéciale de réforme du vendredi ! qui méritait ce qualificatif de « spéciale » car elle ne se réunissait qu’en cas de coup de feu, c’est-à-dire pendant la période des classes… ben… elle avait été annulée.
XVII
Le week-end commençait, il me restait assez de tabac pour tenir jusqu’à dimanche, peut-être lundi. Je retournais mes poches, j’avais quelques sous, des francs et je me précipitais à la cafeteria. J’achetais un paquet de cigarettes, en me serrant la ceinture, je pouvais voir venir, pas plus. Il fallait impérativement que la commission habituelle du mercredi ait bien lieu, comme convenu. J’ai quémandé un coup de fil au secrétariat pour prévenir mon père de ne pas venir me chercher. J’ai demandé des nouvelles de ma mère. J’ai voulu parler à ma sœur, mais on me faisait signe que le service avait assez duré. Un aspirant carabin s’est approché d’une démarche traînante : « Tu vas aller refaire ton lit, ça va t’occuper » avant de me tourner le dos et de rejoindre les autres gradés attablés autour d’un café.
On s’agitait dans les autres bâtiments, les bras cassés, les pieds en vrac, les découpés du ventre, les couronnés de la molaire, les augmentés de la bite, les traumatisés transportables… tous ceux qui n’étaient pas en pyjama mais en jogging se préparaient à partir chez eux. Les règles de la caserne s’appliquaient, ils étaient en permission. À partir de là, l’hôpital s’est vidé et l’horloge s’est arrêtée brusquement, BAM ! Stoppée net ! C’était un Big Bang à l’envers. L’espace s’est contracté, tout racorni comme une peau d’orange dans le frigo, entraînant dans sa chute toutes les autres dimensions, le temps, les amis et l’amour, accablés au centre du grand trou noir avec, tout mélangés et repliés en pelote, mon cœur solitaire.
XVIII
De ces cinq jours, il ne m’est rien resté. Tendu jusqu’à l’extrême, le temps fini par se briser. Sans lui, pas d’événements auxquels se raccrocher, pas de souvenirs à suspendre aux murs de la mémoire. Deux décennies se sont écoulées, ma mère est morte et Manu ne m’a plus parlé pendant quinze ans. Je n’ai jamais eu de nouvelles de Mino. Où est-elle ? Que fait-elle ?
Dans un film français, être réformé pour chagrin d’amour, ça a de la gueule. Mais je n’aime pas le cinéma. Précisons, je n’aime pas aller au cinéma, m’asseoir dans le noir… être confiné entre pop-corn et films d’auteurs pendant deux heures, je n’y arrive plus. Je veux pouvoir appuyer sur la barre d’espace, voir la timeline se figer, partir quand je le souhaite.
Le vieux cheval connaît le chemin…
Je suis rentré chez moi par le train de midi.
Le hall défraîchi de cette gare sans apprêt de la ligne de Sceau n’avait pas changé en mon absence. Devant moi, légèrement sur la gauche, les trois bancs de bois sombres et vernis, bien alignés contre le mur et le présentoir portant les horaires de la ligne, m’attendaient et me saluaient d’un auguste garde-à-vous. Ne serait-ce le distributeur de confiseries, avec ses couleurs acides et ses néons criards, rien ne pouvait altérer l’élégance désuète de mes souvenirs. Sur le parvis, un sourire las a déplié mon visage froissé… Personne ne m’attendait. « Qu’est-ce qui change quand rien ne change ? » me suis-je demandé.