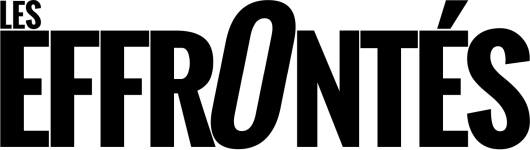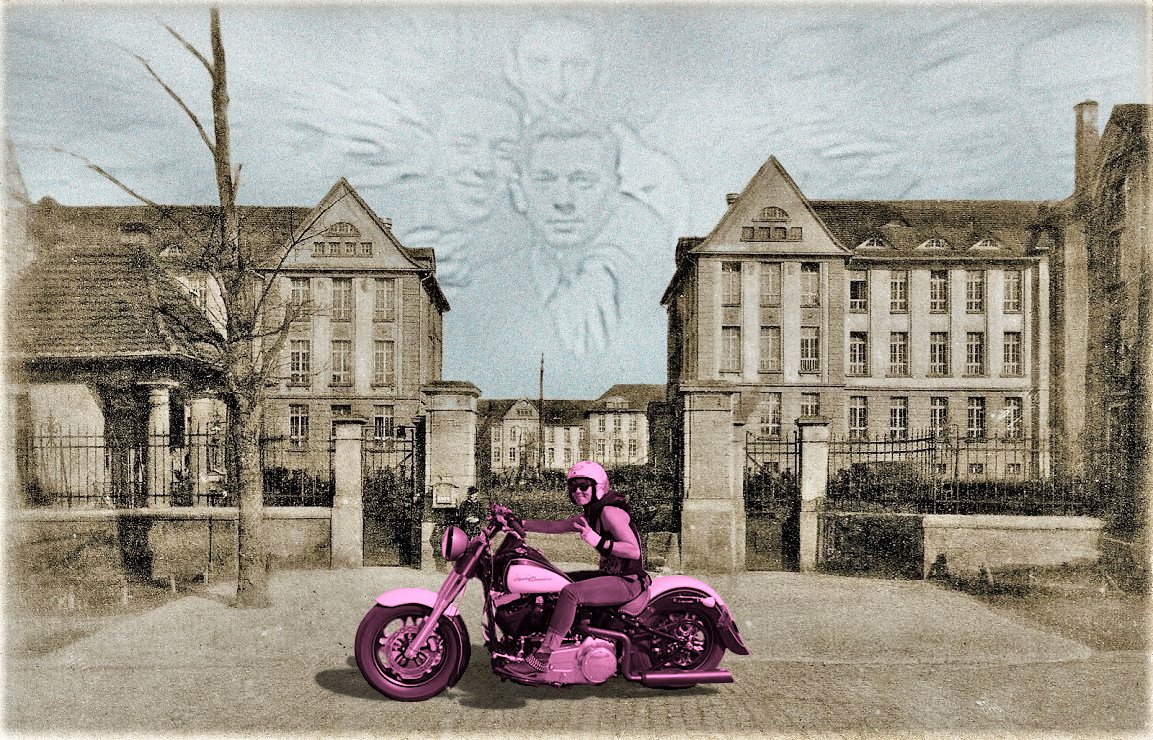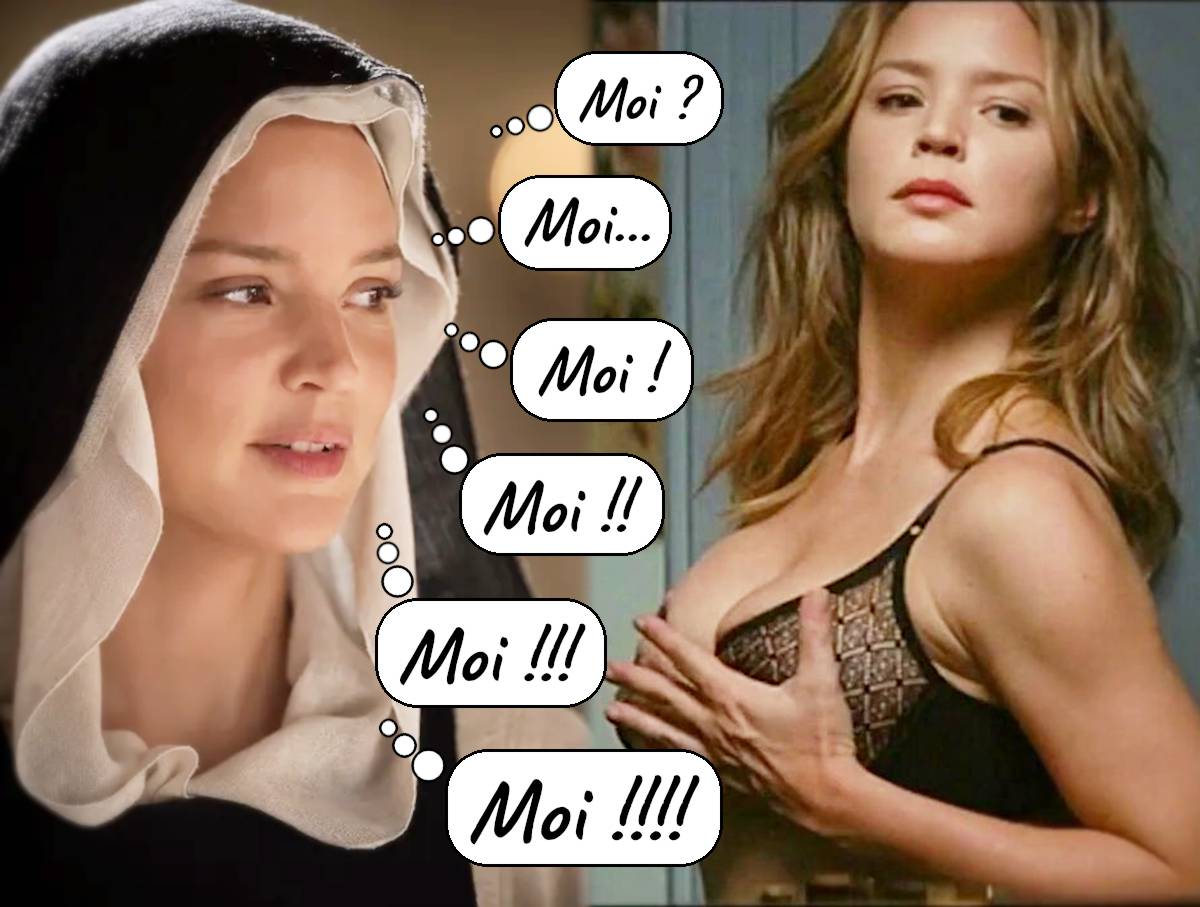VII
Je me suis promené dans la ville, ni touriste, ni étranger. Devant moi un couple s’embrassait en riant. Ils avaient la vingtaine. Blonds, les cheveux bouclés, la peau trop blanche, de celles qui détestent le soleil. Ils venaient d’un pays froid, un pays où le mélange est une affaire de céréales. Je sirotais ma bière en les regardant. Ils se sont levés au bout de quelques minutes pour aller s’embrasser ailleurs. J’avais faim. Le soir, de retour à la caserne, je me suis arrêté à nouveau pour un verre. Le pub était plein et un groupe jouait des reprises des Beatles. Un mec s’est approché de moi, un lourd de la visière avec des yeux de rats et un visage en triangle. Il croyait qu’on était du même bord parce qu’on était du même côté du bar. Attention ! Je suis un boit-sans-soif mais pas un poivrot, pas une outre-à-vin, je ne suis pas un licheur ou un tète-boutanche. Je sais me tenir et personne ne m’a vu étaler ma tripaille sur le sofa. Je ne finis pas les bouteilles, je les ouvre. Je ne bois pas pour me faire des amis ou pour noyer mon chagrin, je bois parce que je suis lâche et que pour en finir sans se faire mal, c’est ce qu’on fait de mieux. Je bois parce que je sais depuis longtemps que je ne veux plus en être. Je n’ai pas le courage de franchir le parapet ou de me mettre la tête au four. Alors je me prépare. Le jour venu, j’augmenterai la dose, juste un peu, et un organe se mettra en carafe. Le cœur, le foie, qu’importe. Je bois par dégoût.
VIII
Alors quand l’éponge de Moselle m’entreprend en me parlant de sa copine, de son boulot et de toutes ces choses que racontent les poivrots, j’ai vu rouge. J’ai attrapé visage-de-fouine par le sac à boule et j’ai serré bien fort. Son pif a viré à l’orage et j’ai vu dans ses yeux un éclair et l’envie de rester parmi les gens encore un peu, une brève étincelle. Il est parti sans un mot. L’alcool est la drogue des faibles.
J’ai passé la semaine sans redescendre ; 1,5 gramme par litre minimum, un fonds de roulement. Le vendredi soir j’ai pris le train. Mino devait m’attendre à la gare. Elle était là au bout du quai n° 7, au milieu des bidasses qui ne la remarquaient même pas. Je suis descendu le dernier. Elle était comme un clou sur une planche. Je lui étais reconnaissant d’être venue me chercher. J’ai eu d’un coup très envie d’elle.
Il commençait à se faire tard. Le parvis était recouvert de militaires. Devant nous le roadster rose tranchait avec la marée vert-kaki. Elle m’a tendu un casque. Elle a incliné la tête, elle paraissait désolée. Je n’avais jamais remarqué ses yeux. D’un marron très clair, mais assombris par des sourcils en bataille et un teint mat. Il était difficile de se faire une idée. Elle était d’une beauté timide, écorchée par endroit. Sous son blouson de cuir renforcé, elle portait un bustier de cotonnade, une attention touchante et ridicule, Mino était plate comme un jeune garçon. « Côté sein, je tiens de mon père » me dira-t-elle plus tard après l’amour.
IX
Je suis monté sur sa moto. Il y avait ce bruit de remorqueur que font tous les v-twins, ce son sourd et sournois comme un diesel de marine. Il y avait ce rose d’un autre lieu, celui d’une suite de Las-Vegas et il y avait Mino et moi, qui faisait trois têtes de plus qu’elle et qui même à l’arrière pouvait conduire à sa place. Elle gardait une maison d’amis à Malakoff. Un pavillon avec un petit escalier pour entrer, protégé par une marquise en fer forgé. Nous n’avons rien dit et nous sommes allés directement à la salle d’eau. Elle nous a fait couler un bain et nous nous sommes enfin embrassés. Ça n’était pas un baiser, ou un patin, une gamelle ou un bisou. C’était un verre d’alcool fort que l’on boit cul-sec pour montrer à l’autre qu’on en est un aussi. Une vodka artisanale et à bonne température qui se boit à la russe : dans un sauna pour éliminer et entrecoupée de cornichons au vinaigre pour boire plus. Elle avait un corps magnifique, vraiment. Souple et tendu, les muscles fuselés, délicatement posés sur une ossature fragile. Elle était légère comme une brume d’automne. Je l’ai portée jusqu’à la baignoire tout en embrassant sa poitrine d’homme. Je l’ai prise comme on sauve un gaillard de la noyade, frémissant et reconnaissant. Sa bouche avait le goût âcre des regrets et l’âpreté des vies parallèles qui ne se rencontrent jamais que dans le lointain. Je suis tombé amoureux d’elle pour ça, parce que je ne la connaissais pas, parce que cela n’était pas possible et qu’après cette nuit, il n’y en aurait pas d’autre.
X
Le lendemain, je suis allé dormir chez mes parents. Ma mère était assise sur son bout de canapé, à sa place habituelle, le chat de gouttière en boule sur les genoux. Un chat sans nom que mon père avait trouvé dans les ordures et qu’on appelait « Le chat », facile. Ma mère m’a regardé avec ses yeux bouffés par la maladie, un regard dément, avec un angle impossible de l’œil droit. Il n’y avait que son sourire qui parlait encore. Le sourire de ma mère qui m’ouvrait ses bras pour me souhaiter la bienvenue, heureuse de son sort parce que j’étais rentré. Sans une plainte, sans une larme, sa main qui me cherchait pour caresser mon visage. Sa voix tremblante et rouillée par le silence qui me disait : « Bonjour mon grand, comment vas-tu ? » Alors j’ai posé ma tête sur ses jambes, « Le chat » n’était même pas jaloux, je me suis agenouillé devant ma mère et j’ai pleuré.
J’ai repris le train le soir. J’ai craqué ma tirelire pour éviter mes congénères en vert. Je suis rentré en première classe dans une rame de civils. Le lendemain, après une nuit froissée, je tirais une gueule si longue que le capitaine Toussaint m’a convoqué en entretien. Je ne sais plus ce que j’ai dit. Je ne me souviens que de lui qui prend le téléphone et prononce cette phrase : « J’ai un gars ici, il faut le faire sortir ».
Je suis passé par l’infirmerie et la toubib m’a filé un Lexomil. Elle a signé des papiers, plein de formulaires en trois exemplaires avec feuille carbone. Je n’ai pas pu repasser par ma chambre – « Vos affaires suivront » a-t-elle dit – je suis monté dans une ambulance, direction l’hôpital militaire de Metz.
XI
La médecine militaire est bien différente de sa collègue de ville. Les malades sont majoritairement des hommes jeunes et en bonne santé. Parmi eux, les appelés blessés en manœuvre, les professionnels et leurs familles… À l’écart, dans un bâtiment moderne, se trouvait l’aile des psychiatriques, les P4 en voie de réforme. Deux bidasses m’accueillirent en ricanant. J’étais abruti par l’anxiolytique. Ils m’ont donné un pyjama bleu clair, une veste de laine de la même teinte, mais plus sombre et une paire d’espadrille. Je me suis demandé : « C’est à ça que ressemblait mon grand-père quand il est arrivé aux camps ? »
Il y avait deux couchages dans la chambre, celui près de la fenêtre était déjà occupé ; un stock de bouteilles de jus de fruits recouvrait le plateau près de la tête de lit. C’était propre et sans vie, la même chaise, la même table, identiques à toutes les tables et toutes les chaises de l’étage. Ça ressemblait à un hôtel Formule 1, les décorations en moins. On avait posé un set de linge sur le matelas…
Je décidais de remettre ça à plus tard et commençais à remplir le formulaire qu’on avait laissé là à mon attention. Ça passait le temps et je m’appliquais à bien répondre. Oui j’avais des pensées suicidaires, oui je prenais des stupéfiants et de l’alcool à l’occasion… j’étais affirmatif, je cochais toutes les cases, toutes celles qui, selon moi, m’aideraient à partir le plus vite d’ici.
XII
C’était l’heure de déjeuner. Le réfectoire était comme le reste, murs blancs, mobiliers bleus, et jeunes gens aux crânes rasés en uniforme de dingues. J’allais très vite apprendre à les connaître. Les civils et les bidasses. À l’intérieur de ce groupe, il y avait les furieux, les simulateurs, les gentils, les fragiles et les cas d’espèces. On nous a servi une tambouille de militaire, ni meilleure, ni moins bonne que celle de la caserne. Je l’ai vite avalée dans un bel unisson de fourchettes et déglutitions. Je n’avais pas encore compris que j’attendrai le moment du repas comme un ravi attend la crèche.
J’ai fait la connaissance de mon cothurne à mon retour. Il était plongé dans la lecture de mon questionnaire médical. Je l’ai détaillé le temps qu’il s’aperçoive de ma présence. Efflanqué, les dents en chicot, le menton fuyant et le regard noir sous des sourcils minces. Il était torse nu et couvert de tatouages. Des bousilles de mauvais garçons, tête de mort sur le buste, toile d’araignée au coude et un cœur du Christ sur le biceps.
— Faut pas laisser traîner ça ! m’a-t-il prévenu avant d’aller s’allonger sur son lit.
Je suis sorti fumer une cigarette.
On avait livré mes affaires dans l’intervalle.
— J’étais à Djibouti, a commencé mon voisin de chambrée, au début je buvais, très vite j’ai pris du crack.
Je l’écoutais en pliant mon linge.
— J’étais en cure de désintox là-bas…
La chauve-souris de son bras gauche me souriait d’un air torve.
XIII
J’ai rencontré les autres après le repas du soir. Des vampires, comme moi. Un gars du bâtiment des civils avait une filière et nous alimentait en shit. Le pétard tournait de main en main, très vite suivit par un autre, puis encore un. « Pourquoi t’es là ? » n’était pas la question, mais « Comment t’as fait pour arriver ici ? »
Ils s’appelaient Michel, ou Paul, ou je ne sais plus leurs noms – sans le confinement, je n’aurais jamais plus pensé à eux. Ils avaient tous une histoire. Pascal, taillé comme un Solex – il m’arrivait à l’épaule – finissait ses classes à Mourmelon, vaste champ de mines de l’industrie du char, vérolé par les obus. À cette époque, l’adjudant Chanal, le violeur psychopathe, chassait sur la route départementale qui menait du camp à la gare au volant de sa camionnette-corbillard. Et Jean-Michel… il avait passé sa première nuit de dortoir à se frotter l’axe du nez contre le montant du lit superposé ; direct en psychiatrie. C’était une grenade à cran d’arrêt. Au déjeuner, il s’est foutu sur la gueule avec Raoul, vingt ans, un plouc, père de trois gosses. Et Didier, un employé de mairie qui s’était taillé les veines jusqu’aux tendons. Et lui… les yeux vairons, insupportables, un visage d’ange, le seul à avoir gardé ses cheveux… Il était en taule pour trois ans quand est venu le moment de l’incorporation. Impossible de répondre à l’appel de la Patrie, le voici déserteur de surcroît. Les gendarmes sont venus l’attendre à sa sortie pour l’envoyer se faire réformer dans la foulée.