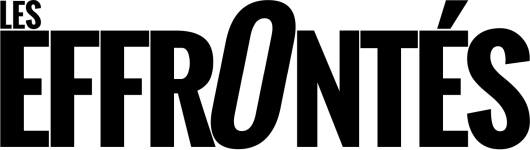Rien ne s’oublie, rien ne disparaît, le souvenir se transforme. Il se recouvre d’épaisseurs et de replis. À l’occasion du confinement décrété par nos dirigeants, « une situation exceptionnelle » affirment-ils, je retrouve les gestes et les attitudes. Je sais les dangers de l’incertitude psychique. Je sais l’émiettement du jour dans un ennui si lourd qu’il déchire l’espace.
Pourquoi ? Je suis déjà passé par ici. Comment ? Ces routes immobiles, je les ai parcourues un autre jour. La courbe du temps est-elle une droite ? Celle que parcourt la flèche du titan Chronos ? Mais vu de près, un cercle est rectiligne aussi. C’est une question de recul et de perspective. Dans cet instant prolongé, un pas de côté dans le réel, me revient en mémoire l’autre confinement.
I
Je suis parti en avril. C’était une erreur, une de plus. J’ai longtemps pratiqué la politique de l’autruche vis-à-vis du service militaire. J’ai loupé le coche aux trois jours. Le psy m’a demandé de le saluer, je me suis exécuté. J’étais apte. Ensuite, j’ai enfoui ce mauvais souvenir – découvrir cette déplaisante capacité à l’obéissance, mais je ne connaissais pas l’expérience de Milgram. Je me disais que si j’oubliais l’armée, l’armée m’oublierait. Ça n’était que justice, la symétrie ?
À cette époque-là, ma mère vivait encore. Sa maladie n’avait pas atteint la phase terminale – cela arriverait cinq ans plus tard, après qu’elle et mon père soient partis s’installer en Loire-Atlantique. L’armée m’a appelé. Il faisait bon à Paris et je terminais mes examens de maîtrise. Ma mère était toujours consciente mais sérieusement diminuée. Mon père était alcoolique et sombrait dans la dépression. On m’ordonnait de me rendre au plus vite à Épinal pour faire mes classes. J’étais affecté au 18e Régiment de Transmissions, caserne Varaigne dans la périphérie de la ville. La veille de mon départ, on a organisé une soirée d’adieu avec une copine. Je portais encore les cheveux longs – je ne savais pas que je ne les porterais jamais plus. Après avoir mangé, j’ai demandé à ma copine de me raser la tête. On avait bien bu et ça semblait être une bonne idée. Puis on a fait une photo de nous tous, moi avec ma nouvelle gueule, bien au milieu des quelques personnes présentes et qui n’étaient guère plus que des connaissances.
II
Le lendemain dans le train, je me suis planqué dans la dernière voiture et j’ai compris en regardant les rails qui défilaient devant moi que quelque chose avait disparu, je ne pouvais pas encore savoir quoi, mais je sentais bien que quelque chose manquait.
Nous étions vingt par chambrée. Les autres appelés étaient tous plus jeunes que moi. Ils avaient dix-huit, dix-neuf ans et voulaient en finir au plus vite avec l’armée pour se lancer dans la vie active. Ils parlaient de faire la guerre, d’apprendre à tirer, de camaraderies d’uniforme. Je ne me souviens d’aucun d’eux. Trop vieux pour être là, pas assez pour être ailleurs. J’étais comme hébété, pas sûr de comprendre ce qui m’arrivait. Levé à 5h00 du matin, couché à 10h00 du soir, assommé par la fatigue et la discipline, je dormais debout. Après trois semaines, j’avais appris à faire un lit au carré presque parfait, un demi-tour-droite potable et je savais reconnaître tous les grades jusqu’à celui de colonel. J’ai été envoyé au 53e RT à Lunéville en Meurthe-et-Moselle, affecté comme secrétaire au service du capitaine Toussaint. Cheveux coupés courts, la mâchoire à angle droit et l’œil vif, le capitaine Toussaint était un soldat plus vrai qu’une photo. Il avait pour adjoints un adjudant gras du bide et un aspirant polytechnicien pressé et roublard. Lunéville était encore à cette époque, une ville de garnison, tournée vers l’Est. Un point sur la ligne Maginot. Par la suite, la force militaire française fut redéployée en même temps que l’on réduisait les budgets et que l’on construisait l’Europe.
III
Aujourd’hui Lunéville n’est plus qu’une banlieue dortoir de Nancy. On a fermé des classes, supprimé des lits d’hôpital et les commerçants du centre-ville ont plié boutique. J’ai juste eu la chance d’être là quand on a éteint la lumière et refermé la porte.
Il y avait une assistante sociale à Lunéville. J’ai été la voir le troisième jour après mon arrivée. Je voulais partir, je pensais qu’elle pouvait m’aider. Elle a pris son téléphone pour en parler au capitaine Toussaint qui m’a immédiatement fait venir dans son bureau.
– Soldat, je comprends, ma femme et mes enfants vivent en Nouvelle-Calédonie, a-t-il dit d’une voix ferme.
J’avais parlé à l’assistante sociale d’un rapprochement de domicile. Pour pouvoir m’occuper de ma mère.
– Je vois ma famille deux fois par an. On a tous nos problèmes, mais le devoir avant tout.
Je n’ai plus revu l’assistante sociale et je n’ai plus rien dis à personne. Je me suis mis à picoler sévère. La bière n’était pas chère au foyer. Le responsable était de Bretagne – comme moi mais par mon père seulement – entre pays on peut se comprendre. Il maquillait les inventaires et revendait le surplus derrière le bar. Je buvais à l’œil du lundi au vendredi et le week-end je retrouvais mon vieux pote Manu, un autre Breton, que j’avais connu au collège. Ensemble nous avions bu tout ce qu’il était possible de boire, même du parfum. On continuait de se voir régulièrement, à chaque fois pour s’arsouiller copieusement. Manu avait une petite amie, Mino. Manu et Mino… Ça nous faisait bien rire.
IV
Mino était angevine, une brune à l’air triste et concerné. Toute menue, elle avait un corps élégant et un nez de travers suite à un accident de patin à roulette quand elle était gamine. Aînée d’une fratrie de sept enfants, elle s’était retrouvée chargée de famille après le décès de son père. Un mauvais qui avait le vin bagarreur et que personne n’a pleuré. La mère de Mino faisait des ménages et ne pouvait pas joindre les deux bouts. Ils vivaient de chèques-vacances, de bons pour la banque alimentaire et de coupons pour le centre de loisir. Ce qui n’avait pas empêché Mino, bien au contraire, de faire des études. C’est à l’université que Manu avait fait sa connaissance. Elle était plus vieille que nous deux et elle travaillait à côté pour payer son loyer. De son point de vue, Manu et moi étions d’incorrigibles fils à papa. Ils étaient tous les deux motards. Manu avait une Yamaha Ténéré de couleur noire, un engin adapté à sa taille de gentil géant. Mino conduisait un roadster Harley-Davidson. Pour se le payer elle avait enchaîné les récoltes lors des saisons d’été. Elle l’avait fait repeindre en rose et elle aurait arraché les yeux au premier qui lui rayait la peinture du réservoir. Elle me plaisait bien Mino, sérieuse, responsable, avec son sourire confus et de guingois, elle cachait bien son jeu. Elle était sacrément dessalée quand elle voulait. Mais c’était la copine de mon pote, et les copines des potes c’était comme des sœurs.
V
J’ai compris après cette affaire que je n’avais pas vraiment beaucoup de potes. J’étais un solitaire, sauvage et asocial. Je causais beaucoup, pour éviter que les autres ne me parlent. Après l’armée, j’ai cessé de répondre au téléphone et de faire des efforts pour avoir l’air d’être quelqu’un, mais je crois que cela avait commencé avant. L’armée, ça m’a coupé les pattes. J’avais plus envie d’aimer les gens, ou même de faire semblant. Il ne s’est rien passé d’extraordinaire et j’ai fini par être réformé. J’ai pas été au trou, je ne me suis pas fait passer à tabac, seulement voilà, j’ai rencontré Mino, et Mino c’était la femme d’une pote. En d’autres circonstances on en serait resté là. Mais l’armée, ça n’était pas bon pour moi. Trop de monde qui vous hurle dessus, pour un rien. Les gars qui se carapatent dès que se pointe un galon, et toi, tout seul au milieu du couloir, tu te reçois la corvée de latrines comme si c’était toi le gros dégoûtant pourri du ventre qui avait retapissé les chiottes en verdâtre puant. Le manque de sommeil, les trains de nuit, comme des wagons à bestiaux, les petits matins froids dans les rues qui dorment. J’en pouvais plus et je crois que j’avais envie d’un tout petit peu de chaleur humaine. D’une peau douce contre la mienne. D’un regard amical au réveil. Au moins pour une nuit. Juste une nuit.
VI
Un week-end je n’ai pas pu revenir. De vaisselle le samedi, il ne me restait que le dimanche. J’allais le passer à Nancy. J’ai appelé Manu.
– C’est pas grave, a-t-il dit, sa voix était épaisse et froide comme un cendrier plein de cigarettes un lendemain de fête, j’ai rompu avec Mino.
Il avait dit « j’ai rompu », comme si rompre était un geste qui rapproche. J’aurais pu comprendre ça. Manu était ce qui ressemble le plus à un ami. Mais comme mon père, j’étais un ivrogne.
– Pourquoi ? ai-je dit.
Je n’avais pas envie de le savoir. Et je savais que Manu n’avait pas envie de raconter. Il était comme ça Manu, il ne posait pas beaucoup de questions et ne donnait pas plus de réponses. Autour de lui, les petites amies allaient et venaient. J’ai raccroché. J’avais une journée à tuer dans une ville que je n’avais jamais vue. J’ai appelé Mino. Sans même essayer de me convaincre que je faisais ça pour des raisons honnêtes. Moi aussi je ne donnais pas de réponses. Je passais trop de temps à ne pas me poser de questions.
– C’est moi, ai-je dit, tout va comme tu veux ?
– T’as parlé à Manu ?
Je n’allais pas mentir sur mes intentions, je n’avais pas eu l’occasion d’y penser. Le ciel était plus clair que moi. Un beau bleu de début de matinée, sans nuages pour le chiffonner ou le barbouiller de gris. J’étais dans la vieille ville, pas loin du Parc de la Pépinière. Nancy ressemble à Paris, mais en plus petit. Une Capitale en minuscule.
– Ça te dirait d’aller boire un café ou quelque chose.
– Tout de suite je peux pas, je dois aller travailler.
– La semaine prochaine ?