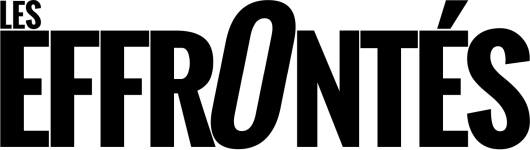Si vous n’avez pas lu les récits d’enfance de Marcel Pagnol au collège, vous pouvez garder rancune à vos enseignants de vous avoir privé de ces livres. Ils ont le goût vrai de l’enfance : tendresse, cruauté, émerveillement, terreur… Les puissantes émotions que connaissent même les enfants actuels, élevés en bocal par le couple maman-écran. Sous le parfum provençal il y a de l’universel chez Pagnol, si bien qu’un garçon du XXIe siècle peut s’identifier sans peine au petit Marcel, plus d’un siècle après ces glorieuses vacances de l’été 1904 contées dans La Gloire de mon père.
La maman de Marcel s’appelait Augustine. Son papa Joseph était instituteur titulaire, s’il vous plaît ! Autrement dit, c’était une famille de la petite bourgeoisie marseillaise avec un capital éducatif élevé pour l’époque et des revenus plus confortables que la majorité de la population. L’oncle Jules, le mari de la sœur d’Augustine, était encore plus à l’aise puisqu’il était « sous-chef de bureau à la préfecture ». Augustine eut son premier enfant à 21 ans, mais il ne vécut que quatre mois. Puis Marcel (à 22 ans), son cadet Paul (à 25 ans) et la petite dernière, Germaine (à 29 ans). Elle eut encore un fils postérieurement à la période racontée dans La Gloire de mon père et mourut à 36 ans. Joseph est 4 ans plus âgé. que son épouse. Veuf à 41 ans, il se remaria deux ans plus tard avec une femme de 25 ans. Ainsi, au début du XXe siècle, même les classes moyennes titulaires ne pouvaient s’isoler de la vie et de la mort comme elles tentent frénétiquement de le faire à présent.
Mais restons en 1904. Cette année là, Marcel a 9 ans et les longues vacances d’été s’annoncent extraordinaires car Joseph et l’oncle Jules ont décidé de louer conjointement une villa à la campagne. Pour ces premières vacances hors de Marseille il faut transporter là-bas les meubles achetés à la brocante, assez de bagages pour la durée du séjour et tous les membres de la famille. De nos jours, il suffirait de louer un fourgon pour les meubles, et de mettre bagages et enfants dans les automobiles familiales. Mais au début du XXe siècle la voiture à moteur est encore un engin extraordinaire réservé à des gens riches et audacieux. Les voitures courantes sont à traction animale ou humaine. L’oncle Jules loue donc une voiture à cheval et, pour le budget plus modeste des Pagnol, la charrette d’un paysan.
L’oncle Jules, qui se flattait d’être un organisateur, déclara d’abord qu’à cause de l’état des chemins, il n’était pas possible de louer une voiture importante qui aurait d’ailleurs coûté une fortune — peut-être même vingt francs !
Il avait donc loué deux voitures : un petit camion de déménagement, qui transporterait ses propres meubles, ainsi que sa femme, son fils et lui-même, au prix de sept francs cinquante.
Cette somme comprenait la puissance d’un déménageur qui serait à notre service toute la journée.
Pour nous, il avait trouvé un paysan, qui s’appelait François, et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait deux fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de quatre francs. Cet arrangement enchanta mon père, mais Paul demanda :
« Et nous, nous monterons sur la charrette ?
— Vous, dit l’Organisateur, vous prendrez le tramway jusqu’à la Barasse, et de là, vous rejoindrez votre paysan pedibus cum jambis. Augustine aura une petite place sur le chariot, et les trois hommes suivront à pied, avec le paysan.
Les trois hommes, ce sont bien sûr Marcel, son père et le petit Paul. Voyons le trajet :
Du logement des Pagnol, avenue des Chartreux, environ 1 km à pied jusqu’à l’arrêt du tramway. Un peu plus de 8 km en tramway jusqu’à La Barasse. La villa est à 4 km à vol d’oiseau de La Barasse, mais avec un détour de 9 km à pied. Joseph porte la petite. Après une heure de marche, pause goûter. La charrette de François, chargée des meubles, rejoint la famille Pagnol au carrefour des Quatre-Saisons. Le paysan a donc fait, lui, la totalité du trajet à pied. Augustine s’inquiète des futures difficultés d’approvisionnement engendrées par la distance.
« Joseph, c’est bien loin !
— Et nous n’y sommes pas encore ! dit joyeusement mon père… Il nous reste au moins une heure de marche !
— Aujourd’hui nous n’avons pas de paquets, mais quand il faudra monter les provisions…
— On les montera, dit mon père.
— Maman, nous sommes trois hommes, dit Paul. Toi, tu ne porteras rien.
— Bien sûr ! dit mon père. Ce sera une promenade un peu longue mais tout de même une promenade hygiénique ! De plus, nous ne pourrons venir que pour la Noël, Pâques et les grandes vacances : en tout trois fois par an ! Et puis nous partirons le matin de bonne heure, et nous déjeunerons sur l’herbe, à mi-chemin. Puis nous nous arrêterons encore une fois, pour goûter. Et puis, tu as vu ces rails. Je vais en parler au frère de Michel, qui est journaliste : il est inadmissible qu’on les laisse se rouiller si longtemps. Je te parie qu’avant six mois, le tramway nous déposera à la Croix, c’est à dire à six-cent mètres d’ici : il ne restera pas une heure de marche. »
Toute la troupe repart pour la dernière heure de marche. Privilège des dames, Augustine est installée sur la charrette avec la petite. Paul (6 ans, le plus petit des garçons) sur le mulet. Vingt minutes plus tard, une côte plus rude que les autres impose à tous un effort supplémentaire.
« Voilà le village de la Treille ! » dit mon père.
Nous étions au pied d’une montée abrupte.
« Ici, dit le paysan, il faudrait que madame descende, et que nous poussions un peu la charrette. »
Le mulet, de lui-même, s’était arrêté, et ma mère sauta sur le sol poudreux.
Le paysan détrôna Paul, puis sous le ventre du chariot il ouvrit une sorte de tiroir, et en sortit deux gros coins de bois. Il en tendit un à ma mère surprise.
« C’est des cales, dit-il. Quand je vous le dirai, vous poserez celle-là par terre, derrière la roue de ce côté. »
Elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d’hommes, et prit la grosse cale entre ses petites mains.
« Et moi, dit Paul, je mettrai l’autre ! »
Sa proposition fut acceptée, et je fus profondément vexé par cette nouvelle violation du droit d’aînesse. Mais j’eus une revanche éclatante, car le paysan me tendit son fouet, un très gros fouet de roulier, et dit :
« Toi, tu frapperas le mulet.
— Sur les fesses ?
— De partout, et avec le manche ! »
Puis il cracha dans ses mains, rentra la tête dans ses épaules, et les deux bras en avant il s’arc-bouta contre l’arrière du chariot : son corps était presque horizontal. Mon père prit de lui-même la même posture.
L’expédition vers la villa des vacances aura nécessité douze à quinze kilomètres de marche pour François et son mulet (je ne suis pas sûr de son trajet, et il faudrait ajouter au moins autant à l’aller, le matin même), une dizaine pour Marcel et Joseph, à peine moins pour le petit Paul et Augustine. L’enfance de Pagnol se déroulait dans un monde mû presque entièrement par le muscle. La jeunesse de mes grand-parents, au milieu du XXe siècle, fut à peine plus motorisée. L’automobile restait un véhicule de gens cossus. La plupart des Français bénéficiaient du progrès mécanique en prenant l’autocar et le train. Mon grand-père eut le privilège de conduire une motocyclette à l’armée (et de perdre son officier dans un virage quand les boulons du side-car lâchèrent, ce qui le faisait encore rire cinquante ans plus tard). C’est à la fin des années 1960 que la voiture devint un équipement courant, et l’instrument rêvé des jeunes boomers pour leur propre déracinement.
Dans un tel monde, les instituteurs titulaires s’arc-boutent derrière les charrettes pour aider les mulets, les enfants marchent autant que les adultes dès qu’ils le peuvent, les petits garçons portent les courses de leur maman et les femmes ont des maris. Comparons à la situation présente : un femme peut aisément installer ses enfants dans la voiture, les bagages dans le coffre, et par la puissance du moteur à explosion emmener toute seule son petit monde vers le gîte des vacances à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Si elle a besoin de meubles, il suffit de se les faire livrer. Le prix des biens de consommation est minime, grâce à l’automatisation et à la délocalisation de la production, et le coût de la livraison presque négligeable. Tout est beaucoup plus facile et moins cher qu’au temps de Joseph et Augustine Pagnol. Le monde n’est plus mû par les muscles des hommes et des animaux. Comme le cheval et le mulet, il ne reste à l’homme qu’une utilité incertaine.
Pour cette raison, je conteste que la grande rupture entre les hommes et les femmes ait commencé avec l’invention de la pilule contraceptive, la légalisation de l’avortement et la libéralisation du divorce. Il a fallu d’abord que l’ère industrielle fournisse aux individus les moyens concrets de se passer les uns des autres. Sans l’abondance prodigieuse de biens et de services, et le niveau de sécurité extrême dont jouissent les ressortissants des pays industrialisés, il n’y aurait pas d’individualisme absolu et encore moins de féminisme. La « libération sexuelle » est le produit d’une époque de croissance économique inégalée. La pilule contraceptive en fut un ustensile, comme l’automobile, l’électro-ménager et même la télévision. La famille traditionnelle avait été une forme d’organisation appropriée à des conditions de vie plus difficiles. Le penchant des individus à poursuivre leurs pulsions existait sans aucun doute, mais il était borné par les contraintes impérieuses de la survie et de la reproduction. La loi, la coutume et la morale étaient les adaptations civilisationnelles à ces contraintes — le mode d’emploi éprouvé d’une existence plus rude et plus risquée que la nôtre. Passé un certain niveau de richesse, il était sans doute inévitable que les formes collectives se dissolvent dans l’hubris individuel. Passé un certain niveau de déclin économique, il sera tout aussi inévitable que ces formes ressurgissent. Les gens qui adhéreront tôt au renouveau de la famille, du village et de la nation donneront à l’Avenir la plupart des enfants qui le peupleront. Ce que vous, moi, ou n’importe qui en pense selon son goût personnel et ses lubies idéologiques n’est d’aucune force devant le besoin d’approvisionnement et de protection du corps humain — et surtout féminin. En vérité je vous le dis : avant la fin de ce siècle le mari retrouvera une place de premier ordre dans la société, comme le cheval et le mulet.