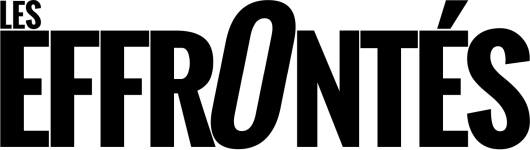Ne croyez pas que les Effrontés soient en train de devenir un recueil d’histoires de marins sous prétexte qu’après vous avoir raconté la vie trépidante de James Wharram je vous livre ici une traduction d’un extrait des mémoires de Jim Brown — un pionnier de la conception des multicoques de plaisance dans les années 1960. Ce qui motive la publication de ce texte, c’est la qualité de la relation entre Jim et son fils Russell — lui-même un génial constructeur de praos, c’est à dire de multicoques inspirés des pirogues à balancier d’Océanie. C’est un moment rare entre un père et un fils, réunis sur un bateau extraordinaire, le passé en remorque, l’avenir derrière l’horizon et la mer tout autour. — TB
« Et bien, papa, ça fait longtemps que nous n’avons pas fait un vrai tour en bateau tous les deux. » C’était en mai 1985, et Russell appelait des Bermudes. « Je pense que tu devrais prendre l’avion jusqu’ici et m’aider à emmener Kauri jusqu’au cap Cod. » Je sentis un ancien spasme dans ma pomme d’Adam. Il y eut un long silence.
« Allô ? » dit Russell, pensant que nous avions été coupés.
« Qui ça ? Moi ? » ai-je finalement coassé. « Tu sais que je ne te serai guère utile dans ton engin. »
Russell rit et dit : « Oh, allez, papa. Tu peux y arriver. On va prendre du bon temps. »
J’ai réalisé que c’était une invitation que je ne pouvais refuser. Mon esprit se mis à parcourir toutes les navigations de mes fils. Quand je savais qu’ils étaient en mer, je faisais une bonne quantité de « promenade sur la plage » en ruminant les conséquences potentielles de leurs capsules d’évasions construites en amateurs, et de ma propre responsabilité dans le style de vie qu’ils s’étaient choisis. C’était probablement moi qui les avais affligés de leur quête de la liberté, qui ne peut-être qu’approchée, jamais pleinement atteinte. Je l’ai cherchée depuis ma première vision d’une île tropical à l’aube, et à présent Russell me demandait de la chercher avec lui dans un bateau de sa propre fabrication.
Je n’avais jamais envisagé d’aller en mer moi-même avec une embarcation aussi arriviste que Kauri, le prao de Russell. Comparée à son premier, de 9 mètres, appelé Jzero, ce 11 mètres était à des années lumières dans son développement. Mais il « rebroussait » toujours. Au lieu de virer face au vent comme un voilier normal, il s’arrêtait momentanément et repartait sur l’autre bord « la poupe la première ». (En fait, il avait deux proues, une à chaque bout.) Kauri m’embrouillait, particulièrement la nuit, et je savais que Russ avait besoin d’un équipage sûr pour un tel voyage. Mais que pouvais-je dire ? Il n’y avait pas d’excuse possible que mon fils aurait pu croire tout à fait. J’étais désœuvré, de toute façon, toujours irrité par la disparition du projet aux Philippines et essayant sans trop d’enthousiasme de suivre les avancées météoritiques faites par les multicoques modernes. Peut-être qu’une traversée océanique me viderait la tête et que j’apprendrais quelque chose sur les praos. Alors j’ai ravalé le spasme de ma voix et j’ai dit : « D’accord, je viens. J’apporte des pilules contre le mal de mer et on se voit dans deux jours. »
Des enfants et des praos…
En effet, je souffrais toujours de mal de mer, particulièrement quand je ressentais la pression de la responsabilité du bateau et de l’équipage. Après l’appel de Russell, j’ai passé une nuit blanche à me demander si je serai une aide ou une entrave pour mon fils. Et reverrai-je jamais Jo Anna ? C’était dingue, aller dans l’Atlantique nord avec l’équivalent moderne d’une pirogue du Pacifique sud.
Comment faisait-il déjà, pour « rebrousser » son prao ? Son gréement courant et ses voiles étaient suspendus toujours du même côté, à l’opposé du flotteur, mais ne fonctionnaient pas comme les pirogues traditionnelles de l’Océanie de l’âge de la pierre. De plus, à chaque fois que Russ échangeait la « proue actuelle » contre la « proue suivante », le barreur devait manipuler deux dérives, chacune incorporant un safran, un pour chaque direction. Le navire n’avait ni roue ni barre. À la place, on le barrait avec deux fouets verticaux, également un pour chaque direction. Les fouets s’actionnaient d’avant en arrière au lieu de pivoter latéralement comme une barre, et je n’arrivais jamais à me rappeler s’il fallait pousser ou tirer sur ces fichues choses pour faire virer le bateau à droite ou à gauche. Pourrais-je m’ajuster à un système si différent en mer ? J’allais le savoir.
Nous avons profité de deux jours de grande camaraderie aux Bermudes, où père et fils ont attendu une fenêtre météo en écumant les bistrots sur le port de Saint George. Finalement, les choses semblaient favorables, alors Russell appela le contrôle du trafic maritime des Bermudes sur sa radio et reçut la permission de partir. Le seul fait qu’il ait une radio à bande latérale unique à bord fut une surprise et un soulagement pour moi, car jusqu’en 1980 nous n’avions même pas une VHF sur Scrimshaw. Russ n’avait pas de licence pour la radio, bien sûr, mais au moins il avait la radio. Il avait même une VHF portative. Hé, la haute technologie !
Notre voyage commença dans des conditions modérées avec une bonne brise, et Kauri avala les milles avec une facilité qui me fascinait. Il galopait sans effort, silencieux et sec, et nous échangions des quarts relaxants tandis que le grand prao se barrait tout seul vers le nord, à environ dix nœuds. Les longs bras s’étiraient vers l’est, d’où les vents soufflaient doucement, et finalement, à quelque six mètres de la coque principale, se connectaient au flotteur. C’était une embarcation si étendue et semblant pourtant aussi solide qu’un bloc de bois. Tout le jour et toute la nuit, et tout le jour suivant aussi, Kauri garda son galop léger. Nous nous cuisinions des repas complets, faisions un peu de lecture, et parlions des jours passés autrefois en Californie. Dans ces conversations dont l’essence m’est restée, il nous semblait tous les deux que nos années dans l’ouest avaient été comme un rêve. Comment des lieux tels que Sausalito, Big Sur, Santa Cruz et Big Creek Canyon avaient-ils pu exister pour nous dans une époque comme les années 1960 ?
La conversation se déplaça vers nos voyages en famille sur Scrimshaw, et notre retour aux États-Unis. « Je suppose que nous n’aurions pas dû nous attendre à ce que ce soit facile » dis-je, « revenir d’une telle expérience. Mais nous avions vraiment besoin de nous trouver un endroit pour vivre. Et, tu te rends compte, nous n’aurions pas pu faire cela si maman n’avaient pas voulu retourner enseigner. »
« Et n’est-ce pas génial ce qu’elle est capable de faire pour ces gamins ! » dit Russ.
« Elle est douée pour ça. » dis-je. « Mais nous n’aurions rien pu faire de tout cela sans elle. Durant toutes mes pérégrinations autour du monde ces dernières années, j’ai été bien payé parfois, mais plutôt sporadiquement. Nous avons eu de vrais problèmes d’argent, mais grâce à son boulot régulier il y avait toujours sa paye mensuelle pour venir nous tenir la tête hors de l’eau. »
« Mais travailler avec des gamins comme ça », dit Russ, « qui ont des problèmes d’apprentissage ? Ça doit être dur pour elle parfois. »
« Elle rentre terriblement fatiguée certains jours, mais elle adore ça, et je ne sais pas ce que l’on ferait sans sa paye. Je ne serais pas en train de naviguer avec toi comme ça, je te le dis. »
« J’adorerais qu’elle et Steve soient avec nous, papa. »
« Ouais, en fait maman semble contente quand je suis parti pendant un moment, mais je me demande souvent comment Steve se débrouille tout seul là-bas, aux Tuvalu. Il s’est fait de bons amis là-bas, mais l’atoll est si isolé, Russ. Tu n’y croirais pas. Bon, si tu te montrais en lointaine Polynésie avec un bateau comme celui-ci, ils penseraient que c’est le retour du Christ. »
« C’est une bonne raison pour moi de ne pas y aller. », rit-il. « Mais j’espère bien voir le Pacifique un jour. Et à propos de Steve ? Il s’est trouvé un boulot en enseignant la construction de bateaux en Polynésie ! Ça ne doit pas être mal. » Russ alla sur le pont vérifier l’horizon et les voiles. Lorsqu’il revint, il dit : « Comme les choses vont à présent, je suis content d’avoir ce bateau. »
« C’est aussi comme ça que je le vois, Russ. Après la période en Afrique et en Asie, maman et moi avons décidé que Scrimshaw n’était à vendre à aucun prix. Un jour, quelque chose va arriver qui fera réaliser à tout le monde qu’il doit y avoir une limite à tout cette croissance économique explosive, et à cette population grandissante. Nous allons devoir admettre que ça tue la planète et nous tous avec. Et quand cela arrivera, il y aura vraiment de l’agitation, ou pire. Il pourrait y avoir un vrai chaos dans le monde. »
« Tu sais, papa, j’ai pensé… Et bien, c’est presque comme… Le plus tôt sera le mieux, afin qu’il reste peut-être un petit quelque chose de la Terre pour que les survivants continuent d’y vivre. »
« Et bien, il est peut-être trop tard. » dis-je. « Ils disent que si les colons arrivaient aujourd’hui à Plymouth Rock ou Jamestown, ils ne s’en sortiraient pas, parce que tout le territoire a été usé. »
« C’est pour cela que je pense que ça pourrait ne pas être un mauvais moment pour avoir de la mobilité, comme mon petit bateau. »
« Et comme notre petit bateau. », ajoutais-je.
« Papa, Scrimshaw nous a tous montré beaucoup de choses sur la façon dont le monde fonctionne. Et même si l’Amérique se retrouve à genoux, je ne pense pas que nous en serons beaucoup victimes, personnellement. Tu sais, depuis l’époque sur Scrimshaw, nous avons appris à nous débrouiller avec très peu et à être autonomes. Je suis content d’avoir cela en moi, et je veux que tu saches que je suis très satisfait de la façon dont je vis, en quelque sorte, aux marges de la société. »
« Bon sang, c’est un soulagement de t’entendre dire ça Russ, parce que maman et moi, nous n’avons pas fait grand-chose pour votre éducation. Pas du tout comme mes parents avaient essayé de faire pour moi. Mais regarde ce qu’ont donné leurs efforts ! » Je ris sarcastiquement. « Ils espéraient tant que je sois dans les affaires. »
Russell se tut pendant un moment, puis dit enfin : « La meilleure chose que toi et maman avaient fait pour moi et Steve, c’était de rester ensemble. Tant bien que mal, au milieu de toute la folie de cette époque, vous avez réussi à rester accrochés l’un à l’autre. »
« J’aimerais qu’elle soit là pour entendre ça. », dis-je. Ensuite je vis le paradoxe mais je ne le mentionnais pas. Si Jo Anna et moi avons vraiment donné un si bel exemple à nos garçons, pourquoi sont-ils tous deux célibataires au début de la trentaine, menant encore des vies itinérantes ? Jo Anna commençait à désespérer d’avoir des petits-enfants, mais ni Steve ni Russ ne montraient le moindre signe de vouloir se marier. Ils venaient souvent à la maison avec des amies, toutes pratiquement enrôlées par nous, mais aucune ne semblait durer. Dans mes pensées les plus profondes j’étais attristé par la perspective de ne pas avoir davantage de progéniture, mais en surface je respectais grandement, et même j’enviais le mode de vie de mes fils. J’étais convaincu que probablement au cours du siècle prochain le taux de mortalité mondial rattraperait au moins son taux de natalité, et une telle époque pourrait être brutale pour la plupart des gens élevant des enfants. Pourtant, la chance de pouvoir transmettre ce que j’avais appris de la vie à une autre génération me manquait, et j’étais troublé que Steve et Russ ne veuillent pas être simplement comme papa et maman.