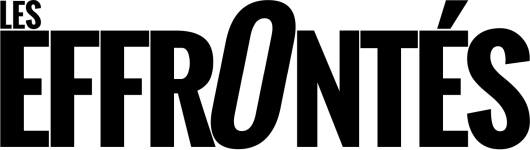« On a couché ensemble le jour de son premier anniversaire de mariage. » Tapi dans l’ombre alcoolique d’un bar à pute de Pigalle, Charles parle à qui veut bien l’écouter. « On baisait comme des lycéens, l’après-midi surtout. Le soir, elle rentrait chez elle pour retrouver son mari. » Charles jette un œil à son interlocutrice. Amanda ? Perle ? Ou bien est-ce Jade ? Il ne sait plus très bien. Il s’en fout. « Elle avait une théorie sur tout, l’adultère, les nouveaux couples… Rien n’était neuf à l’entendre. “Je jure fidélité à un homme et je me fais tirer par d’autres”, rien de plus normal à la croire. » Jade, ou bien Perle, l’écoute très attentivement. La peine du pauvre gars ne l’attriste pas. Ce qui réclame son attention c’est l’effort qu’elle fait pour ne pas éclater de rire. Devant sa flûte à champagne, Charles continue son soliloque pitoyable. C’est un bel homme. Dans le genre vieux beau et plein de pognon. La cinquantaine en fin de décennie, une barbe de trois jours et les cheveux blancs, d’anciens beaux yeux bleus qui tirent sur le rouge. Un nez convexe et des pommettes saillantes lui donnent un air de Vincent Cassel, vingt ans après. Du fric, Charles en a toujours. Un gros ventre aussi. Il est au stade 2 de l’obésité. À cet étage, il ne voit plus la couleur des cheveux de la fille qui besogne sa petite bite fripée. Amanda ? Jade ? Ou bien est-ce Perle ? Il est marié — il porte une alliance qu’il tripote quand il sent que personne ne l’écoute — il dit être marié, mais il ne parle jamais de sa femme. Il ne parle que d’elle, sa maîtresse. La première, l’unique. Les filles de la Porte Sublime ont reconstitué l’histoire. À partir des fragments épars qu’elles ont glané. Charles a cru y voir de l’intérêt, il n’a pas complètement tort. Les filles savent qu’un client qui se sent écouté et compris sera généreux. L’histoire, elles s’en contrefoutent. Elles font mine d’y croire, c’est pour ça qu’on les paye.
Ce qu’elles ont compris, les filles de la Porte Sublime, tient en quelques mots, de quoi écrire un filet dans l’édition locale du Parisien. Charles, notable de gauche d’une ville proprette de la vallée de Chevreuse, Tourneville-sur-Yvette, est devenu riche en vendant du vent. Il dirige une boîte de conseil en management, il écrit des livres. Dans ces recueils de formules expéditives et faciles pour hommes pressés, il théorise la haute idée qu’il se fait de lui-même : « Le Grand, écrit-il en préface de son premier ouvrage, est actif et son activité consiste à s’insérer dans des réseaux. Il multiplie les projets de tous ordres et a le désir d’entrer en relation, de se connecter. Il fait preuve d’enthousiasme et il sait faire confiance. Il est réactif, mobile et ne s’attache pas à une qualification ou a un métier. Adaptable, flexible et polyvalent, il développe son employabilité car il sait prendre des risques et est toujours maître de lui-même, de ses relations — amonts et avals — et de ses réseaux. » Les filles du bar ne lisent pas ce genre de littérature. Il n’y a pas de grands ou de moins grands, il n’y a que des hommes aux prises avec leurs désirs frustes et grossiers. « Le Grand ne doit pas se faire repousser, mais attirer l’attention, la sympathie. Il n’est pas timide, il n’est pas orgueilleux. Il considère que toute personne est contactable et que tout contact est possible. Il ignore les différences entre sphère privée, professionnelle, médiatique… » Son succès, Charles le doit à un sens aigu de la tendance — de ce qui se vendra demain — mais aussi à une éducation exigeante et traditionnelle à l’ombre des classiques et des murs du lycée Louis-le-Grand. Charles n’a pas toujours écrit comme ses pieds. Ses professeurs ont le souvenir d’un esprit clair et limpide, comme le vol d’un oiseau dans un ciel d’été. Un goût pour la formule courte et forte qui, en ces temps d’agitation estudiantine, en faisait le leader charismatique d’un groupuscule maoïste. Plus tard, ce même talent trouvera à s’employer dans la publicité et la vente. « Il est animateur d’une équipe qu’il ne dirige pas de manière autoritaire mais en se mettant à l’écoute, avec tolérance et en respectant les différences. C’est un chef mais pas au sens qu’il occupe une position en surplomb dans un organigramme pré-défini. Il est un intégrateur, un donneur de souffle, un fédérateur d’énergie, un impulseur de vie, de sens, d’autonomie. Il possède l’art de la conciliation des contraires. À l’aise dans le flou, il fait route avec le désordre, l’imprévisible et l’embrasement. » Il doit aussi son succès à un confortable pécule.
Il était habituel dans les cercles de la gauche extrême, au début des années 70, de partager le quotidien des travailleurs. Charles devient établi dans le secteur automobile, un étudiant aux cheveux longs et aux doigts fins, qui partage la vie des prolétaires et les prépare à la Révolution. De son expérience il tire un récit : La chaîne, qui devient un classique de la sociologie officielle et un succès de librairie. Bien que publié sous pseudonyme, le livre propulse Charles dans le cercle très fermé des gens qui comptent. Après l’évidence de l’échec du monôme étudiant, les révolutionnaristes comme lui deviennent utiles de l’autre côté de la faucille. Pour prouver qu’ils seront meilleurs que l’ennemi, ils embrassent de nouvelles carrières avec la foi de jeunes puceaux. Charles se marie, s’installe dans sa vie confortable d’homme sans différences. Il a un fils, puis un deuxième, puis une fille enfin. Il gagne de l’argent, sa femme gagne de l’argent et vingt-cinq années s’écoulent sans surprises, dans un ennui de coton hydrophile. Quand la torpeur l’étouffe, Charles rêve de reprendre sa place dans la chaîne, de connaître encore une fois l’amitié franche et morne de ses camarades. « Il y avait P’tit Louis, de la sellerie, un homme doux avec des épaules dessinées au fil à plomb, comme des potences. Il y avait Joseph, Milan et la bande de yougoslaves, qui sont comme un seul homme, comme une seule voix. Il y avait Ahmed, Bilel, Oumar et tous les Arabes de la carrosserie, d’ordinaire silencieux. Il y avait Abdul l’impénétrable. Il y avait les femmes aussi. » Dans ces moments de regrets, il se plonge dans sa prose ancienne : « Ce n’est pas la grande histoire, ce n’est pas l’histoire des grands. Ce n’est pas l’histoire d’épiques batailles rangées de la cause syndicale. C’est une histoire qui a lieu tous les jours, huit heures par jours, soixante minutes par heure, soixante secondes par minute. C’est l’histoire d’un geste, d’un corps à l’ouvrage, d’un mouvement qui a deux visages. Le premier est le geste de l’ouvrier qui fait ce qu’on lui donne à faire. Avec le chrono comme juge, le rendement comme horizon, les normes de production comme lois. Le second est le même geste, vu de l’autre côté. Du côté de l’autre. L’ouvrier qui se donne comme règle le combat contre la machine. Le sabotage de chaque instant. Combat inlassable, incessant, harassant contre la montre, contre la direction. C’est une histoire, c’est un manuel. La triche, comment faire ? Les cotes, les nouvelles machines. La lutte, comment faire ? » écrivait-il.
Sur la chaîne il rencontre Tina. Une grande fille avec des cheveux bruns qui pétillent comme des étincelles autour de ses yeux noirs. Sa peau était étonnamment blanche et sur sa tempe gauche pulsait une veine bleue. Elle avait un corps en forme de couteau à cran d’arrêt. Sur la chaîne, tout le temps pliée en deux, elle se relevait dès l’instant de la première sonnerie. Tina n’était pas la fille à tout le monde comme le chante Brassens. Elle se donnait librement à qui elle voulait, pas à tous. Charles, alors, était un beau jeune homme, pas un ouvrier. Tina l’a su immédiatement. Ça n’était pas un pue-la-sueur ni un trimardeur. Il avait des mains délicates, fines comme une pluie d’avril. Des mains faites pour jouer du violoncelle ou du piano. Des doigts qui n’ont jamais connu que le satin des livres reliés plein cuir, la tendresse des dimanches à la plage. Tina a essayé de lui expliquer la chaîne. « C’est pas simple la chaîne !… Comment faire pour te donner une idée ?… C’est pas simple d’être là à cinq heures moins le quart du matin, le temps, à peine, pour une dernière cigarette, en vitesse dans le froid, avant la sonnerie. Tu prends ton tablier, tes outils. C’est triste. Après ça, sur la chaîne, tu ne fais plus attention au travail, tu le fais par habitude, comme une machine. Tu es, toi aussi une petite partie de la chaîne. Tu prends la pièce, tu fais ton petit tour, tu donnes la pièce à ton voisin… une agrafe à gauche, une agrafe à droite… comme ça, le plus vite possible. Alors tu te fais mal ! Alors tu donnes un coup de poing dans le vide… Un coup de poing pour rien ! Un coup de gueule contre tout ! Un coup de gueule contre toi, alors que ça n’est pas de ta faute… c’est la faute du montage qui est mal fait ! C’est la faute de la chaîne ! C’est comme ça ! Le chef te fait une réflexion, te donne un ordre, il te prend la tête parce que le boulot est mal fait, mais tout le monde en à rien foutre. Tout le monde en à rien foutre de tout ici… Qu’est-ce qu’il y a devant nous ?… Comme avenir ? Devant nous il n’y a rien ! J’avais un métier dans les mains, mais maintenant je n’ai plus de mains. Après cinq ans de chaîne, j’ai des mains tellement grosses que je peux plus rien faire avec. J’ai un doigt, l’index, tellement douloureux… Le soir, ma gamine, j’ai envie de lui donner de mon temps… C’est pas possible, j’ai tellement mal aux mains ! Ma gosse, j’ai de la peine, les boutons de son gilet… c’est pas possible, j’ai tellement mal aux mains ! J’ai du mal à prendre un stylo, j’ai du mal à donner du sens aux mots, tous en même temps, les mots… J’ai des phrases dans ma tête, toutes en même temps, les phrases… Avant, j’avais envie d’un tas de livres, maintenant j’ai plus envie, plus besoin non plus. J’ai que des larmes dans les yeux le soir. Tout me donne la nausée. Ce qui me donne le plus la nausée, c’est ceux qui prennent des airs comme ça et qui te donnent des mots de-ci de-là sur la chaîne, la chaîne c’est comme-ci, la chaîne c’est comme ça ! La chaîne c’est la peur, la chaîne ça fout la trouille. » Tina s’est donnée à lui dès son arrivée sur la chaîne. Dès le premier jour et pour toujours. Tina est tombée amoureuse. Puis Charles est parti. Après l’échec de la grève. Il est retourné parmi les siens, pour prendre le dessert et préparer sa carrière. Tina est restée sur la chaîne, avec sa gosse née d’un père en promenade. Et dans les yeux de Tina, une couleur indéfinissable, comme une lumière éteinte, la flamme d’un espoir tenu, soufflée par le départ de Charles. « Ils n’ont jamais rien compris de qu’ils croyaient penser. » dira-t-il plus tard pour mettre un terme à cette période de sa vie.
« On a couché ensemble le jour de son premier anniversaire de mariage. » Charles répète ce fait en boucle comme pour lui donner l’allure d’une vérité. Lui qui n’a jamais rien aimé d’autre que le faux et le mensonge, artiste virtuose de la publicité, Charles aimerait que pour une fois les mots aient un sens. « Ça veut dire quelque chose non ? », les filles de la Porte Sublime hochent la tête d’un seul mouvement, un geste de professionnelles. Elles savent quand il faut acquiescer et quand il faut se taire.