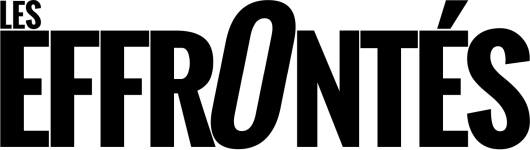(Suite de la première partie)
« Je l’ai rencontrée au bureau. C’était une stagiaire de ce con de Dufour. » L’évocation de son employé envoie Charles dans les souvenirs. Il lève son verre vide et avant qu’il ne soit redescendu, une fille de la Porte Sublime l’a rempli à nouveau. « Dufour est un con. Mais il a deux qualités : C’est un pédé – c’est important les pédés dans la mode – et il a le nez pour repérer la chatte fraîche. » Charles attire une fille à lui. Sa virilité n’est que posture et ses propos sont plus dérisoires que cyniques. La triste vérité est qu’il n’avait jamais trompé sa femme avant de la rencontrer. La stagiaire de ce con de Dufour s’appelle Murielle et ce n’est pas une stagiaire mais une doctorante en sociologie. Comme tous les étudiants de son amphi elle a lu La chaîne et comme tous les autres, elle a mis ce livre en bonne place sur sa table de chevet. Quand il la voit pour la première fois, Charles ne fait pas attention, les stagiaires n’ont pas d’existence. Ils ne restent pas assez longtemps pour que Charles s’embarrasse la tête. La deuxième fois, au cours d’une réunion, c’est Dufour qui l’a poussée du coude. Parce que ce con de Dufour n’en est pas un. La petite Murielle est une pointure. Elle pense vite, elle parle bien et sa joie est comme la valise diplomatique : elle franchit toutes les frontières. À cette réunion Charles lance à la cantonade ses aphorismes crus : « Rien n’est interdit, sauf ce qui ne rapporte rien ! » Charles toise l’assemblée de ses collaborateurs, il les défie de comprendre et de faire mieux. Les jugeant encore un peu trop à l’aise il passe la vitesse supérieure : « Que reste-t-il de la propagande nazie ? Débarrassée de l’idéologie et des croix gammées ? La pub et le fitness ! » Il est onze heures du matin et Charles tourne au Lagavulin sec. « Quelqu’un peut-il me dire ce que nous faisons ? » Tous baissent la tête. L’orage qui se prépare est une habitude des débuts de semaine. Tous les lundis, Charles soigne ses aigreurs en déversant sa bile sur ses subordonnés. Personne n’ose lui dire ce qu’il pense exactement, qu’il est ici pour la bonne raison qu’il doit gagner sa croûte. « Les voitures ! C’est plus facile à fabriquer qu’à vendre ! C’est pour ça que je suis plus riche qu’un ouvrier ! »
Ce lundi pour autant ne sera pas comme les autres. Il est resté gravé dans les mémoires des personnes présentes, ce jour-là quelqu’un a levé la main pour répondre. Murielle se lance. Elle est jeune, elle est grande, sa tête dépasse : « Nous participons à l’accroissement du capital ! » dit-elle, sans hésitation. Une forêt de regards la dévisage comme autant de spectateurs devant la chute improbable de Nadia Comăneci aux J.O. de Montréal. Murielle fait face. Les autres ont des expressions variées. Il y a les sincères, peu nombreux, qui tentent de lui faire comprendre qu’elle doit se taire. Les endormis que sa soudaine interruption réveille et la grande majorité de Romains qui se réjouissent déjà de la mort certaine de Sainte-Blandine… Qui résistera à la prison, aux lions, à la torture, au fouet, au feu et au taureau. Murielle ponctue son offensive éclaire par un : « Tu vois ce que je veux dire ? » qui pour tous ressemble à un suicide — il s’agit de l’expression favorite de Charles et Murielle ne le sait pas. Charles reste silencieux un court instant. Il fait tourner le liquide sombre dans son verre. Le chat va-t-il jouer avec la souris avant de la tuer ? Il enchaîne par une attaque en biais, un crochet de la rhétorique. « C’est vrai, même les plus pauvres ont quelque chose… » il laisse les mots se répandre dans la salle de réunion, parce qu’en vérité il ne sait pas quoi répondre. Jeune, il était le prince du débat d’idées. À l’École Normale Supérieure, il n’y avait pas tribun plus adroit que lui. Avec le temps, faute d’adversaires, son verbe a perdu de son tranchant et sa langue n’est plus aussi bien pendue qu’autrefois. Alors son silence est plus une tactique de défense qu’une stratégie d’attaque. « Oui », finit-il par dire. « Même les pauvres ont quelque chose… à dépenser. » La faiblesse de sa réponse laisse Charles mécontent. Il peut mieux faire, il a su mieux faire… qui c’est la pisseuse qui réplique quand tous les autres la ferment ? Il lève son visage vers son interlocutrice et quand son regard croise le sien, vingt-cinq années d’une vie sans risques disparaissent comme on referme une parenthèse après une identité remarquable. Ce regard qui ne baisse pas les yeux, ces épaules en fil à plomb, ce dos inflexible. Sauf que Charles ne regarde jamais en arrière, son esprit est comme la vitrine d’un grand magasin pendant les fêtes. Tout est beau, tout brille et tout va disparaître le mois suivant. Charles se conforte en se disant qu’il s’agit d’une « ruse de la raison », un truc de psy. Murielle attend sa réplique, qui ne vient pas. Un silence gêné guette le grand Charles. Murielle enchaîne alors, définitive : « Le capitalisme est cette chose merveilleuse qui a rendu rentable une chose aussi vaine que la masturbation ! »
Pendant un an ils sont amants. Ils se retrouvent le mercredi après-midi dans un petit hôtel du vingtième arrondissement. Ils décident de leurs cinq à sept au dernier moment, pour ne pas alerter leurs entourages. Puis, par deux chemins séparés ils se rejoignent dans la chambre 25 de l’hôtel des Pyrénées. Murielle est toujours la première. Elle se déshabille en attendant Charles et quand il arrive, ils passent à table. Charles apprécie beaucoup cette façon de faire. Ils ne se parlent pas, ils baisent. C’est du sexe à l’état brut, direct et directement du producteur au consommateur. Débarrassés des scories de la relation humaine, leurs transports sont intenses et fluides. Peau contre peau. À bouche que veux-tu. Ils ne se disent pas bonjour, ils ne se disent pas au-revoir. Il n’y a pas de promesses, pas de regrets, pas de trahison. Il n’y a que la réalité des corps. Une réalité épouvantable pour Charles. Il fait l’amour avec une femme qui a l’âge de sa fille. Jour après jour, il devient amoureux. Il se surprend à rêver d’une impossible vie commune. Le silence de Murielle ne le dissuade pas, bien au contraire. Charles devient fiévreux, il cesse d’exister. Que Murielle annule un rendez-vous, ça le rend soupçonneux et jaloux. Il oublie qu’elle est mariée, comme lui. Murielle rigole avec ce con de Dufour et Charles pique une colère. Une haine brûlante l’habite. De bourru il devient acariâtre et irascible. Son franc parler se mue en aigreur. Avec ses proches il est maussade et méchant. C’est qu’avec Murielle, il se sent heureux. Il guette l’instant où il la retrouvera, nue et disponible, comme un drogué vit en attente de la prochaine dose. Sa femme Caroline le soupçonne. Elle s’en ouvre à son fils aîné qui en parle à son père. Charles veut lui montrer qu’il est toujours un homme, il fanfaronne et se met à table. « Oui, j’ai une maîtresse. Oui je l’aime. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle. Elle est ce que ta mère n’a jamais été. » Son fils raconte tout. Caroline le somme de choisir. Pour faire pression, elle entre en contact avec Murielle. Elle est surprise de la trouver sympathique. Elles prennent un café un jour. Elles bavardent. Murielle la surprend. « Il n’y a rien entre Charles et moi. » Murielle la comprend. « Je vais lui dire que c’est fini. »Caroline peut enfin se détendre et goûter pleinement l’ironie de la situation : « C’est la loi de l’offre et de la demande. » dit-il souvent. Caroline se dit que l’action de Charles était surestimée. Il est temps qu’elle soit cotée à sa juste valeur. À ses côtés.
Charles a insisté, une dernière fois, un week-end entier. Une nuit ensemble dans le même lit. Une petite virée en Normandie et tout sera fini. Murielle accepte. Ils partent un samedi matin dans la grosse cylindrée de Charles, une voiture allemande. Il pleut des cordes. Au niveau d’Elbeuf la pluie redouble, d’une telle intensité que le jour lui-même ne parvient pas à se glisser entre les lames de ce rideau liquide. Charles s’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence. On ne voit pas à deux mètres. Il profite de l’occasion et se déboutonne. Il négocie pour ce qu’elle a constamment refusé jusqu’à présent. Il lui présente son sexe en érection. C’est un bon négociateur. Il veut qu’elle le suce, ici et maintenant, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute de Normandie. Un souvenir inoubliable sous une douche d’apocalypse. Pendant qu’elle s’exécute Charles lui parle de sa vie dans la région, de son travail à l’usine de Cléon, sur la chaîne. Il parle de ses camarades d’alors avec respect et admiration. Il parle de la lutte, de l’amitié. Il jouit dans le vrombissement d’un semi-remorque qui les dépasse en klaxonnant.
Plus tard, ils arrivent à Étretat. Charles a loué une suite dans le meilleur hôtel de la ville. Avec vue sur la mer et bain moussant. Ils descendent sous le même nom. « Ils croiront que je suis ta fille. » dit Murielle. Cette idée ne la faisait pas rire. Après s’être installés, ils allèrent faire un tour dans les rues désertées par le mauvais temps. Nichée au creux de ses falaises, comme une carie sur une molaire, Étretat vit du tourisme et du souvenir de ses fastes anciens. Sa plage de galets est faite pour la promenade et les bains de pieds. La ville vit ainsi à l’ombre de ses maisons à colombages et des visites de Victor Hugo. Parce qu’il a écrit une lettre à Adèle une fois, la moitié des rues et des places font référence à l’écrivain. On baptise des chambres d’hôtels et des spécialités de compotes de son nom. On ne lit plus les pages de Maupassant, de Maurice Leblanc ou d’André Gide, mais on exploite sans honte leur amour pour ce ciel crayeux et bas, pour cette mer opaline et calme. Murielle se fout de la littérature, elle attend la fin du week-end avec impatience. Ce qui était un jeu, une escapade de son couple est devenu pensum incontrôlable. Elle pensait à une petite étreinte améliorée entre adulte responsables et consentants, mais Charles est devenu lourd, collant. Un gamin. Il veut vivre une dernière fois avant de mourir. Il croit que répandre sa semence sur ses seins donnera un sens à sa vie inconsistante. Il est loin le temps de Charles L., auteur acclamé dans le cénacle germanopratin de la sociologie des évidences. « Je suis riche et j’exploite ceux qui ne le sont pas. Je suis devenu riche grâce à eux. C’est mon talent, je mérite mon argent. Je mérite vos applaudissements et votre respect.Quand les pauvres auront un Tolstoï, je deviendrai pauvre. » Murielle se retient de hurler quand Charles l’invite sur le sentier qui grimpe vers la Porte d’Aval. Ils croisent un couple de retraités qui descendent. « Faites attention » disent-ils, « il y a du vent là-haut. » Charles n’écoute plus. Il pense à un petit coup vite fait en regardant la Manche. Murielle a compris et se prépare. « Le connaissant ça va pas prendre cinq minutes. » Comment a-t-elle pu accepter un deuxième rendez-vous ? Elle savait qu’à partir de là il y en aurait un troisième, un quatrième… Et maintenant ce week-end insupportable pour se sortir du guêpier dans lequel elle s’est fourrée par faiblesse et par gentillesse. Sur le chemin Charles manque de trébucher deux fois. Il y a du vent mais aussi une pluie fine qui commence à tomber. « Rentrons », lui demande-t-elle, « j’ai froid » Charles ne répond pas. Il continue de sa marche pesante sa route vers le sommet. Le vent redouble d’intensité. Charles, plus lourd, fait face de sa masse. Murielle marche avec peine. Elle dépense beaucoup d’énergie à rester sur le sentier. Charles s’arrête un instant pour souffler et pour la laisser revenir à lui. « J’en ai plus que marre. », dit-elle. Il la laisse dire, le sommet est à dix mètres. Il lui montre de la main. « On est arrivé ! » Murielle le contourne et part devant. Une dernière fois. Elle ira d’une traite et elle redescend. Charles la regarde s’éloigner. En fait il n’en peut plus et s’apprête à faire demi-tour. Il regarde à nouveau Murielle qui s’en va, il regarde la mer, il regarde à nouveau Murielle… qui a disparu ! Charles regarde à nouveau le sentier vide. Le temps d’un regard vers la mer et Murielle a disparu ! Il se met en marche avec la dernière énergie. Passé le panneau de danger caché par les fougères, il est pris de côté par une violente bourrasque. Un vent de travers cisaille le sommet passé les dernières constructions de la ville. Malgré ses cent kilos, Charles manque d’être balayé. La pluie a rendu l’herbe glissante. Pendant un court instant il hésite entre s’approcher du bord de l’à-pic et redescendre dare-dare. Il crie le nom de Murielle, mais son hurlement est emporté par une rafale.
Le journaliste qui rédige la nouvelle a un beau-frère gendarme. Il lui a téléphoné et a juste dit : « Encore un mort sur la falaise. » Ça fera un très bon titre, se dit le journaliste. Il prend des notes en hochant de la tête, « Mmmh ! » répond-il, « D’accord ! » Puis encore une fois : « D’accord ! » et il repose le combiné sur sa base. « Encore un mort sur la falaise. » écrit-il avant de passer le nom de Murielle et de Charles dans un moteur de recherche. Quand il lit la notice biographique de Charles, il se dit qu’une nouvelle en fin de page ne sera pas suffisante. Il appelle son rédacteur en chef. Le lendemain, deux photos sont à la une. La première est une image de la veille montrant les pompiers et la gendarmerie à pied d’œuvre et la seconde est une image d’archive montrant Charles jeune et beau. L’impression est de faire croire que Charles est victime, pour finalement se préparer à un deuxième article le lendemain sur Charles L. et sa maîtresse de vingt-cinq ans sa cadette. « Un week-end d’amour vire au drame. » La renommée de Charles faisant le reste, l’affaire remonte à Paris. Alors que la justice rend son verdict et statue sur son innocence — un banal accident sans responsable — la presse fouille les égouts et les poubelles. Les journalistes savent lire. Ils lisent La chaîne et partent à la recherche des compagnons d’usine de Charles. Ils rencontrent Tina, une bonne cliente. Tina a vu sa beauté se faner. Elle est grosse et ses dents sont pourries, mais elle n’a pas sa langue dans sa poche. Son amour pour Charles s’est transformé en bile qu’elle répand à qui veut bien l’entendre. Son avenir perdu est devenu un ressentiment tenace qu’elle a conservé à l’abri des vicissitudes et de la corruption du temps. Une aigreur pure comme un accord parfait. Alors elle balance. Ça ne sert personne, mais ça fait du bien. À Paris, Caroline appelle son avocat. « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. » dit Dufour. Au nom du conseil d’administration on demande à Charles de se mettre au vert. Le temps qu’il faut pour gérer ses affaires. Il est revenu à Étretat. Un jour de beau temps. Sous un ciel de Normandie, quand un soleil discret joue à saute-mouton avec les nuages, comme des écoliers rougissants. Sur la promenade, personne ne prête attention à ce vieil homme à la démarche déréglée. « On a couché ensemble le jour de son premier anniversaire de mariage », dit Charles au vent neutre.