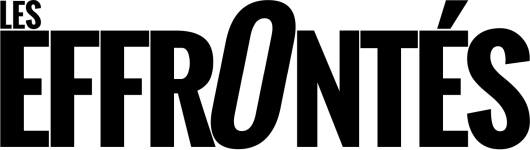Voici la quatrième et dernière partie de la traduction d’un extrait des mémoires de Jim Brown — un pionnier de la conception des multicoques de plaisance dans les années 1960. Après quatre jours de navigation et de convivialité entre Jim et son fils Russell, le bout du voyage approche… — TB
« Prao volant, prao volant… »
« Je me demande où nous sommes. », dit Russ, tandis qu’il reposait le panneau de descente sur sa bulle et que sa tête émergeait. « Et ben, le vieux Gloup Stream est encore tout retourné, hein ? » La mer avait diminué mais le vent était tombé encore plus que les vagues, et Kauri labourait lentement la bouillie agitée.
« Hé, tu as pu te reposer ? », demandais-je.
« Oui, bien sûr. », répondit Russ. Je le soupçonnais de dire la vérité, car son bateau était si doux et tranquille en bas. Il n’avait probablement pas idée à quel point ma séance dans ce coup de vent, avec son bateau, avait été intense, merveilleusement intense. « Mais maintenant il faut que nous remettions de la toile, et que nous pompions le ballast liquide hors du flotteur. Il naviguera mieux comme ça. Et nous devons découvrir où nous sommes. »
Tout en établissant la grand-voile, nous nous lamentions tous deux du manque de soleil visible. À la demande de Russell j’estimais que la route que j’avais prise, qui était en fait sur toute la moitié nord du compas, avait pu nous emmener vers New York à grande vitesse pendant quatre heures, et nous renvoyer vers Cape Cod pendant deux heures à une vitesse décroissante. Russell pris la barre et je descendis, regardais la carte et fis une estimation grossière de notre position. Je donnais à Russ un cap approximatif à suivre. « Okay », dit Russ, « mais nous avons une idée quelque peu meilleure d’où nous sommes. »
Je préparais deux sandwichs géants. Des tranches de fromage, de l’œuf brouillé, des tranches de tomate épaisses comme des palets de hockey, et de grandes feuilles d’épinards cuites à point furent laminées ensemble avec assez de mayonnaise pour vous couler le long du bras, et avec des paquets de germes de soja épais comme de la moquette entre chaque couche. Les germes fournissait le liant et la friction pour empêcher tout l’édifice de se répandre en morceaux à la première bouchée. Nous dévorâmes le repas. Une heure plus tard, alors que la lumière diminuait, Russ souleva la bulle et me lança : « Hé, papa, il y a une voile droit devant. » J’étais mort au monde, mais assez remué pour acquiescer. « Pourquoi tu n’essayes pas de les avoir à la radio ? » Vaseux, je me levait et passait la tête au dessus du pont pour regarder. Russell pointa une direction, plus au vent que je ne regardais. Après des plissements d’yeux somnolents, je vis la voile.
« Ils vont dans la même direction que nous », dit Russell, « et je paris que c’est l’un de ces bateaux qui est parti des Bermudes avant nous. Ils ont probablement de l’électronique de navigation à bord. La plupart des yachts en ont de nos jours. Peut-être que tu pourrais l’avoir à la radio et voir s’ils peuvent nous dire où nous sommes. »
J’essayais la VHF, mais n’eus pas de réponse. « Okay. », dit Russ, « Ils n’ont pas de raison d’avoir quoi que ce soit d’allumé par ici. Il va falloir se rapprocher et leur crier. » J’avais l’air intrigué. « Si tu prends la barre », dit Russ, « je vais remettre le grand foc et nous allons juste leur tirer la sonnette et dire bonjour. »
Quand la nouvelle voile fut mise et porta, Kauri recommença à lancer des embruns, et Russ me demanda de lui laisser la barre, ce que je fis avec plaisir. Russ fit lofer le bateau au près et commença à foncer à travers les vagues. Pourtant, il se faisait tard lorsque nous rattrapâmes la jolie yole. Seul dans le cockpit, un marin en ciré était penché sur la barre, sa capuche pointant avec hébétude le compas. Alors que Russ arrivait sur sa hanche au vent, encore hors de portée de voix, il me dit : « Pourquoi tu n’irais pas te promener sur le balancier, et nous lui donnerons un petit spectacle ? »
Avec enthousiasme, je passais par dessus les deux kayaks, la planche à voile et l’annexe qui étaient tous amarrés sur le trampoline. Je montais sur le flotteur, agrippant la patte d’oie du hauban retenait le mât. « Attend que je te fasses voler avant de le siffler. », dit Russ avec un rictus. Je souriais tandis que Russ virait au vent pour éviter une crête, embardait pour planter le bateau dans la face d’une autre, et abattait, prenant de la vitesse et soulevant le flotteur et moi un bon mètre et demi au dessus du sommet des vagues. Je poussais le même cri musical perçant avec lequel j’attirais l’attention de mes fils par dessus l’eau. Je n’étais qu’à quelques mètres de l’homme et il bondit comme s’il avait été piqué avec une épingle à chapeau. Se tournant vers le bruit insensé, il repoussa sa capuche et resta bouche bée devant nous. Tandis que Kauri croisait sa poupe précipitamment, le flotteur et moi descendirent avec bruit et éclaboussures, et les sourcils de l’homme grimpèrent à la moitié de son front.
« RAAAADIO ! », cria Russ, tenant son poing contre sa joue comme s’il parlait au téléphone. « Canal 16 ! » L’homme se recomposa, acquiesça vivement et se retrouva hors de vue derrière son foc tandis que Kauri passait à toute allure. Je courru à la nacelle et Russell sauta dans la descente. En une demi minute, j’entendis la radio beugler en bas : « Prao volant, prao volant. Ici le yacht Pinochle. Vous me recevez ? » Russ baissa le volume, et tout ce que je pus entendre de la conversation qui s’ensuivit fut l’habituel marmonnement, les chuintements et les craquements, mélangés avec le rire occasionnel de Russell. Quand ce fut terminé, Russ passa la tête au dessus du capot. « Et bien, il a dit que nous lui avons fait une peur du diable, mais que nous étions incroyablement beaux. N’est-ce pas gentil ? Et il nous a donné deux positions, l’une par SATNAV, l’autre par LORAN, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, je te donnerai un cap et une distance dans une minute. Mais le gars était vraiment sympa. Il savait vraiment ce qu’était un prao ! La plupart des plaisanciers ne seraient pas si aimables après une surprise comme ça. » Reconnaissant envers la yole, père et fils s’enfoncèrent dans la nuit.
Étrange regret…
Au matin la mer était calme et le vent revenu à l’est mais très léger. Le petit moteur hors-bord de Kauri bourdonnait, essayant de mouvoir suffisamment le bateau dans l’air pour amplifier le souffle de brise réelle avec du vent apparent. Ils aidaient le moteur juste un peu, et il gonflait les voiles. Au milieu de l’après-midi, la brise était partie, les voiles affalées, et le moteur continuait de bourdonner. Russ avait rempli le réservoir d’essence avec ses jerrycans trois fois. À présent les jerrycans étaient vides, mais le réservoir et l’équipage étaient pleins. Tandis que le bateau avançait sous pilote automatique, Russ et moi avions passé la plus grande partie du jour à manger et dormir. Il n’y avait toujours pas de soleil. Nous avions vu un cargo à l’horizon, en route vers New York, mais Russ ne pu l’avoir à la radio.
L’après-midi vieillit. Pour échapper au bruit du moteur, nous nous retrouvâmes assis l’un à côté de l’autre sur la banquette de la cabine, à écouter des cassettes. Russell avait une vaste collection de musique moderne et un bon système sonore dans le bateau. La construction légère de la carène, et la large carapace qui formait le pont par dessus la coque principale et la nacelle se combinaient pour faire de tout l’espace habitable une enceinte géante. Je m’aperçus que j’arrivais à comprendre les paroles de la musique nouvelle sans devoir utiliser le casque. Je suis un homme de mots, et je m’irrite normalement de la propension de nombreux chanteurs modernes à manger leur prononciation. À présent les paroles se révélaient, et je fut captivé par le portrait poétique qu’elles dressaient de l’époque et de la vie de mon fils.
Russ se levait occasionnellement et passait la tête par la descente, regardant longuement l’horizon, mais surtout nous écoutions des chansons en bouffant ; c’était des tacos au beurre de cacahuète chaud avec de la sauce sur des tranches de bananes trop mûres, des oignons des Bermudes mangés comme des pommes, et continuellement des M&M’s. Je réalisait que je n’avais pas pris une pilule contre le mal de mer depuis que nous étions partis des Bermudes.
À nouveau Russ étudia la carte et l’horloge. À ma surprise, il baissa le volume sur le lecteur de cassettes. Puis il dit : « Hé, papa, c’était un super voyage, tu ne trouves pas ? »
« Le meilleur, Russ. J’y pensais. Nous n’avons pas souvent quatre jours ensemble, juste nous deux, et un bateau fabuleux pour jouer dans le Gloup Stream. » Nous avons souris tous les deux.
« Et maintenant », dit Russ, « tout ce dont nous avons besoin c’est d’un peu de vent, ou d’un peu d’essence, et nous pourrons probablement atteindre Block Island avant l’obscurité. »
« Vraiment ? », me suis-je exclamé en me levant pour regarder au dessus de la descente. En cherchant à l’horizon par dessus l’étrave actuelle je vis… Était-ce quelque chose ? Oui, c’était quelque chose. « Terre. », dis-je sans exclamation, parce que je ressentais cet étrange regret qui saisit parfois le marin quand il approche de la fin d’une traversée. Je ne me sentais pas fou de joie à l’idée de terminer celle-ci. Nous étions partis juste assez longtemps pour nous acclimater complètement à la vie en mer, et je sentais que nous avions besoin de plus de temps pour nous dire des choses, le genre de choses qui demeurent trop souvent tues entre père et fils. Je savais que ce serait un déchirement de retomber sur terre. Mais ce que je voyais semblait en effet pouvoir être Block Island, cette grosse gare commode entre l’extrémité orientale de Long Island et Marthas Vineyard. Dans cette après-midi grise et confuse sur la mer vitreuse, elle n’était pas tout à fait « providentielle », mais c’était une île néanmoins. « Je vois. », dis-je dans la descente, sous mon aisselle, pour Russ. Ensuite, pour repousser mon regret et égailler notre atterrissage je citais l’un de nos dessins préférés de Jo Hudson. Le dessin, que nous connaissions tous deux par cœur, montrait une silhouette de marin hagard, fou de joie à la vue de la terre, criant : « Terre ! Ho ho ho, ha ha, hé hé, arf… beurk. »
Nous nous sommes rassis ensemble, avec la musique basse, et nous avons parlé du grand soulagement dont on fait parfois l’expérience en achevant une traversée océanique, spécialement si elle a été difficile. Mais à la place, à présent, nous confessions tous deux le sentiment d’une étrange déception. « C’est comme si, maintenant que nous nous sommes finalement habitués à patauger dans ce décor », dit Russ, « j’aimerais que ça puisse continuer toujours. »
« Oui. Juste naviguer à travers la vie. », dis-je, à demi sérieusement.
« Et bien d’une certaine façon, j’espère que cela continue toujours, papa. Je ne sais pas ce que je ferais dans la vie s’il n’y avait pas ces bateaux. »
« Je sais ce que tu veux dire, mais je voudrais te rappeler autre chose. »
« Ah ? »
« Oui. Grâce à toi, je viens de redécouvrir que naviguer dans la vie avec son fils, sa fille ou autre peut mener à certaines des plus belles navigations qu’on puisse connaître, et cela veut dire la meilleure vie qu’on puisse avoir. »
« Je suis censé comprendre quelque chose ? », dit Russ en souriant.
« Non, je ne te ferai pas du tout de reproche si tu n’as jamais de famille. Ça dépend de toi. C’est juste que faire un voyage comme celui-là avec toi… Quand j’y repense… Laisse-moi te dire : quand soudainement on devient père, on ne pense pas à des moments comme celui-ci, qui en résulteront un jour. Avoir une famille m’a presque rendu dingue parfois, je l’avoue. Mais maintenant, je ne saurais même pas qui je suis sans toi et Steve. » Je mis une tape sur le genou de Russell, en essayant de fanfaronner, en sachant que j’étais en train de fondre.
Une volée de coups de pagaie…
Nous approchons de l’île tard dans l’après-midi. Je soulève et secoue le réservoir d’essence ; il y a à peine un gargouillement étouffé dans le fond. Alors que nous approchons de l’entrée du port, le petit moteur bourdonne jusqu’à ce que nous ne soyons plus qu’à un stade de foot du brise-lames. Quand le hors-bord meurt, le silence tombe alors que Kauri glisse jusqu’à s’arrêter.
Deux autres voilier approchent au moteur, rentrant après ce qui a dû être un jour morne dans le détroit de Long Island. Je trouve une glène et, debout sur la proue actuelle, l’agite humblement pour être remorqué. Le premier voilier pas sans que l’équipage ne semble nous remarquer, bien que nous soyons presque sur leur chemin. Quelques minutes plus tard le second passe, son seul occupant pinçant manifestement le nez à l’idée de prendre en remorque à un si étrange engin. Je peste, mais Russ secoue la tête et dit : « Ça va papa, on va y arriver. »
Il détache son kayak, le glisse dans l’eau, saute dedans et attrape une pagaie. Il recule dans le tunnel entre les coques où je me penche pour attacher la remorque à la poupe du kayak.
Russell envoie une volée de coups de pagaie. Quand la remorque se tend, Kauri se raidit docilement à la traction, et lentement suit son créateur dans le port. Nous nous ancrons au crépuscule.