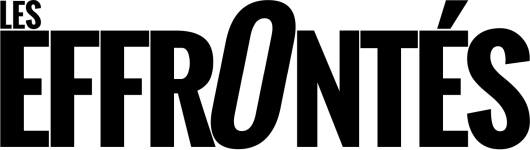Voici la troisième partie de la traduction d’un extrait des mémoires de Jim Brown — un pionnier de la conception des multicoques de plaisance dans les années 1960. Après que Russell l’a laissé seul aux commandes de son déconcertant navire, Jim s’étonne avec fierté des accomplissements de ses fils et de la docilité du prao Kauri. Mais la tempête n’est pas loin… — TB
Comme les anciens Austronésiens, Russell avait commencé à naviguer sur des radeaux. Il avait construit le sien pour traverser le coin de natation de Big Creek Canyon, en Californie. C’était assez normal pour un gamin de huit ans. Mais alors que je regardais le calme gris, en essayant de ne pas penser à descendre prendre mes pilules contre le mal de mer, ce qui m’étonnait était ceci : à l’age de treize ans, quand notre famille vivait sur le Rio Dulce au Guatemala, pourquoi Russell avait-il entrepris d’expérimenter avec les pirogues à balancier ? Il n’avait aucune connaissance de l’anthropologie du Pacifique, pourtant ses expérimentations ont commencé par une pirogue monoxyle grossière qu’il avait stabilisée par un balancier sur un côté. Elle était propulsée par une voile de Sunfish abandonnée et virait de bord comme un bateau normal, en recevant le vent d’un côté ou de l’autre. Mais elle virait avec difficulté, nécessitant que le garçon pagaye à la poupe avec l’aviron de direction, et il fallait se mettre beaucoup au rappel, athlétiquement, pour la garder sur ses pieds. La chose se montra à peine gérable, mais ce fut le véhicule de choix de sa véritable première aventure. Avec ma permission et celle de Jo Anna, donnée avec des tremblements, Russell descendit dans sa pirogue quelques dix-huit milles sur le Rio Dulce pendant deux jours, passant par sa magnifique gorge et un peu d’un vrai territoire de Tarzan, atteignant la ville isolée de Livingston, au Guatemala, sur la côte caribéenne. En remontant pendant trois jours, il rendit visite à des amis et à des familles indiennes le long du chemin. Je m’interrogeais sur cette expérience pour un garçon au début de l’adolescence. Sûrement, cela avait été formateur. Et, avoir navigué sur une embarcation dont le balancier se plaçait d’un côté ou de l’autre avait-il quelque peu induit Russell à choisir le prao de type pacifique, le balancier toujours au vent, pour continuer ses expérimentations ?
N’ayant rien à faire avec Kauri à la dérive, j’essayais d’ignorer le soulèvement maladif de la houle en laissant mes pensées s’éloigner. J’avais vu mes fils grandir au milieu du développement des multicoques modernes, et pourtant ni eux ni moi n’avions jamais vu un prao de type pacifique avant 1977, quand Russell conçu et construisit Jzero, son premier vrai prao, chez nous en Virginie. Il avait gagné les 600$ nécessaires en travaillant dans les champs de fraises locaux, et avait nommé le bateau d’après une chanson de Cat Stevens à propos un jeune se trouvant être un prophète extra-terrestre sur Terre, confondant tout le monde par ses vérités simples. Après une année intense de modifications du prototype à la maison, le voilier de 9 mètres en contreplaqué devint son moyen de partir à l’âge de seize ans. Jo Anna et moi avions réalisé qu’il partirait d’une façon ou d’un autre, et tout ce que nous pouvions faire était de coopérer. Jzero coopéra aussi. Il était fantastique pour son prix, mais la coque ne faisait que soixante centimètres de large. Néanmoins, Russell vécu à bord pendant deux ans, quelque fois avec une petite amie, et navigua dans de nombreuses île caribéennes, profitant d’une merveilleuse aventure de sa propre fabrication.
Ce ne fut pas tout. Tandis que Russell était au loin dans Jzero, Steven terminait son trimaran de 6 mètres, Moksa, en Virginie et, comme Russell, quitta la maison dans son bateau, cap au sud. Malgré la tristesse de voir notre progéniture nous quitter de cette manière, au moins nous étions soulagé que nos fils puissent sauter du nid sans le faire dans une voiture ou en devant payer un loyer, tout en ayant encore un chez-eux. Moksa était ainsi nommée selon la quête hindoue d’un état d’esprit paradisiaque, et le bateau était conçu et construit comme une reproduction fidèle d’une embarcation capricieuse qui apparaissait régulièrement dans les bandes-dessinées de notre vieil ami californien Jo Hudson. L’un des personnages des B.D. de Hudson était un gnome de Big Sur appelé Zachary Bone, protagoniste d’un long épisode où le vieux Zack se construisait un petit canoë à double balancier sur le flanc d’une montagne, le lançait d’une falaise et s’en allait vers le Pacifique avec une jeune fille appelée Violet Bush comme coéquipière. J’ai pensé : « Oh, le leurre de l’autonomie ! Est-ce un fardeau ou est-ce un don ? Et est-il juste d’endoctriner ses enfants avec de tels buts tentateurs, et pourtant jamais pleinement atteignables ? » Pendant des années Moksa fut « la monture la plus amusante » à Key West, en Floride, où Steven resta pendant un temps, et Jzero fut finalement vendu dans les Caraïbes à un acharné du surf qui comptait utiliser le bateau pour se transporter avec ses planches jusqu’à des sites de surf autrement inaccessibles.
En rentrant en Floride, à l’âge de 20 ans, Russ se construisit une version plus grande du prao. Baptisé Kauri, selon le bois exotique de Nouvelle-Zélande qui composait ses membrures, c’était celui dans lequel je me me trouvais à présent, dans un moment de calme grumeleux du Gulf Stream. Il faisait 11 mètres de long et, pour une traversée comme celle-ci, était capable d’accueillir un équipage de seulement deux personnes. En méditant sur ma position je pouvais presque entendre ma vieille coéquipière Jeannie Miller me dire : « Tu vas tomber sur une fille, un de ces jours. » Russell trouverait-il son équivalent de Violet Bush ? Je ne pouvais m’empêcher de me demander : cette vieille promesse que je m’étais faite de suivre la mer était-elle tenue par mes fils ?
Mes relations avec Steve et Russ durant l’évolution des deux praos et du trimaran de Steve avaient résulté en la plus pure forme de fierté, le genre qui vient à un parent qui apprend de sa progéniture, et dont la progéniture le sait. En dépit de mon scepticisme initial envers Jzero, la réussite de Russell avec lui m’avait vraiment renversée. Avec l’expérience d’un peu de navigation côtière sur Kauri, j’avais appris que c’était en effet une sérieuse machine à naviguer, et l’embarcation la plus douce et la plus près du vent que j’avais jamais connue. J’ai soupçonné alors, et je le pense encore, que le prao moderne a un vrai potentiel, avec beaucoup de choses à montrer au monde. Cette suspicion fut à la fois défiée et confirmée par ce qui arriva alors.
Juste, tu tires…
La pluie avait aplatie les vagues, mais comme d’habitude dans l’Atlantique nord, une houle considérable restait et elle était confuse, venant à la fois de l’est et du sud-ouest. Un conflit occasionnel ajoutait un crête à une autre, et quand cela arrivait sous le bateau, elle le soulevait puis laisser choir le grand prao comme s’il était dans un ascenseur fou furieux. Mais il n’y avais pas de grand roulis comme il y en aurait eu dans un monocoque, et ça ne tapait pas d’un flotteur à l’autre comme ce serait arrivé dans un trimaran. Je suspectais qu’un trimaran dans de telles conditions aurait subi occasionnellement un coup de roulis, quand l’ascenseur passait brusquement de la montée à la descente entre deux coques. Je songeais à prendre une pilule contre le mal de mer, mais décidait à nouveau que je n’en avait pas vraiment besoin.
Au début, la brise était difficile à distinguer dans le creux de la houle, mais bientôt je vis des pattes de chat sur l’eau, juste des petites tâches ondulées, laissées par les zéphyrs autrement invisibles qui bondissaient au ralenti par dessus les mottes huileuses. À mesure que la nouvelle masse d’air trouvait son chemin dans les creux, ses pistes se rassemblaient, ne laissant que des tâches de gras sur la surface finement martelée. À ce point, je fus capable de discerner sûrement que ce nouveau mouvement venait de l’est, et bien sûr le balancier de Kauri était du mauvais côté. Je ravalais l’envie d’appeler Russ, et essayais de me figurer quoi faire. J’étais content que Russ ait affalé le génois pour laisser passer le calme, mais je remarquais que la grande voile entièrement lattée, même à contre, portait toujours, essayant de faire avancer le bateau « en arrière », du moins du point de vue de la voile. Je décidais d’essayer quelque chose que j’avais vu Russ faire. Après quelques minutes à jouer avec les manches à balais, la bôme et les safrans coulissants, qui se levaient et se baissaient facilement par des drisses ramenées au cockpit, je réussis à faire virer l’étrave actuelle du nord vers l’est et jusqu’au sud, plaçant ainsi le balancier du côté au vent, où il doit être. Quel soulagement !
La grande voile, avec sa bôme, était maintenant libre de pivoter sur presque 180 degrés du côté sous le vent du bateau, alors je mollis l’écoute juste assez pour permettre à la bôme de se mettre sous le vent comme un drapeau. À présent je trouvais le bateau effectivement « garé ». De plus, il était directionnellement stable dans cette position. Contrairement au prao « atlantique », qui essaye de garder son flotteur sous le vent, l’ancien type pacifique, comme Kauri, laissera naturellement son balancier reposer au vent, même laissé entièrement à lui-même. Dans cette attitude, avec sa voile ne portant ni ne faseyant (grâce à ses lattes), il se trouvait comme voulu, le flotteur au vent et la nacelle sous le vent. Il attendait patiemment que je retrouve mes esprits ; j’aurais pu faire une sieste, finir un repas, changer de voile ou même faire un plongeon. (Le prao « atlantique » ne se tient pas naturellement dans cette position stable.) De plus, quand le moment viendrait de quitter le stationnement, j’aurais le contrôle complet pour mettre d’abord en mouvement une extrémité ou l’autre, dans presque n’importe quelle direction. En effet, j’avais vu Russell passer brusquement la marche arrière de son embarcation plusieurs fois. Naviguant avec la grand-voile seule, cette cascade pouvait être utilisée pour manœuvrer merveilleusement le bateau afin d’éviter le trafic, récupérer des gens au ponton et repartir, et s’arracher d’une barre sableuse après s’être échoué. Les procédures étaient différentes, mais certainement pas plus limitantes qu’avec les voiliers habituels, qui doivent bouger assez dans la direction de leur seule extrémité pointue pour avoir le moindre contrôle.
Ce n’est pas dire, cependant, que barrer un prao pacifique est intuitif pour l’esprit occidental. Par exemple : vent arrière ou au grand largue, quand un changement de cap mineur rend nécessaire de « virer de bord », on doit envisager la manœuvre comme l’ancien coéquipier de Russell, Mark Balogh, qui disait : « Tu descends la rue, tournes dans une allée, et ressort en reculant pour continuer à descendre la rue en marche arrière dans la même direction que tu avais. » (Cette analogie est mieux visualisée si elle est accomplie par une moto avec un side-car.)
Avec confiance, j’allais à présent sur « l’ex-proue », enlevais le grand foc de « l’ex-étai », le traînais jusqu’à la « proue actuelle » et l’endraillais sur « l’étai actuel », rattachais l’écoute et retournais au cockpit central. Là, je hissais et réglais le foc sur la « proue actuelle », bordais la grand-voile au dessus de la « poupe actuelle » du bateau et mettais le cap à nouveau sur Cape Cod, le navire et les voiles ayant été entièrement retournés afin de recevoir le nouveau vent sur le même côté que précédemment, le côté du balancier. Je pensais que c’était comme naviguer dans un miroir. Je ne savais pas tout à fait comment j’avais réussi la manœuvre, particulièrement la partie où j’avais tiré les deux manches l’un vers l’autre et utilisé l’un des safrans coulissants à l’envers, mais j’étais très content de moi et de faire route à nouveau. Peut-être que je commençais à saisir cet engin.
À présent je réalisais qu’il y avait en effet du vent. Il s’était levé rapidement à partir des pattes de chat, remplissant les trouées huileuses et poussant des vaguelettes compactes rapprochées les unes des autres. C’était le résultat visible, supposé-je, de l’air et de l’eau glissant maintenant l’un sur l’autre. J’ajustais les écoutes et surveillais le cap, qui était lu à présent sur le bord opposé du compas. S’il avait fait sombre, j’aurais retourné les feux de route.
Je n’avais pas plus tôt ré-initialisé le pilote automatique que vint un forcissement substantiel de la brise. Juste au cas où il y aurait des rafales dans ce nouveau système, je déconnectais le pilote et barrais à la main. Hé ! C’était amusant. À présent Kauri jetait en l’air des embruns et la tenue de barre était amusante. Je devais expérimenter de temps en temps pour voir de quel côté la « proue actuelle » tournait quand je poussais ou tirais le « manche actuel », mais juste le tenir me faisait me sentir absolument connecté au bateau. Sa réponse était si immédiate qu’il importait peu que je barre mal, car je pouvais rapidement envoyer l’autre message et il altérait aussi rapidement sa réponse. Mais ce vent était…
Bam ! Soudainement le bateau est surventé. Je lofe mais pourtant le bateau accélère, le grand foc tambourinant bruyamment.
Presque immédiatement Russell bondit de la descente en sous-vêtements. Je suis figé à la barre, les yeux écarquillés et fixés au foc, faisant de mon mieux pour rester à la limite de l’aulofée. Il laisse filer la drisse du foc, qui se met à battre comme un tambour. Il rampe vers l’avant pour tirer la voile vers le bas. En luttant pour la contenir, il me crie : « Gare-le, papa. Faut juste le garer ! »
Pourquoi n’ai-je pas commencer par cela ? Je laisse filer entièrement l’écoute de grand-voile. Soudainement, tout est sous contrôle. Le vent souffle mais bateau est immobile dans l’eau, sans s’élancer et sauter par dessus les vagues. Russ met le foc dans le sac et l’attache sur le trampoline, vient au cockpit pour relever le safran coulissant et dit finalement par dessus le vent : « Purée, ça a forci d’un coup. »
« Et ça continue de forcir. Que penses-tu de ces vagues ? »
« Et bien, elles deviennent de plus en plus raides. Le vent en souffle déjà un peu les crêtes, et si ça continue de monter, contre le courant, comme ça, le vieux Gulf Stream va faire des pirouettes. Nous ferions mieux de nous y préparer.
« Tu ne veux pas te sécher et te couvrir ? », lui demandais-je, remarquant qu’il était couvert d’embruns et tremblant.
« Non, les embruns sont chauds et je ferai aussi bien de ne me sécher qu’une fois. Affalons la bôme et la grand-voile sur le pont, et puis hissons le tourmentin. Comme ça, tu seras invulnérable quoi qu’il arrive, parce que je dois vraiment me reposer. »
Je me crispe à la perspective d’être laissé seul avec le bateau dans des conditions venteuses, mais j’aide à préparer Kauri du mieux que je peux.
Russ frissonne en hissant le petit foc et met le navire à nouveau en route. Le bateau glisse de son stationnement dans un trafic croissant. Tout en testant la barre d’une main, Russ commence à activer la grosse pompe à diaphragme de l’autre main, cela pour charger le flotteur du balancier d’un ballast d’eau. Il me donne les instructions : « Installe-toi dans le cockpit très bas, comme ceci, papa, et passe ton bras autour de la baume juste ici. Comme ça tu ne peux pas être éjecté. Et avec ce petit bout de voile, plus de l’eau en ballast là-bas, dans le flotteur, il n’y a pratiquement aucune chance que le vent chavire le bateau. »
« Je vois ce que tu veux dire », dis-je.
« Mais ce dont nous devons nous inquiéter, ce sont les vagues scélérates. Nous sommes en plein dans le Gulf Stream, ou un gros tourbillon peut causer des vagues monstrueuses. Alors si tu en vois venir une grosse, souviens-toi juste de tirer. C’est tout ce que tu dois te souvenir : tire sur le manche, et le bateau abattra et fuira ce qui approche. Okay ? »
« Okay, je devrais pouvoir me souvenir de cela. »
« Bien. », implore Russ. « Si tu as un doute, juste, tu tires ! »
Avec cela, Russell se tortilla dans la descente, mais tandis qu’il fermait le capot, il me regarda à travers la bulle et sourit. Je parvins à grimacer en retour. Russell souleva le capot juste assez pour que je vois ses yeux, en me criant : « Souviens-toi juste de tirer. »
Dans les quelques minutes qui suivirent, nous eûmes une autre augmentation significative du vent, et je me sentis trembler dans le cockpit en side-car. Le bateau accéléra à une vitesse surprenante pour la taille de son tourmentin. « C’est à moi de jouer. », me dis-je. « Le pauvre garçon a barré toute la nuit sous la pluie, et il me fait confiance pour le remplacer. »
Pendant l’heure suivante, je barrais le bateau à travers des vagues de plus en plus fâchées en esquivant les crêtes. J’en vis certaines qui étaient vraiment en forme mais je parvins à les manquer avec une grande marge. Il semblait à présent qu’elles se développaient rapidement, bondissant et s’effondrant partout. Je ne voulais pas tourner les fuir toutes, car cela nous aurait emmené au New Jersey au lieu de Cape Cod. Si ça devenait vite chaud juste devant, je devrais prendre un décision immédiate : « Dois-je lofer et passer son sommet face au vent ou abattre et la fuir ? » Russell disait de tirer, d’abattre dans le doute, c’est donc ce que je ferais.
L’effet du ballast d’eau dans le flotteur, loin au vent, ajoutait une réelle sensation de sécurité à l’allure du bateau, et je réalisais que Russell avait raison. Tout ce dont nous devions nous inquiéter était d’être pris en travers par une vraie grogneuse cascadante.
Juste à la fin de cette pensée je sentis l’ascenseur monter. Il montait vite, de plus en plus haut. Je tirais sur le manche instantanément, mais il fallut de précieuse microsecondes pour que ma traction spasmodique le déplace, et il fallut ce qui sembla des heures à la « proue actuelle » pour glisser vers le creux.
Nous sommes jetés par une catapulte géante, d’une grande hauteur, vers bas ; dépassant la gravité, passant en apesanteur, en piqué ; pris sous le marteau dans les profondeurs ; renvoyé dans le side-car par un canon à eau, dans le noir ; remontant les chutes du Niagara dans un tonneau ouvert. La saumure chaude me ramone le nez, passe dans ma gorge et mes manches. Mon bras droit est agrippé à la bôme et à la grand-voile ferlée, mon bras gauche tire toujours sur le manche. Les vagues rugissent profondément et le safran gémit bruyamment ; les deux sons se ressentent dans le manche.
Nous avons pris la vague, j’en suis sûr, mais je ne peux pas le voir. Mon visage est tabassé par l’eau déferlant. Je ne peux ni respirer, ni ouvrir les yeux. Je dois être en train de sur-barrer la vague. Toussant la bouche close, crachant le souffle de mes joues gonflées contre le jet, je visualise le bateau faisant un cent quatre-vingt sous la cascade. Cela mettrait le balancier du mauvais côté et pourrait nous retourner sur notre pont. Je dois faire un pas en aveugle vers le Grand Peut-Être en poussant le manche pour corriger notre invisible course sur la vague. Je me force aveuglément à remettre le manche à la verticale.
Le rugissement et le gémissement continuent mais la lance à eau dans la figure diminue. J’ouvre les yeux, avale de l’air, et voit l’eau couler du pont, et il n’y a que deux longs éventails d’embruns, l’un de chaque côté de la « proue actuelle », s’écaillant en l’air, fantastiques dans la lumière du soleil. Celui du côté du side-car a été la source de la lance à eau, mais à présent il passe à côté de mon oreille. Au delà de la proue, je vois le creux de la vague, courant devant loin en dessous. Par réflexe, je secoue et tire le manche, disant à Kauri de poursuivre cette vallée. Il le fait, et le gémissement de son safran faiblit progressivement devant les chocs et les cahots qu’il prend en courant par dessus les bosses sur le chemin.
Kauri dépasse maintenant le creux et entre dans le contre-courant coulant de l’autre versant. Le bateau ralenti mais la lance à eau reprend. Je m’en détourne, étirant le cou pour regarder d’un œil en arrière. Là, je vois la cascade. Quelques instants avant elle a dû être presque verticale, dressant Kauri sur son nez, mais maintenant c’est un grand arpent de saumure blanche et bleue aplatie en un bouillon tourbillonnant. Je tâte mes lunettes ; elles sont parties.
Puis je m’interroge sur ma propre conscience, car j’entends le son d’un rire ! Je me tourne et je vois le visage de Russell dans la bulle, la bouche en forme de « Ha ! ». Le capot se soulève d’un pouce, et Russ lance « Je parie que ça fait longtemps que tu n’avais pas surfé sur une vague pareille… Ha ha ha ha ! » Le capot se referme et le visage disparaît. Ma confusion se transforme en chagrin, puis en dépit, puis en fierté. Je ris aussi.
« “Ha ha ha” toi-même. », je crie. « Tu me prends pour qui, un cascadeur ? » J’entends Russell rire en dessous. Puis je murmure pour moi-même : « Bon dieu ! Pour qui me prend-t-il ? Je n’avais jamais vu, et encore moins surfé sur une vague pareille. »
Ces mots me sortirent de ma frousse. Je regardais anxieusement vers le vent. Avec précaution, je remis le bateau sur le cap et le sentis accélérer rapidement. Je remarquais que la capuche de mon ciré, soufflée, pendait dans mon dos remplie d’eau, et mes lunettes pendaient à leur ficelle dans la capuche. L’eau avait trouvé son chemin dans mon cou et jusqu’à mon entrejambe. En effet, je me rappelais maintenant avoir senti l’eau pompée dans ma manche et sortant par mon col. J’étais assis dans ce qui semblait une barrique de pisse contenue dans le fond de mes vêtements « imperméables ». Cela n’avait pas d’importance, n’est-ce pas ? Ce qui importait, c’était les autres vagues. Il y en avait plein partout, mais rien en vu comme celle sur laquelle j’avais surfé.
Même si le coup de vent ne dura que cinq heures, il y eut des centaines de brisants et plusieurs autres cascades à s’occuper pendant ce temps. J’appris à les éviter. Je regardais plus loin et plus au vent, me permettant de juger pour quelles vagues en construction tirer et pour lesquelles pousser. Avec notre mini-foc nous gardions une vitesse dans les quinze nœuds, je pouvais donc littéralement les contourner, comme on serpente entre des dunes en moto, sauf que ces dunes bougeaient aussi. Bientôt j’eus le coup de main, et je me sentis assez confiant pour relâcher ma prise sur la bôme. Avant longtemps je pris du plaisir, espérant, en fait, l’occasion de prendre les prochaines décisions quant au chemin à prendre pour contourner les crêtes. Pendant un long moment je continuais ainsi, sculptant la traînée vaporeuse de Kauri le long des vallées renversantes et par dessus les cols connectant les vagues. Il me semblait qu’avec de la pratique on pourrait apprendre à faire cela toute la nuit, mais il serait plus sûr, pensais-je, de courir vent arrière en remorquant un traînard. À présent c’était le jour et la navigation était glorieuse. Même en atteignant une vitesse casse-cou dans une sorte de slalom géant continuel, le bateau m’envoyait le message qu’il était absolument collé à la route océanique.
(À suivre…)