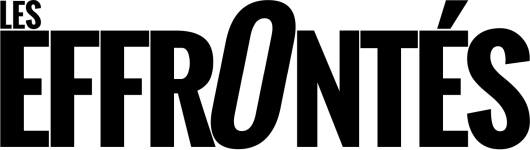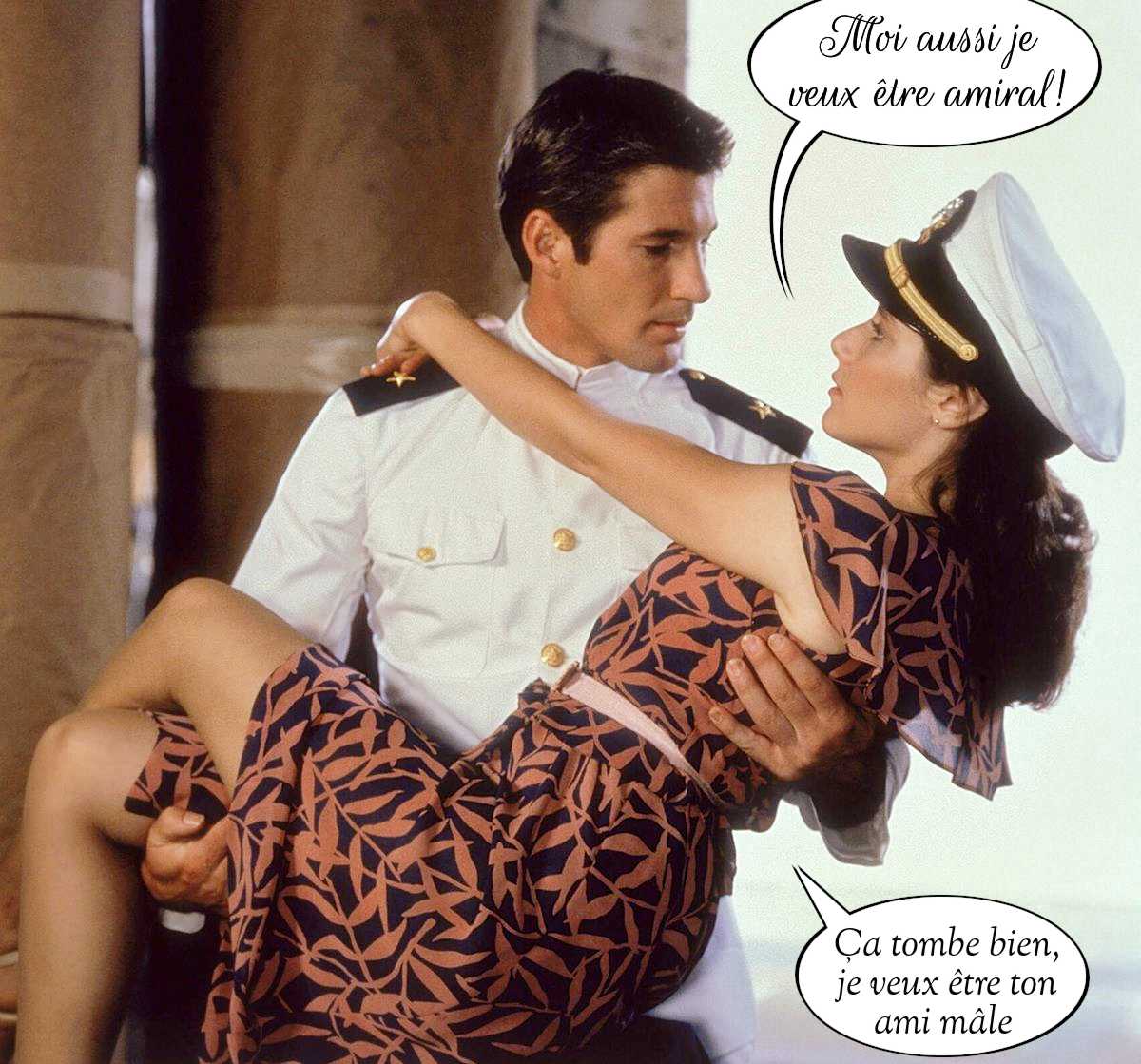Ceci est une traduction de l’article « Sexual Economics, Culture, Men, and Modern Sexual Trends », par Roy F. Baumeister & Kathleen D. Vohs, paru dans le journal Society en 2012. Si les travaux de Roy et Kathleen apportent un brillant éclairage sur le versant matrimonial du marché sexuel, ils demeurent aveugles à ce qui n’apparaît pas dans les statistiques socio-économiques : le désir viscéral, qui engendre des relations sexuelles passionnées mais rarement durables et influence souterrainement l’ensemble des comportements sexuels féminin. Pourtant, l’articulation des deux versants de la sexualité féminine — le désir et le besoin — clarifierait certaines tendances que nos deux chercheurs observent sans parvenir à les expliquer convenablement par la seule théorie de l’économie sexuelle. J’ai inséré quelques commentaires pour compléter d’un peu de pilule rouge ce fort intéressant papier. — TB
Vers la fin du XXe siècle, les idées sur le sexe provenaient de deux sources principales. L’une était la théorie évolutionniste, basée sur la biologie. L’autre était la théorie féministe et constructiviste sociale, basée sur les sciences politiques. Bien que ces deux sources aient apporté des idées importantes, de plus en plus d’éléments n’entraient pas facilement dans l’une ou l’autre de ces théories. Nous nous sommes donc tournés vers un autre domaine pour développer une nouvelle théorie. Ce domaine était l’économie, et nous avons appelé notre théorie « l’économie sexuelle ». Au départ, notre théorie était construite pour s’adapter à ce qui était déjà connu, ce qui en faisait un exercice rétrospectif. Il est par conséquent très révélateur de voir comment cette théorie s’est accordée avec les études pionnières de Regnerus et Uecker [voir bibliographie en fin de billet] sur les changements récents et actuels dans le comportement sexuel de la société américaine.
La valeur d’une perspective économique est très claire dans les travaux de Regnerus. Il n’analyse pas seulement le comportement en termes de marchés. Dans une démocratie politique, la majorité l’emporte, et ce principe politique a souvent influencé le comportement humain. Mais pas en matière de sexualité. En fait, Regnerus montre à maintes reprises qu’en matière de sexualité, c’est la minorité qui l’emporte. C’est ce qui se passe en économie, en particulier dans la dynamique de l’offre et de la demande. Lorsque l’offre est supérieure à la demande, les fournisseurs (la majorité) se trouvent en position de faiblesse et doivent céder du terrain, par exemple en réduisant leurs prix. En revanche, lorsque la demande dépasse l’offre, les fournisseurs (désormais minoritaires) ont l’avantage et peuvent dicter leurs conditions, par exemple en augmentant les prix.
En termes simples, nous avons proposé que dans le domaine sexuel, les femmes constituent l’offre et les hommes la demande. D’où les conclusions antidémocratiques et apparemment paradoxales de Regnerus sur le rapport entre les sexes. Lorsque les femmes sont minoritaires, le marché sexuel se conforme à leurs préférences : relations engagées, virginité généralisée, partenaires fidèles et mariage précoce. Par exemple, les universités américaines des années 1950 se conformaient à ce modèle. Dans notre analyse, les femmes tirent profit de telles circonstances, car la demande pour leur sexualité dépasse l’offre. En revanche, lorsque les femmes sont majoritaires, comme c’est le cas aujourd’hui sur les campus universitaires et dans certaines communautés ethniques minoritaires, les choses évoluent vers ce que les hommes préfèrent : beaucoup de relations sexuelles sans engagement, mariage tardif, relations sexuelles extraconjugales, etc.
Commentaire : S’il est exact que les femmes participent à un nombre historiquement élevé de relations sexuelles sans engagement, il est notable qu’un nombre croissant d’hommes n’ont pas ou peu accès à la sexualité (ce n’était pas encore évident en 2012). Autrement dit : les femmes ont certes abaissé le prix du sexe, mais seulement pour une partie des hommes. Ici, la théorie économique de Roy échoue à prendre en compte une attente des femmes si peu observable dans les statistiques et les enquêtes : copuler avec les mâles authentiquement désirables (les alphas, dans le jargon de la pilule rouge). Les données des applications de rencontre suggèrent que seuls 20% des profils masculins sont considérés comme passables par les utilisatrices, et moins de 5% suscitent du désir. Sur ce sous-marché, ce sont ces mâles d’élite qui représentent l’offre rare et les femmes qui constituent la demande surabondante. C’est pour eux qu’elles bradent le prix du sexe, non pour les hommes en général. Au contraire, l’ascension éducative et économique des femmes les dispense de négocier avec le nombre croissant d’hommes moins attrayant sexuellement qui ne peuvent plus leur offrir un niveau de vie et un statut social supérieur au leur. Le marché sexuel traditionnel, basé sur un échange de nature économique, se trouve ainsi en récession en dépit d’une sexualité féminine débridée. — TB
Il est à la mode de décrire toutes les relations entre les sexes comme reflétant l’oppression et la victimisation des femmes. Lorsque les femmes étaient minoritaires parmi les étudiants, cela était interprété comme indiquant qu’elles étaient victimes d’une discrimination oppressive. Maintenant qu’elles sont majoritaires, elles sont victimes parce qu’elles ne peuvent pas dicter les conditions de leur comportement amoureux et sexuel. Une grande partie de l’analyse de Regnerus respecte cette tradition dominante. Nous respectons également cette tendance, mais en tant que spécialistes en sciences sociales intéressés par les deux sexes, nous allons profiter de cette brève remarque pour corriger le déséquilibre habituel en discutant de certaines implications pour les hommes.
Les marchés sexuels prennent la forme qu’ils ont parce que la nature a biologiquement créé un désavantage chez les hommes : un énorme désir sexuel qui rend les hommes dépendants des femmes. [Les femmes étant d’avance dépendantes des hommes pour leur approvisionnement, leur protection et celles de leur progéniture, il fallait un mécanisme qui implique le mâle dans l’élevage des petits bien plus fortement et durablement que chez les autres primates — TB] Le désir plus important des hommes les place dans une position désavantageuse : tout comme lorsque deux parties négocient une vente ou un accord potentiel, celle qui est la plus désireuse de conclure l’accord se trouve dans une position plus faible que celle qui est prête à renoncer à l’accord. Les femmes ont certes aussi des désirs sexuels, mais tant que la plupart d’entre elles en ont moins que la plupart des hommes, elles bénéficient d’un avantage collectif, et les rôles sociaux et les interactions suivront des schémas qui leur confèrent un pouvoir plus important que celui des hommes. Nous avons même conclu que la répression culturelle de la sexualité féminine tout au long de l’histoire et dans de nombreuses cultures différentes trouve en grande partie son origine dans la recherche d’un avantage commercial. Les femmes ont souvent maintenu leur avantage sur les hommes en faisant pression les unes sur les autres pour limiter l’offre sexuelle disponible pour les hommes. Comme pour tout monopole ou cartel, la restriction de l’offre entraîne une hausse des prix.
Il convient de souligner que la répression culturelle de la sexualité féminine constitue une victoire particulière pour la théorie de l’économie sexuelle. Les deux perspectives théoriques dominantes sur le sexe, la psychologie évolutionniste et la théorie féministe/constructionniste, prédisaient toutes deux fortement le contraire. Dans un rare accord entre ces deux perspectives, les deux proposaient que les cultures répriment la sexualité féminine pour servir les intérêts masculins, et donc que l’influence masculine avait été primordiale. La théorie évolutionniste affirmait que la répression culturelle de la sexualité féminine était apparue parce que les hommes voulaient restreindre la sexualité des femmes afin de s’assurer que leurs partenaires leur seraient fidèles (et que les hommes puissent être sûrs de leur paternité). La théorie féministe renvoie presque toujours à l’oppression masculine, et la répression culturelle de la sexualité féminine reflétait donc le désir des hommes de dominer les femmes, de les posséder et/ou de les empêcher de trouver leur épanouissement sexuel. Dans les deux cas, la répression culturelle de la sexualité féminine devait provenir des hommes. Pourtant, les preuves indiquaient de manière écrasante que la répression culturelle de la sexualité féminine était propagée et maintenue par les femmes. Seule la théorie de l’économie sexuelle a prédit ce résultat. À l’instar de l’OPEP qui cherche à maintenir un prix élevé du pétrole sur le marché mondial en limitant l’offre, les femmes ont souvent cherché à maintenir un prix élevé pour le sexe en limitant leur disponibilité à fournir aux hommes ce qu’ils veulent.
Parfois, les hommes ont cherché à améliorer leurs chances d’avoir des relations sexuelles en maintenant les femmes dans une situation défavorable sur le plan économique, éducatif, politique et autres. Par exemple, des chercheurs ont découvert qu’à New York, dans les années 1800, un nombre étonnamment élevé de femmes actives recouraient occasionnellement à la prostitution pour compléter leurs maigres salaires. Mais en général, cette stratégie masculine s’est retournée contre eux. Les femmes semblent avoir pris conscience collectivement que le sexe était la principale chose qu’elles avaient à offrir aux hommes pour obtenir une part de la richesse de la société, et elles ont donc restreint autant que possible l’accès sexuel afin de maintenir un prix élevé. Des travaux récents ont montré que, dans un large échantillon de pays aujourd’hui, la libération économique et politique des femmes est corrélée positivement à une plus grande disponibilité sexuelle. Ainsi, l’accès des hommes au sexe s’est avéré être maximisé non pas en maintenant les femmes dans une situation économique défavorisée et dépendante, mais en leur laissant un accès et des opportunités abondantes. Dans un sens important, la révolution sexuelle des années 1970 a été en soi une correction du marché. Une fois que les femmes ont eu accès à l’éducation et à la richesse, elles n’ont plus eu besoin de prendre le sexe en otage.
Commentaire : Des millions de gentils puceaux et de maris frustrés peuvent témoigner du contraire. Roy se fourvoie en imaginant que la croissance de l’activité sexuelle a bénéficié aux hommes en général. Seul l’accès de certains hommes au sexe a été maximisé (voir commentaire plus haut). La Révolution sexuelle a substitué à une économie sexuelle régulée, humble mais égalitaire (la plupart des hommes étaient mariés et avaient accès régulièrement à un minimum de sexe, et en conséquence à la possibilité d’avoir des enfants), à une concentration inédite de richesse sexuelle pour une minorité d’hommes et une misère abjecte pour d’autres, et entre les deux extrêmes un déclin de la sexualité dans les couples ordinaires. À la décharge de Roy, cette situation était moins évidente au moment de l’écriture de ce papier. Les études longitudinales ont montré ultérieurement l’ampleur du désastre. — TB
Qu’est-ce que tout cela signifie pour les hommes ? Les tendances sociales suggèrent l’influence continue d’un fait stable, à savoir le fort désir des jeunes hommes pour l’activité sexuelle. À mesure que l’environnement a changé, les hommes ont simplement adapté leur comportement pour trouver les meilleurs moyens d’atteindre ce même objectif. En 1960, il était difficile d’avoir des relations sexuelles sans être marié ou au moins fiancé, et les hommes se mariaient donc tôt. Bien sûr, cela exigeait plus que d’être prêt à se mettre à genoux, déclarer son amour et offrir une bague. Pour être considéré comme un bon parti, un homme devait avoir un emploi ou au moins de solides perspectives d’emploi (par exemple, grâce à un diplôme universitaire imminent). L’objectif primordial de l’homme, qui était d’avoir des relations sexuelles, le motivait donc à devenir un citoyen respectable contribuant à la société.
Le fait que les hommes soient devenus des membres utiles de la société grâce à leurs efforts pour obtenir des relations sexuelles n’est pas anodin et peut contenir des indices importants sur la relation fondamentale entre les hommes et la culture. Bien que cela puisse être considéré comme une caractérisation peu flatteuse et ne puisse à l’heure actuelle être considéré comme un fait avéré, nous n’avons trouvé aucune preuve contredisant le principe général fondamental selon lequel les hommes feront tout ce qui est nécessaire pour obtenir des relations sexuelles, et peut-être pas beaucoup plus. (L’un d’entre nous a caractérisé cela dans un ouvrage précédent en disant : « Si les femmes cessaient de coucher avec des connards, les hommes cesseraient d’être des connards. ») Si, pour obtenir des relations sexuelles, les hommes doivent devenir des piliers de la communauté, mentir, amasser des richesses par des moyens honnêtes ou malhonnêtes, être romantiques ou drôles, alors beaucoup d’hommes feront précisément cela. Cela donne à la libéralisation sexuelle actuelle sur les campus universitaires un aspect moins attrayant qu’il n’y paraît à première vue. Donner aux jeunes hommes un accès facile à une satisfaction sexuelle abondante prive la société d’un de ses moyens de les motiver à apporter une contribution précieuse à la culture. [Donner à une minorité d’hommes excitants un accès facile au sexe et en priver ceux dont l’attrait se limite à être de dociles et laborieux compagnons potentiels est encore plus démotivant. — TB]
Les changements intervenus dans la politique sexuelle depuis 1960 peuvent être considérés comme un immense compromis, dans lequel les deux sexes ont cédé quelque chose qui leur importait moins afin d’obtenir quelque chose qu’ils désiraient davantage. Comme l’affirme Regnerus, en se basant en partie sur notre propre enquête approfondie des résultats de recherche, les hommes veulent du sexe, bien plus que les femmes. Les femmes, quant à elles, veulent non seulement se marier, mais aussi avoir accès à une carrière et bénéficier d’un traitement préférentiel sur leur lieu de travail.
Cet immense compromis impliquait donc essentiellement que les hommes accordent aux femmes, non seulement un accès facile, mais aussi un traitement préférentiel dans les grandes institutions qui composent la société, institutions créées par les hommes. Aujourd’hui, la plupart des écoles, universités, entreprises, organisations scientifiques, gouvernements et de nombreuses autres institutions ont mis en place des politiques visant explicitement à protéger et promouvoir les femmes. Il est courant d’embaucher ou de promouvoir une femme plutôt qu’un homme ayant les mêmes qualifications. La plupart des grandes organisations ont mis en place des politiques et des organes de surveillance qui protègent les intérêts des femmes et garantissent qu’elles bénéficient d’un traitement préférentiel par rapport aux hommes. Les politiques ou structures parallèles visant à protéger les intérêts des hommes sont largement inexistantes et, dans de nombreux cas, explicitement interdites. Les juristes, par exemple, soulignent que toute nouvelle loi importante est soigneusement examinée par des juristes féministes qui critiquent rapidement tout aspect pouvant être problématique ou désavantageux pour les femmes, de sorte que toutes les nouvelles lois sont favorables aux femmes. Personne ne veille aux intérêts des hommes, ce qui a accéléré les changements structurels favorisant les femmes et désavantageant les hommes. [À ce propos, lire Le mythe de la misogynie 1, 2, 3, 4, par John Tierney — TB]
Tout cela est quelque peu ironique, dans le contexte historique. Les grandes institutions ont presque toutes été créées par des hommes. L’idée que les femmes ont été délibérément opprimées en étant exclues de ces institutions nécessite une approche astucieuse, sélective et biaisée. Même aujourd’hui, le mouvement féministe est l’histoire de femmes qui réclament une place et un traitement préférentiel dans les structures organisationnelles et institutionnelles créées par les hommes, plutôt que celle de femmes créant elles-mêmes des organisations et des institutions. Cela reflète très certainement l’une des différences fondamentales entre les motivations des hommes et des femmes, c’est-à-dire que la sociabilité féminine est fortement axée sur les relations individuelles, tandis que la sociabilité masculine s’étend à des réseaux de groupes plus larges et de relations moins profondes. Pour le dire crûment, les femmes ne créent presque jamais de grandes organisations ou de grands systèmes sociaux. Ce fait peut expliquer la majeure partie de l’histoire des relations entre les sexes, dans laquelle la quasi-égalité entre les sexes des sociétés préhistoriques a été progressivement remplacée par une inégalité croissante, non pas parce que les hommes se sont unis pour opprimer les femmes, mais parce que le progrès culturel est né de la sphère masculine, avec ses vastes réseaux de relations superficielles, tandis que la sphère féminine est restée stagnante, car sa structure sociale mettait l’accent sur des relations individuelles intenses, au détriment de presque tout le reste. Partout dans le monde et tout au long de l’histoire (et de la préhistoire), la contribution des grands groupes de femmes au progrès culturel a été négligeable.
Bibliographie
Bettina Arndt, The Sex Diaries: Why Women go off Sex and other Bedroom Battles, Melbourne University Press, 2009
Roy F. Baumeister, Meanings of Life, Guilford Press, 1991
Roy F. Baumeister, Is There Anything Good About Men?, Oxford University Press, 2010
Roy F. Baumeister & Juan Pablo Mendoza, « Cultural Variations in the Sexual Marketplace: Gender Equality Correlates with More Sexual Activity. », The Journal of Social Psychology, 2011
Roy F. Baumeister & Kristin L. Sommer, « What Do Men Want? Gender Differences and Two Spheres of Belongingness: Comment on Cross and Madson » Psychological Bulletin, 1997
Roy F. Baumeister & Jean M. Twenge, « Cultural Suppression of Female Sexuality », Review of General Psychology, 2002
Roy F. Baumeister & Kathleen D. Vohs, « Sexual economics: Sex As Female Resource for Social Exchange in Heterosexual Interactions », Personality and Social Psychology Review, 2004
Roy F. Baumeister, Kathleen R. Catanese & Kathleen D. Vohs Baumeister, « Is there a gender difference in strength of sex drive? Theoretical views, conceptual distinctions, and a review of relevant evidence », Personality and Social Psychology Review, 2001
James Elias, Vern L. Bullough & Veronica Elias, Prostitution: On whores, hustlers, and johns, Prometheus, 1998
Mark Regnerus, Jeremy Uecker, Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marrying, Oxford University Press, 2011