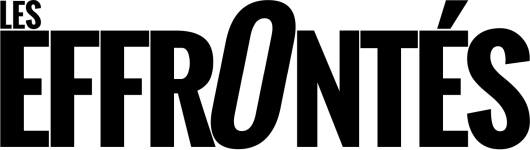Au cours des années 2000, quelques auteurs américains bouleversèrent ma vision de l’histoire, de l’avenir et de ma propre situation dans le monde. Parmi ceux-ci, Dmitry Orlov prédisait avec un humour glacial le déclin des États-Unis en comparant leur trajectoire avec celle de l’Union soviétique. La plupart des gens le prenaient pour un affreux farfelu à l’époque. Pourtant, à mesure que nous nous enfonçons dans le siècle du déclin, l’histoire lui donne raison. — TB
Humer les roses
Une autre note sur la culture : une fois que l’économie s’effondre, il y a généralement moins à faire, ce qui en fait une bonne époque pour les gens naturellement oisifs et une mauvaise pour ceux prédisposés à s’affairer. La culture de l’ère soviétique laissait de la place à deux types d’activité : normale, ce qui signifiait généralement éviter de se faire suer, et héroïque. L’activité normale était attendue, et il n’y avait jamais la moindre raison d’en faire plus. En fait, ce genre de choses avait tendance à être désapprouvé par la collectivité ou la piétaille. L’activité héroïque était célébrée, mais pas nécessairement récompensée financièrement.
Les Russes ont tendance a considérer avec une confusion perplexe la compulsion américaine à « travailler dur et s’amuser dur » [NdT : work hard and play hard]. Le terme « carrière » était à l’époque soviétique un terme péjoratif — l’attribut d’un carriériste — quelqu’un d’avide, sans scrupule et excessivement ambitieux (aussi un terme péjoratif). Des termes comme « le succès » et « la réussite » étaient très rarement appliqués à un niveau personnel, parce qu’ils sonnaient prétentieux et pompeux. Ils étaient réservés à des déclarations publiques emphatiques sur les grands succès du peuple soviétique. Non que des caractéristiques personnelles positives n’aient pas existé : à un niveau personnel, on accordait du respect au talent, au professionnalisme, à la décence, parfois même à la créativité. Mais « bosseur », pour un Russe, sonnait beaucoup comme « idiot ».
Une économie en train de s’effondrer est particulièrement dure pour ceux qui sont habitués à un service prompt et courtois. En Union soviétique, la plupart des services officiels étaient malpolis et lents, et impliquaient d’attendre dans de longues files. Nombre des produits peu disponibles ne pouvaient être obtenus même de cette manière, et nécessitaient quelque chose appelée blat : une faveur ou un accès spécial, officieux. L’échange de faveurs personnelles était bien plus important pour le fonctionnement réel de l’économie que l’échange d’argent. Pour les Russes, blat est presque une chose sacrée : une part vitale de la culture qui cimente la société. C’est aussi la seule partie de l’économie qui est à l’épreuve de l’effondrement et, en tant que telle, une précieuse adaptation culturelle. La plupart des Américains ont entendu parlé du communisme, et croient automatiquement que c’est une description appropriée du système soviétique, même s’il n’y avait rien de particulièrement collectif dans un État-providence et un vaste empire industriel dirigé par une bureaucratie élitiste de planification centralisée. Mais très peu d’entre eux ont entendu parler du -isme réellement opératoire qui dominait la vie soviétique : le dofenisme, ce qui peut se traduire librement par « en avoir rien à foutre ». Beaucoup de gens, et de plus en plus durant la période de stagnation des années 1980, ne ressentaient que du mépris pour le système, faisaient le peu qu’ils avaient à faire pour s’en sortir (veilleur de nuit et chauffeur de chaudière étaient deux boulots prisés parmi les gens hautement éduqués) et tiraient tout leur plaisir de leurs amis, de leurs lectures, ou de la nature.
Cette sorte de disposition peut sembler être une façon de se défiler, mais quand il y a un effondrement à l’horizon, cela fonctionne comme une assurance psychologique : au lieu de passer par le processus déchirant de la perte et de la redécouverte de son identité dans un environnement post-effondrement, on peut simplement se détendre et regarder les événements se dérouler. Si vous avez actuellement le bras long [NdT : if you are currently a mover and a shaker], sur les choses, les gens ou quoi que ce soit, alors l’effondrement surviendra sûrement comme un choc pour vous, et il vous faudra longtemps, peut-être toujours, pour trouver davantage de choses sur lesquelles allonger le bras à votre satisfaction. Cependant, si votre occupation actuelle est d’être un observateur assidu de l’herbe et des arbres alors, après l’effondrement, vous pourriez entreprendre quelque autre chose qui soit utile, telle que le démantèlement des choses inutiles.
La capacité de s’arrêter et de humer les roses — de laisser aller, de refuser d’entretenir des regrets ou de nourrir du ressentiment, de cantonner son attention sérieuse seulement à ce qui est immédiatement nécessaire, et de ne pas trop s’inquiéter du reste — est peut-être la plus critique pour la survie après l’effondrement. Les gens les plus dévastés psychologiquement sont habituellement ceux qui faisaient bouillir la marmite, et qui, une fois qu’ils ne sont plus lucrativement employés, se sentent complètement perdus. Le détachement et l’indifférence peuvent être très salutaires, pourvu qu’ils ne deviennent pas morbides. Il est bon de prendre sa nostalgie sentimentale pour ce qui fut, est, et ne sera bientôt plus, de face, et d’en finir avec elle.
Le dépeçage des actifs
L’économie de la Russie post-effondrement fut pendant un temps dominée par un type de commerce de gros : le dépeçage des actifs. Pour placer cela dans un cadre américain : supposons que vous ayez un titre de propriété, ou un autre accès sans restriction à un sous-ensemble périurbain entier, qui n’est plus accessible par le transport, public ou privé, trop loin pour être accessible à bicyclette, et qui n’est généralement plus adéquat à sa destination initiale de logement et d’accumulation de capital pour des migrants journaliers pleinement employés qui faisaient leurs courses au centre commercial voisin à présent défunt. Après que les hypothèques ont été saisies et les propriétés reprises, qu’y a-t-il de plus à faire, sauf tout barricader et laisser pourrir ? Et bien, ce qui a été construit peut être tout aussi facilement déconstruit.
Ce que vous faites est d’en dépecer tout ce qui est valable ou réutilisable, et de vendre ou de stocker les matériaux. Retirez le cuivre des rues et des murs. Emportez les bordures de trottoir et les poteaux. Démontez les panneaux en vinyle. Arrachez l’isolation en laine de verre. Les éviers et les fenêtres peuvent sûrement trouver un nouvel emploi ailleurs, particulièrement si l’on n’en fabrique plus de nouveaux.
Voir des bouts du paysage disparaître peut être une rude surprise. Un été, je suis arrivé à Saint-Pétersbourg et j’ai découvert qu’un nouveau fléau était descendu sur terre pendant que j’étais parti : bon nombre des couvercles des bouches d’égout avaient mystérieusement disparu. Personne ne savait où ils étaient partis ou qui avait profité de leur enlèvement. Une hypothèse était que les employés municipaux, qui n’avaient pas été payés depuis des mois, les avaient emportés chez eux, pour les rendre une fois qu’ils seraient payés. Ils ont fini par réapparaître, alors cette théorie a peut-être des mérites. Avec des bouches béantes positionnées à travers la ville comme autant de pièges à fourmi pour les voitures, vous aviez le choix de conduire soit très lentement et prudemment, soit très vite, en pariant votre vie sur le fonctionnement correct des amortisseurs.
Le parc de logements de la Russie post-effondrement est resté largement intact, mais une orgie de dépeçage d’actifs d’un genre différent a eu lieu : pas seulement l’inventaire restant, mais des usines entières ont été dépecées et exportées. Ce qui s’est passé en Russie sous couvert de privatisation, est un sujet pour un autre article, mais qu’on l’appelle privatisation ou liquidation ou vol n’importe pas : ceux qui ont un titre de propriété sur quelque chose d’inutile trouveront une manière d’en extraire de la valeur, la rendant encore plus inutile. Un sous-ensemble périurbain abandonné pourrait être inutile en tant que logement, mais valable comme décharge de déchets toxiques.
Ce n’est pas parce que l’économie va s’effondrer dans le pays le plus dépendant du pétrole au monde que cela signifie nécessairement que les choses seront aussi mauvaises partout ailleurs. Comme le montre l’exemple soviétique, si le pays entier est à vendre, des acheteurs se matérialiseront de nulle part, l’emballeront et partiront avec. Ils exporteront tout : le mobilier, l’équipement, les œuvres d’art, les antiquités. Le dernier vestige de l’activité industrielle est habituellement le commerce de la ferraille. Il semble qu’il n’y ait aucune limite à la quantité de métal que l’on puisse extraire d’un site post-industriel mûr.
La nourriture
L’état lamentable de l’agriculture soviétique s’est avéré paradoxalement bénéfique pour encourager une économie potagère, laquelle a aidé les Russes à survivre à l’effondrement. À un certain point il s’est su informellement que dix pour cent de la terre agricole — la part allouée aux parcelles privées — était utilisée pour produire quatre-vingt-dix pour cent de la nourriture. En plus de souligner l’inadéquation grossière du commandement et du contrôle de l’agriculture industrielle dans le style soviétique, cela indique un fait général : l’agriculture est bien plus efficace quand elle est réalisée sur une petite échelle, en utilisant du travail manuel. [NdlR : Une observation faite pour la première fois en Inde au début des années 1960 par l’économiste Amartya Sen, et maintes fois vérifiée dans divers pays.]
Les Russes ont toujours fait pousser une partie de leur propre nourriture, et la rareté des produits de bonne qualité dans les magasins du gouvernement a entretenu la tradition des jardins potagers même durant les périodes plus prospères des années 1960 et 1970. Après l’effondrement, ces jardins potagers se sont avérés être des planches de salut. Ce que de nombreux Russes pratiquaient, soit par tradition, soit par essai et erreur, soit par pure paresse, était de certaines façons semblables aux nouvelles techniques d’agriculture biologique et d’agriculture permanente. De nombreuses parcelles productives en Russie ressemblaient à une bataille d’herbes, de légumes et de fleurs poussant dans une profusion sauvage.
Les forêts en Russie ont toujours été utilisées comme une source importante de nourriture additionnelle. Les Russes reconnaissent et mangent, presque toutes les variétés de champignons comestibles, et toutes les baies comestibles. Durant la saison des champignons, qui est généralement à l’automne, les forêts sont envahies de ramasseurs. Les champignons sont soit marinés, soit séchés et mis en réserve, et durent souvent tout l’hiver.

L’utilisation des drogues récréatives
Une similitude plutôt frappante entre les Russes et les Américains est leur propension à l’automédication. Tandis que le Russe se consacre traditionnellement sans réserve au passe-temps de la vodka, l’Américain a le plus souvent essayé aussi le cannabis. La cocaïne aussi a eu un grand effet sur la culture américaine, tout comme les opiacés. Il y a des différences aussi : le Russe est quelque peu moins susceptible de boire seul, ou d’être appréhendé pour avoir bu, ou être saoul, en public. Pour un Russe, être saoul est presque un droit sacré ; pour un Américain, c’est un plaisir coupable. Nombre des Américains les moins heureux sont forcés par les circonstances de boire et de conduire ; cela ne les rends pas — ni les autres conducteurs, ni les piétons (s’il en existait encore) — plus heureux.
Le Russe peut devenir furieusement ivre en public, tituber en chantant des chansons patriotiques, tomber dans un tas de neige, et geler à mort ou être porté jusqu’à une cellule de dégrisement. Tout cela produit peu ou pas de remords chez lui. D’après mes lectures de H. L. Mencken, l’Amérique aussi fut autrefois une terre d’ivrognes heureux, où une bouteille de whisky faisait le tour du tribunal au début des délibérations, et où un jury ivre rendait plus tard un verdict ivre, mais la prohibition a ruiné tout cela. La prohibition russe n’a duré que quelques courtes années, quand Gorbatchev a essayé de sauver la nation d’elle-même, et a échoué misérablement.
[NdT : Henry Louis Mencken fut un journaliste, un écrivain et un satiriste de la première moitié du XXe siècle. Au cours de la période de prohibition de l’alcool aux États-Unis, de 1920 à 1933, Mencken écrivait : « Cinq années de prohibition ont eu, au moins, ce seul effet bénin : elles ont complètement anéanti tous les arguments favoris des prohibitionnistes. Aucun des grands bienfaits et usufruits qui devaient suivre le vote du dix-huitième amendement ne s’est produit. Il n’y a pas moins d’ivresse dans la république, mais plus. Il n’y a pas moins de crime, mais plus. Il n’y a pas moins de démence, mais plus. Le coût du gouvernement n’est pas plus faible, mais beaucoup plus lourd. Le respect pour la loi ne s’est pas accru, mais a diminué. »]
Quand l’économie s’effondre, les ivrognes de partout trouvent encore plus de raisons de se saouler, mais beaucoup moins de moyens pour se procurer de la boisson. En Russie, des solutions de marché innovantes ont été rapidement improvisées, que j’ai eu le privilège d’observer. C’était l’été, et j’étais dans un train électrique se dirigeant vers Saint-Pétersbourg. Il était bondé, alors je me tenais dans le vestibule de la voiture [NdT : À ne pas confondre avec le wagon, que l’on réserve aux marchandises, aux bestiaux et aux minorités vouées au génocide.], et j’observais les arcs-en-ciel (il venait de pleuvoir) par la vitre manquante. Bientôt, l’activité dans le vestibule attira mon attention : à chaque arrêt, des mémés avec des pichets de gnôle approchaient des portes de la voiture et offraient un reniflement aux passagers avides attendant à l’intérieur. Le prix et la qualité étaient rapidement discutés, et la quantité convenue était dispensée en échange d’une poignée de billets, du pichet au gobelet, et le train repartait. C’était une atmosphère tendue, parce qu’avec les clients payants en venaient beaucoup d’autres, qui n’étaient là que pour le trajet, mais espéraient quand même leur juste part. Je fus forcé de sortir précipitamment et de m’entasser dans le compartiment, parce que les resquilleurs pensaient que je prenais une précieuse place de resquillage.
Il reste peut-être quelques bouilleurs de cru dans les coins ruraux des États-Unis, mais la plus grande partie du pays semble accrochée aux boites et aux canettes de bières, ou à des pichets d’alcool en plastique ou en verre. Quand cette source s’asséchera en raison des difficultés de camionnage entre États, les brasseries locales continueront sans aucun doute de fonctionner, et même d’accroître leur production, pour répondre à la fois à la demande ancienne et nouvelle, mais il y aura encore beaucoup d’espace pour l’improvisation. Je m’attendrais aussi à ce que le cannabis deviennent encore plus répandu ; il rend les gens moins enclins à la violence que l’alcool, ce qui est bien, mais il stimule aussi leur appétit, ce qui est mauvais s’il n’y a pas beaucoup de nourriture. Néanmoins, il est bien moins cher à produire que l’alcool, qui nécessite du grain ou du gaz naturel et une chimie compliquée.
Au total, je m’attends à ce que les drogues et l’alcool deviennent l’une des plus grandes opportunités entrepreneuriales post-effondrement à court terme aux États-Unis, avec le dépeçage des actifs et la sécurité.